Éric-Emmanuel Schmitt, Crime parfait
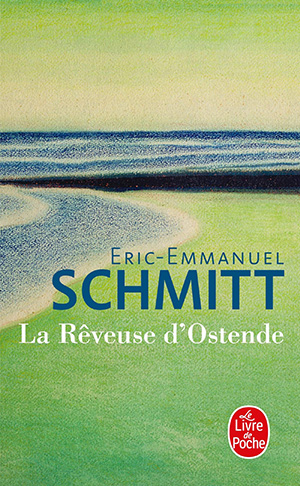
Crime parfait
Issu du recueil de nouvelles "La Rêveuse d'Ostende"
◄►
Dans quelques minutes, si tout se passait bien, elle tuerait son mari.
Le sentier sinueux s’amincissait d’une façon périlleuse cent mètres en amont, surplombant la vallée. À ce point de son flanc, la montagne ne s’épanouissait plus en pente mais se raidissait en falaise. Le moindre faux pas se révélerait mortel. Rien pour que le maladroit se rattrape, ni arbres, ni buissons, ni plate-forme ; ne dépassaient du mur rocheux que des blocs pointus sur lesquels un corps se déchirerait.
Gabrielle ralentit sa marche pour observer les alentours. Personne ne gravissait le chemin derrière eux, nul randonneur sur les vallons opposés. Pas de témoin donc. Seuls une poignée de moutons, à cinq cents mètres au sud, occupaient les prés, goulus, la tête baissée sur l’herbe qu’ils broutaient.
— Eh bien, ma vieille, tu es fatiguée ? Elle grimaça à l’appel de son mari : « Ma vieille », justement ce qu’il ne fallait pas dire s’il voulait sauver sa peau !
Il s’était retourné, inquiet de son arrêt.
— Tu dois tenir encore. On ne peut pas s’arrêter ici, c’est trop dangereux.
En Gabrielle, au fond de son crâne, une voix ricanait de chaque mot prononcé par le futur mort. « Ça, tu l’as annoncé, ça va être dangereux ! Tu risques même de ne pas y survivre, mon vieux ! »
Un soleil blanc plombait les corps et imposait le silence aux alpages qu’aucun souffle d’air ne caressait, à croire que l’astre surchauffé voulait rendre minéral ce qu’il touchait, plantes et humains compris, qu’il comptait écraser toute vie.
Gabrielle rejoignit son mari en maugréant.
— Avance, ça va.
— En es-tu certaine, ma chérie ?
— Puisque je te le dis.
Avait-il lu dans ses pensées ? Se comportait-elle, malgré elle, d’une manière différente ? Soucieuse d’exécuter son plan, elle entreprit de le rassurer par un large sourire.
— En fait, je suis contente d’être remontée ici. J’y venais souvent avec mon père pendant mon enfance.
— Ça, siffla-t-il en jetant un regard panoramique sur les flancs escarpés, on se sent petit ici ! La voix intérieure grinça : « Petit, tu le seras bientôt davantage. »
Ils reprirent l’ascension, lui devant, elle derrière. Surtout ne pas flancher. Le pousser sans hésiter quand il faudra. Ne pas le prévenir. Éviter de soutenir son regard. Se concentrer sur le mouvement judicieux. L’efficacité, seule l’efficacité compte. La décision, elle, a été prise depuis longtemps, Gabrielle ne reviendra pas dessus.
Il commençait à aborder le virage scabreux. Gabrielle pressa l’allure sans attirer l’attention. Crispée, hâtive, la respiration gênée par la nécessité d’être discrète, elle manqua glisser sur une
pierre déchaussée. « Ah non, s’esclaffa la voix, pas toi ! Tu ne vas pas avoir un accident alors que la solution approche. » Dans cette défaillance, elle puisa une énergie gigantesque, se rua sur le dos qu’elle suivait et envoya à pleine force son poing au creux de ses reins.
L’homme se cambra, perdit l’équilibre. Elle porta le coup de grâce en frappant les deux mollets de son pied.
Le corps jaillit du sentier et commença sa chute dans le vide. Effrayée, Gabrielle se plaqua en arrière, épaule contre la pente, pour ne pas tomber et pour éviter de voir ce qu’elle avait déclenché.
L’entendre lui suffit…
Un cri retentit, déjà lointain, chargé d’une abominable angoisse, puis il y eut un choc, un deuxième choc, pendant lesquels la gorge hurla encore de douleur, puis de nouveaux chocs, des sons de brisures, de déchirements, quelques roulis de pierres, et puis, soudain, un vrai silence. Voilà ! Elle avait réussi. Elle était délivrée.
Autour d’elle, les Alpes offraient leur paysage grandiose et bienveillant. Un oiseau planait, immobile, au-dessus des vallées, accroché à un ciel pur, lavé. Nulle sirène ne retentissait pour l’accuser, aucun policier ne surgissait en brandissant des menottes. La nature l’accueillait, souveraine, sereine, complice, en accord avec elle.
Gabrielle se détacha de la paroi et pencha la tête au-dessus du gouffre. Plusieurs secondes s’écoulèrent avant qu’elle ne repérât le corps disloqué qui ne se trouvait pas dans la direction où elle le cherchait. Fini ! Gab avait cessé de respirer. Tout était simple. Elle n’éprouvait aucune culpabilité, seulement un soulagement. Du reste, elle ne se sentait déjà aucun lien avec le cadavre qui gisait là-bas.
Elle s’assit et cueillit une fleur bleu pâle qu’elle mâchouilla. Maintenant, elle aurait le temps de paresser, de méditer, elle ne serait plus obsédée par ce que Gab faisait ou lui dissimulait. Elle renaissait.
Combien de minutes demeura-t-elle ainsi ? Un bruit de cloche, quoique assourdi par la distance, l’arracha à son extase. Les moutons. Ah oui, il fallait redescendre, jouer la comédie, donner l’alerte. Maudit Gab ! À peine était-il parti qu’elle devait encore lui consacrer son temps, déployer des efforts pour lui, se contraindre ! La laisserait-il jamais tranquille ?
Elle se redressa, rassérénée, fière d’elle. L’essentiel accompli, elle n’avait plus guère à avancer pour gagner sa paix.
Rebroussant chemin, elle se rappela son scénario. Comme c’était curieux de se souvenir de ça, d’un projet qui avait été conçu en un temps différent, un temps où Gab l’encombrait de sa présence. Un autre temps. Un temps déjà lointain.
Elle marchait d’un pas leste, plus vite qu’elle n’aurait dû, car son essoufflement l’aiderait à convaincre les gens qu’elle était bouleversée. Elle devait juguler son euphorie, escamoter sa joie devant ces trois ans de fureur qui disparaissaient, trois ans où des indignations cuisantes et aiguës avaient planté leurs flèches dans l’intérieur de son crâne. Il ne lui servirait plus du « ma vieille », il ne lui infligerait plus ce regard de pitié qu’il avait eu tantôt en lui tendant la main, il ne prétendrait plus qu’ils étaient heureux alors que c’était faux. Il était mort. Alléluia. Vive la liberté.
Après deux heures de marche, elle aperçut des randonneurs et courut dans leur direction.
— Au secours ! Mon mari ! S’il vous plaît ! À l’aide !
Tout s’enchaîna merveilleusement. Elle tomba au sol en s’approchant d’eux, se blessa, fondit en larmes et raconta l’accident. Ses premiers spectateurs mordirent à l’hameçon et avalèrent l’ensemble, l’histoire autant que son chagrin. Leur groupe se scinda : les femmes l’accompagnèrent dans la vallée tandis que les hommes partaient à la recherche de Gab.
À l’hôtel Bellevue, son arrivée avait dû être précédée d’un coup de téléphone car le personnel au complet l’accueillit avec des têtes de circonstance. Un gendarme au visage incolore lui annonça qu’un hélicoptère emmenait déjà l’équipe de secouristes.
Au mot « secouristes », elle frissonna. Comptaient-ils le retrouver en vie ? Gab aurait-il pu réchapper à sa chute ? Elle se rappela son cri, la cessation des cris puis le silence, et en douta. — Vous… vous croyez qu’il peut être vivant ?
— Nous avons cet espoir, madame. Était-il en bonne condition physique ?
— Excellente mais il a fait une chute de plusieurs centaines de mètres, en rebondissant sur les rochers.
— On a déjà vu des cas plus surprenants. Tant que nous ne savons pas, notre devoir est de rester optimistes, chère madame.
Impossible ! Soit elle était folle, soit lui l’était. Prononçait-il ces phrases parce qu’il détenait des renseignements ou répétait-il des formules stéréotypées ? La seconde solution sans doute… Gab ne pouvait avoir survécu. À supposer que, par miracle, il soit rescapé, il devait être brisé, traumatisé, perclus d’hémorragies internes et externes, incapable de parler ! Allons, si ce n’était déjà accompli, il allait mourir dans les heures qui viendraient. Aurait-il eu le temps d’articuler quelque chose aux brancardiers ? Juste avant qu’on le treuille dans l’hélicoptère ? L’aurait-il dénoncée ? Improbable. Qu’avait-il compris ? Rien. Non, non, non, et mille fois non.
Elle plongea sa tête entre les mains et les témoins pensèrent qu’elle priait en étouffant ses larmes ; en réalité, elle pestait contre le gendarme. Quoiqu’elle fût sûre d’avoir raison, cet abruti lui avait fichu des doutes ! Voilà qu’elle tremblait de peur, désormais !
Soudain une main se posa sur son épaule. Elle sursauta. Le chef des secouristes la fixait avec une mine de cocker battu.
— Il va falloir être courageuse, madame.
— Comment est-il ? cria Gabrielle, déchirée par l’angoisse.
— Il est mort, madame.
Gabrielle poussa un hurlement. Dix personnes se précipitèrent sur elle pour l’apaiser, la consoler. Sans vergogne, elle cria et sanglota, bien décidée à se purger de ses émotions : ouf, il ne s’en était pas sorti, il ne parlerait pas, le béat de service lui avait flanqué la trouille pour rien !
Alentour, on la plaignait. Quelle suave volupté, celle de l’assassin tenu pour une victime… Elle s’y consacra jusqu’au repas du soir que, naturellement, elle refusa de prendre. À neuf heures, la police revint vers elle pour lui expliquer qu’on devait l’interroger. Quoiqu’elle jouât l’étonnement, elle s’y attendait. Avant de passer à l’acte, elle avait répété son témoignage, lequel devait persuader qu’il s’agissait d’un accident et réfuter les doutes qui pèsent d’abord sur le conjoint lors d’un décès.
On l’emmena dans un commissariat de crépi rose où elle raconta sa version des événements en observant un calendrier qui présentait trois chatons ravissants.
Bien que ses interlocuteurs s’excusassent de lui infliger telle ou telle question, elle continuait comme si elle n’imaginait pas une seconde qu’on la soupçonnât de quoi que ce soit. Elle amadoua chacun, signa le procès-verbal et rentra à l’hôtel pour passer une nuit paisible.
Le lendemain, ses deux filles et son fils débarquèrent, flanqués de leurs conjoints, et, cette fois-ci, la situation l’embarrassa. Devant le chagrin de ses enfants aimés, elle éprouva un authentique remords, pas le regret d’avoir tué Gab, mais la honte de leur infliger cette peine. Quel dommage qu’il fût aussi leur père ! Quelle bêtise qu’elle ne les ait pas conçus avec un autre pour leur éviter de pleurer celui-là… Enfin, trop tard. Elle se réfugia dans une sorte de mutisme égaré.
Seul intérêt pratique de leur présence : ils allèrent reconnaître le cadavre à la morgue afin d’épargner leur mère. Ce qu’elle apprécia.
Ils tentèrent aussi d’intercepter les articles de la presse régionale relatant la chute tragique, n’imaginant pas que ces titres « Mort accidentelle d’un randonneur » ou « Victime de son imprudence » réjouissaient Gabrielle parce qu’ils lui confirmaient, noir sur blanc, la mort de Gab et son innocence à elle.
Un détail pourtant lui déplut : au retour de l’institut médico-légal, sa fille aînée, les yeux rougis, se crut obligée de glisser à l’oreille de sa mère : « Tu sais, Papa, même mort, était très beau. » De quoi se mêlait-elle, cette gamine ? La beauté de Gab, ça ne concernait que Gabrielle ! Gabrielle exclusivement ! N’avait-elle pas assez souffert à cause de cela ?
Après cette remarque, Gabrielle se ferma jusqu’à la fin des funérailles.
Lorsqu’elle retourna chez elle, à Senlis, les voisins et les amis vinrent présenter leurs condoléances. Si elle accueillit les premiers avec plaisir, elle s’exaspéra vite de devoir répéter le même récit et écouter, en écho, des banalités identiques. Derrière un visage triste, résigné, elle bouillait de colère : à quoi bon se débarrasser de son mari pour parler de lui sans cesse ! D’autant qu’elle était impatiente de filer au troisième étage, de défoncer le mur, de fouiller sa cachette et de découvrir ce qui la tourmentait. Vivement qu’on la laisse seule !
Leur hôtel particulier, proche de l’enceinte fortifiée, ressemblait aux châteaux dessinés dans les livres de contes, multipliant, sous le fouillis des rosiers grimpants, les tourelles, les créneaux, les meurtrières, les balcons sculptés, les rosaces décoratives, les envols de marches, les fenêtres aux pointes gothiques et aux vitres colorées. Avec l’expérience, Gabrielle s’appuyait sur les exclamations de ses visiteurs pour déterminer leur degré d’inculture et les avait classés en quatre catégories, du barbare au barbant. Le barbare jetait un œil hostile aux murs en grommelant : « C’est vieux, ici » ; le barbare se croyant cultivé murmurait : « C’est du Moyen Âge, non ? » ; le barbare vraiment cultivé décelait l’illusion : « Style médiéval construit au XIXe siècle ? » ; enfin le barbant criait : « Viollet-le-Duc ! » avant d’ennuyer tout le monde en commentant chaque élément que le fameux architecte et son atelier avaient pu déformer, restituer, inventer.
Une telle résidence n’avait rien de surprenant à Senlis, village de l’Oise, au nord de Paris, qui rassemblait sur sa crête maintes demeures historiques. À côté de pierres datant de Jeanne d’Arc ou de bâtisses édifiées aux XVIIe et XVIIIe siècles, celle de Gabrielle apparaissait même comme l’une des moins élégantes car récente – un siècle et demi – et d’un goût discuté. Néanmoins, leur couple y avait vécu depuis qu’elle l’avait héritée de son père et Gabrielle trouvait amusant que ses murs la dénoncent comme appartenant aux « nouveaux riches », elle qui ne s’était jamais estimée ni riche ni nouvelle.
Au troisième niveau de cette habitation qui aurait enchanté Alexandre Dumas ou Walter Scott, une pièce appartenait à Gab. Après leur mariage, il avait été convenu, afin qu’il se sentît chez lui bien qu’il s’installât chez elle, qu’il aurait la jouissance totale de cette partie sans que Gabrielle ne la lui disputât ; elle avait la permission de venir l’y rejoindre lorsqu’il s’y attardait, sinon elle ne devait pas s’y rendre.
Le lieu ne présentait rien d’exceptionnel – des livres, des pipes, des cartes, des mappemondes –, offrait un confort minimal – des fauteuils de cuir défoncés – mais comportait un orifice dans l’épais mur, obstrué par une trappe verticale. Gab l’avait ménagé vingt ans plus tôt en retirant des briques. Quand il y ajoutait un objet, il maçonnait de nouveau la surface avec un crépi afin de camoufler le réduit aux regards. À cause de ces précautions, Gabrielle savait qu’elle n’aurait pu être indiscrète sans en fournir la preuve. Par amour d’abord, par crainte ensuite, elle avait donc toujours respecté le secret de Gab. Souvent, il s’en amusait et la plaisantait, testant sa résistance…
Désormais, plus rien ne s’opposait à ce qu’elle détruise le revêtement.
Les trois premiers jours, elle aurait jugé indécent de saisir un marteau et un pied-de-biche ; de toute façon, vu l’afflux de visiteurs, elle n’en eut pas le temps. Le quatrième, notant que ni le téléphone ni la cloche extérieure ne retentissaient, elle se promit, après un tour à son magasin d’antiquités, trois cents mètres plus loin, de rassasier sa curiosité.
Presque à la sortie de la ville, l’enseigne « G. et G. de Sarlat » en lettres dorées annonçait, sobre, une boutique d’antiquités comme la région les aimait, c’est-à-dire un lieu où l’on chinait aussi bien des pièces importantes – buffets, tables, armoires – pour meubler les vastes résidences secondaires que des bibelots – lampes, miroirs, statuettes – pour décorer des intérieurs constitués. Aucun style particulier n’était représenté ici, la plupart l’étaient, y compris en d’épouvantables imitations, pourvu qu’elles aient plus de cent ans.
Les deux employés la mirent au courant des mouvements de pièces pendant les vacances fatales en Savoie puis Gabrielle rejoignit sa comptable. À l’issue d’une brève consultation, elle parcourut le magasin qui s’était rempli de commères depuis qu’on avait appris dans les rues alentour que « cette pauvre madame Sarlat » s’y trouvait.
Elle tressaillit en apercevant Paulette parmi elles.
— Ma pauvre cocotte, s’exclama Paulette, si jeune et déjà si veuve !
Paulette chercha un cendrier où poser la cigarette fumante qu’elle avait maculée d’orange à lèvres, n’en rencontra pas, l’éteignit donc sous son talon vert, sans se soucier de brûler le linoléum, et s’avança, théâtrale, vers Gabrielle en ouvrant les bras.
— Ma pauvre chérie, je suis si malheureuse de te voir malheureuse.
Gabrielle se laissa embrasser en tremblant.
Paulette demeurait la seule femme qu’elle redoutait tant celle-ci lisait la vérité dans les êtres. Considérée par beaucoup comme la pire langue de vipère, elle avait le don de traverser les parois des crânes avec un rayon laser, son regard insistant, ses yeux globuleux, pour tourner ensuite des phrases qui pouvaient démolir à jamais la réputation d’un individu.
Le temps de l’étreinte, Gabrielle s’asphyxia en mangeant quelques cheveux jaunes et secs de Paulette, épuisés par des décennies de teintures et de mises en plis, puis affronta avec bravoure ce visage luisant d’une crème bistre.
— Dis-moi, la police t’a interrogée ? Ils t’ont demandé si tu l’avais tué, bien sûr ?
« Voilà, songea Gabrielle, elle se doute déjà que c’est moi. Elle ne perd pas de temps, elle attaque aussitôt. »
Gabrielle acquiesça en pliant le cou. Paulette réagit en hurlant :
— Les salauds ! Te contraindre à ça, toi ! Toi ! Toi qui étais folle de ton Gab, qui bouffais la
moquette depuis trente ans devant lui ! Toi qui te serais fait opérer en n’importe quoi s’il te l’avait demandé, en homme ou en souris ! Ne m’étonne pas ! Des salauds ! Tous des salauds ! Sais-tu ce qu’ils m’ont fait, à moi ? Quand j’élevais mon second, Romuald, j’avais dû un jour l’amener à l’hôpital parce que le gamin s’était fichu des bleus en ratant sa sortie de bain ; figure-toi que la police est venue me chercher aux urgences pour me demander si je ne l’avais pas maltraité ! Si ! Ils m’ont traînée au poste ! En garde à vue ! Moi ! Quarante-huit heures ça a duré. Moi, la mère, je passais pour une coupable alors que j’avais conduit mon gosse à l’hôpital ! Les porcs ! Ils t’ont infligé le même sort ?
Gabrielle comprit que Paulette, loin de la suspecter, se rangeait de son côté. Elle lui donnait sa sympathie d’ex-victime. Pour elle, toute femme interrogée par la police devenait de suite, par analogie avec son cas, une innocente.
— Oui, moi aussi. Le soir même.
— Les chacals ! Combien de temps ?
— Plusieurs heures !
— Bande de rats ! Mon pauvre poussin, ça t’a humiliée, hein ?
Paulette, offrant à Gabrielle la tendresse qu’elle éprouvait pour elle-même, écrasa de nouveau son amie contre elle.
Soulagée, Gabrielle lui permit de vitupérer un bon moment puis retourna à la maison pour s’attaquer à la cachette de Gab.
À midi, elle gravit les marches, outils en main, et commença à détruire les protections. La planche sauta, découvrant un espace où quatre coffrets avaient été empilés.
Elle approcha une table basse et les y déposa. Si elle ignorait ce qu’ils contenaient, elle reconnaissait les emballages, des grandes boîtes de biscuits en métal dont les étiquettes, quoique mangées par le temps et l’humidité, indiquaient « Madeleines de Commercy », « Bêtises de Cambrai », « Coussins de Lyon » ou autres confiseries.
Elle entrouvrait un couvercle quand la cloche d’entrée la dérangea.
Quittant son travail en friche, elle ferma la porte en abandonnant la clé sur la serrure puis descendit ouvrir, décidée à dégager prestement le fâcheux.
— Police, madame ! Pouvons-nous entrer ?
Plusieurs hommes aux mâchoires sévères se tenaient sur le perron.
— Bien sûr. Que voulez-vous ?
— Êtes-vous Gabrielle de Sarlat, épouse de feu Gabriel de Sarlat ?
— Oui.
— Veuillez nous suivre, s’il vous plaît.
— Pourquoi ?
— Vous êtes attendue au commissariat.
— Si c’est pour me poser des questions sur l’accident de mon mari, cela a été fait par vos collègues savoyards.
— Il ne s’agit plus de la même chose, madame. Vous êtes suspectée d’avoir tué votre mari. Un berger vous a vue le pousser dans le vide.
Après dix heures de garde à vue, Gabrielle hésitait à déterminer qui elle détestait le plus, le commissaire ou son avocat. Peut-être aurait-elle excusé le commissaire… Lorsque celui-ci la tourmentait, il se contentait d’accomplir son métier, il n’y ajoutait ni vice ni passion, il essayait
honnêtement de la transformer en coupable. En revanche, son avocat la troublait car il voulait savoir. Or elle le payait pour croire, pas pour savoir ! Ce qu’elle achetait, c’était sa science des lois, sa pratique des tribunaux, son énergie à la défendre ; elle se moquait qu’il connût ou pas la vérité.
Dès qu’ils avaient été seuls, Maître Plissier, brun quadragénaire au physique avantageux, s’était penché sur sa cliente d’un air important en prenant une voix grave, le genre de voix qu’on attribue aux cow-boys héroïques dans les westerns américains doublés :
— Maintenant, à moi et rien qu’à moi, confiez la vérité, madame Sarlat. Ça ne sortira pas d’ici. Avez-vous poussé votre mari ?
— Pourquoi aurais-je fait ça ?
— Ne me répondez pas par une question. L’avez-vous poussé ?
— C’était ma réponse « pourquoi aurais-je fait ça ? ». On m’accuse d’un acte qui n’a aucun sens. J’aimais mon mari. Nous étions heureux ensemble depuis trente ans. Nous avons eu trois enfants qui peuvent en témoigner.
— Nous pouvons plaider le crime passionnel.
— Le crime passionnel ? À cinquante-huit ans ? Après trente ans de mariage ?
— Pourquoi pas ?
— À cinquante-huit ans, monsieur, si on s’aime encore, c’est qu’on s’aime bien, sur un mode lucide, harmonieux, dépassionné, sans excès, sans crise.
— Madame Sarlat, cessez de m’expliquer ce que je dois penser mais dites-moi plutôt ce que vous pensez. Vous auriez pu être jalouse.
— Ridicule !
— Il vous trompait ?
— Ne le salissez pas.
— Qui hérite de votre mari ?
— Personne, il ne possédait rien. Tout le capital m’appartient. De plus, nous étions mariés sous le régime de la séparation de biens.
— Pourtant, il a un patronyme de bonne famille…
— Oui, Gabriel de Sarlat, ça impressionne toujours. On croit que j’ai épousé une fortune alors que j’ai juste décroché une particule. Mon mari n’avait pas un sou et n’a jamais vraiment su gagner de l’argent. Notre patrimoine vient de moi, de mon père plutôt, Paul Chapelier, le chef d’orchestre. La disparition de mon mari n’améliore pas ma situation financière ; elle ne change rien, voire la gêne car c’est lui qui transportait en camionnette les antiquités que nous vendions au magasin et que, si je veux continuer, je devrai engager un employé supplémentaire.
— Vous n’avez pas répondu à ma question.
— Je ne fais que ça, monsieur.
— Maître…
— Ne soyez pas ridicule. Je n’ai aucun intérêt à la mort de mon mari. Lui en aurait peut-être eu davantage à la mienne.
— Est-ce lui qui, dans cette intention, a essayé de vous pousser ?
— Vous êtes fou ?
— Réfléchissez. Nous pourrions accréditer cette thèse, un combat entre vous. Sur ce chemin de montagne, il décide de vous supprimer pour s’emparer de votre argent. En le repoussant, vous avez cédé à la légitime défense.
— Séparation de biens ! Il n’aurait rien touché à ma mort, pas plus que moi à la sienne. Et pourquoi inventez-vous des scénarios pareils ?
— Parce qu’un homme vous a vue, madame ! Le berger qui gardait son troupeau raconte que vous vous êtes précipitée sur votre mari et que vous l’avez poussé dans le vide.
— Il ment !
— Quel intérêt aurait-il à mentir ?
— C’est extraordinaire, ça… Moi, quand j’avance que je n’ai aucun intérêt à tuer mon mari que j’aimais, vous doutez, tandis que vous croyez le berger sous prétexte que lui n’a aucun intérêt à mentir ! Deux poids, deux mesures ! Par qui êtes-vous engagé ? Par le berger ou bien par moi ? C’est ahurissant ! Je peux vous donner cent raisons, moi, pour que votre berger mente : se rendre intéressant, devenir le héros de son canton, se venger d’une femme ou de plusieurs à travers moi, foutre la merde pour le plaisir de foutre la merde ! Et puis, à quelle distance se trouvait-il ? Cinq cents mètres ? Huit cents mètres ? Deux kilomètres ?
— Madame de Sarlat, n’improvisez pas ma plaidoirie à ma place. Nous avons contre nous un témoignage accablant : il vous a vue !
— Eh bien moi, je ne l’ai pas vu.
Maître Plissier s’arrêta pour dévisager Gabrielle. Il s’assit à côté d’elle et se passa la main sur le front, soucieux.
— Dois-je prendre cela pour un aveu ?
— Quoi ?
— Vous avez regardé autour de vous avant de pousser votre mari et vous n’avez remarqué personne. C’est bien cela que vous êtes en train de me confesser ?
— Monsieur, je suis en train de vous indiquer qu’après la chute de mon mari, j’ai regardé partout et appelé à grands cris car je cherchais du secours. Votre fameux berger ne s’est pas montré, ne m’a pas répondu. C’est curieux, ça, tout de même ! S’il avait prévenu les guides ou s’il était allé aux pieds de mon mari, peut-être que… Quand il me charge, n’est-ce pas pour se protéger lui ?
— De quoi ?
— Non-assistance à personne en danger. Je parle de mon mari. Et de moi, accessoirement.
— Pas mauvais comme idée pour retourner la situation, cependant je me réserve ce genre d’argumentation. Ce serait louche dans votre bouche.
— Ah bon ? On m’accuse d’une monstruosité mais il ne faudrait pas que j’aie l’air trop maligne, c’est agréable !
Elle feignit l’irritation quoiqu’au fond elle fût contente d’avoir compris comment manipuler son avocat.
— Je vais le traîner devant les tribunaux, ce berger, moi !
— Pour l’instant, c’est vous qui êtes mise en examen, madame.
— J’ai dû dévaler la montagne pendant des heures pour croiser des randonneurs et alerter les secours. Votre berger, s’il a vu mon mari tomber, pourquoi il n’est pas allé le soutenir ? Pourquoi il n’a prévenu personne ? Parce que si on avait réagi à temps, mon mari serait peut-être encore vivant…
Puis, excédée d’accomplir la besogne de l’avocat à sa place, elle décida de piquer une crise de larmes et sanglota une bonne dizaine de minutes.
À l’issue de ces convulsions, Maître Plissier, touché, se mit dès lors à créditer tous ses propos. Elle le méprisa davantage pour ce revirement : se laisser abuser par des sanglots, quel balourd ! Au fond, devant une femme résolue, il n’y avait pas sur terre un homme plus malin qu’un autre.
Le commissaire revint et commença son interrogatoire. Il tourna autour des mêmes points ; Gabrielle, de façon moins coupante qu’avec son avocat, répondit à l’identique.
Comme le commissaire était plus astucieux que l’avocat, après avoir exclu les mobiles d’intérêt, il revint sur le couple que Gabrielle formait avec Gab.
— Soyez franche, madame Sarlat, votre époux ne voulait-il pas vous quitter ? Avait-il une maîtresse ? Des maîtresses ? Votre relation était-elle aussi satisfaisante qu’avant ? N’aviez-vous aucun motif de reproche à son égard ?
Gabrielle comprit que son sort se jouerait sur cette zone d’ombre et adopta une tactique qu’elle conserva jusqu’au bout.
— Je vais vous déclarer la vérité, monsieur le commissaire : Gab et moi, nous étions le couple le plus chanceux de l’univers. Il ne m’a jamais trompée. Je ne l’ai jamais trompé. Essayez de trouver quelqu’un qui dise le contraire : c’est impossible. Non seulement j’aimais plus que tout au monde mon mari mais je ne guérirai pas de sa mort.
Si Gabrielle avait aperçu, à cet instant, où la mènerait quelques mois plus tard ce système de défense, peut-être n’aurait-elle pas été si fière de son idée…
Deux ans et demi.
Gabrielle passa en détention préventive deux ans et demi à attendre son procès.
Plusieurs fois, ses enfants tentèrent d’obtenir la liberté provisoire en arguant de la présomption d’innocence mais la justice refusa pour deux raisons, l’une essentielle, l’autre contingente : la première était le témoignage à charge du berger, la deuxième des polémiques amplifiées par les journaux concernant le laxisme des magistrats.
Malgré la dureté de la prison, Gabrielle ne déprimait pas. Après avoir attendu d’être délivrée de son mari, elle attendait d’être délivrée de cette accusation. Elle avait toujours été patiente – qualité nécessaire lorsqu’on travaille dans le commerce des antiquités – et refusait d’être entamée par cet accident de parcours.
De sa cellule, elle songeait souvent aux quatre boîtes qu’elle avait laissées sur la table basse, les boîtes contenant le secret de Gab… Quelle ironie ! Alors qu’elle avait entrepris ces actes pour les ouvrir, voilà qu’on l’avait arrêtée la main sur le couvercle. Sitôt qu’elle sortirait blanchie par les tribunaux, elle irait découvrir le mystère des boîtes à biscuits. Ce serait sa récompense.
Selon Maître Plissier, le procès s’annonçait sous une lumière favorable : les éléments de l’enquête allaient dans leur sens ; tous les témoins, à l’exception du berger, devenaient des témoins à décharge, se rangeant derrière le banc de la défense ; et, du commissaire au juge d’instruction, Gabrielle s’était montrée de plus en plus persuasive à mesure que les interrogatoires se succédaient.
Car Gabrielle savait parfaitement comment bien mentir : il suffisait de dire la vérité. Elle l’avait appris de son père, Paul Chapelier, qu’elle accompagnait, enfant, dans ses déplacements professionnels. Lorsque ce talentueux chef d’orchestre ne dirigeait pas lui-même les musiciens, il assistait à des concerts à l’issue desquels sa notoriété l’obligeait à passer en coulisses pour complimenter les artistes. Soucieux de ne pas froisser des collègues avec lesquels il avait joué ou pourrait jouer, il choisissait de ne formuler que ce qu’il avait apprécié ; virant les critiques négatives, il n’échangeait que sur les points positifs et, s’il n’y avait qu’un seul misérable détail digne de louange, il s’en emparait, l’amplifiait, le développait. Il ne mentait donc jamais, sinon par omission. Dans ses conversations, les interprètes le sentaient sincère et restaient libres de comprendre davantage, les prétentieux le donnant pour enthousiaste et les lucides prisant sa courtoisie. Paul Chapelier répétait à sa fille : « Je n’ai pas assez de mémoire pour faire un bon menteur. » En ne livrant que la vérité et en évitant de s’épancher sur ce qui fâche, il avait réussi à ne pas se contredire et à collectionner les amis dans un milieu pourtant cannibale.
Gabrielle avait adopté sa méthode durant ces deux ans et demi. Pour parler de Gab, elle ne se remémorait que la période radieuse, la période d’amour intense et partagé. Lui s’appelait Gabriel, elle Gabrielle ; ensemble ils devinrent Gab et Gaby. Les hasards de la vie et de l’état civil leur firent un cadeau rare, porter, après mariage, le même nom à la syllabe près, Gabriel (le) de Sarlat. Selon elle, cette identité commune exprimait la force de leur couple, l’indestructibilité de leur union. À ces fonctionnaires payés pour l’écouter, Gabrielle racontait son coup de foudre immédiat pour ce jeune homme qu’elle trouva timide alors qu’il n’était que bien élevé, leur long flirt, leurs escapades, la demande en mariage embarrassée au père artiste que le garçon admirait, la cérémonie à l’église de la Madeleine où retentit un orchestre symphonique au complet. Sans qu’on l’en priât, elle évoquait son attraction inentamée pour ce corps net, élégant, jamais guetté par la graisse ni l’épaississement après cinquante ans, comme si la minceur était une qualité aristocratique livrée avec la particule. Elle égrenait leur bonheur en un interminable chapelet, les enfants, les mariages des enfants, les naissances de petits-enfants, et, malgré le temps qui s’écoule, un homme au physique intact, aux sentiments intacts, au regard intact sur elle, toujours empressé, respectueux et désirant. De temps en temps, elle se rendait compte qu’elle provoquait un malaise chez ses auditeurs, un trouble qui tenait de l’envie ; un jour, le juge d’instruction alla jusqu’à soupirer :
— C’est trop beau pour être vrai, madame, ce que vous me racontez.
Elle le considéra avec compassion et murmura :
— Avouez plutôt que c’est trop beau pour vous, monsieur.
Gêné, il n’insista pas. D’autant que les proches du couple, enfants, gendres, bru, amis, voisins, confirmèrent cet amour idyllique. Pour clore le dossier d’instruction, l’inculpée passa deux fois au détecteur de mensonge avec succès.
La détention avait instauré une solitude chez Gabrielle dont elle ne s’échappait qu’en rejoignant ses souvenirs. Du coup, Gab avait pris une place accrue et insensée dans sa nouvelle vie de prisonnière : soit elle parlait de lui, soit elle pensait à lui. Qu’elle fût isolée ou en compagnie, il était là, lui et lui seul, bienveillant, réconfortant. Fidèle.
Le problème, c’est qu’à force de ne dire que des choses vraies, on finit par les croire. En occultant les trois dernières années de sa vie avec Gab, en ne dévoilant que vingt-sept ans de félicité, Gabrielle comprenait de moins en moins ce qui s’était passé, ce qui l’avait changée. Tout juste si elle se souvenait du « déclic », cette phrase qui l’avait alertée… Mieux valait ne plus y penser, d’ailleurs, à quoi bon ! La Gaby qui, à cause du « déclic », avait été capable de tuer son mari, cette femme-là, la meurtrière, elle ne devait plus exister jusqu’à l’acquittement ; Gabrielle la noya donc dans un puits d’oubli, se coupa des mobiles et raisons qui l’avaient conduite à trucider Gab, et condamna cette zone de son esprit en elle.
À force de l’évoquer, elle redevenait la Gabrielle amoureuse et aimée, incapable de porter la main sur cet homme. Telle une actrice qui, contrainte à fréquenter un personnage, finit par s’identifier et débarque, hallucinante de vérité, sur un plateau de cinéma, Gabrielle arriva à son procès en héroïne inconsolable victime d’une odieuse accusation.
Dès le premier jour d’audience, un consensus se dégagea en sa faveur. Au deuxième, les reporters parlaient déjà d’une imputation infondée. Au troisième, des inconnues pleuraient à chaudes larmes au dernier rang de la salle comble en prenant parti pour l’innocente bafouée. Au quatrième, ses enfants passèrent en boucle aux journaux télévisés pour exprimer leur émotion et leur indignation. Gabrielle traversait les interrogatoires et suivait les auditions des témoins avec une attention serrée ; elle veillait à ce que rien, ni chez elle ni chez les autres, n’entamât la version qu’elle avait construite ; on aurait cru un compositeur scrupuleux assistant aux répétitions de son œuvre, la partition sur les genoux.
Comme prévu, le berger se révéla assez catastrophique lors de son témoignage. Non seulement il parlait un français approximatif – or, dans ce pays, une faute de syntaxe ou de vocabulaire ne trahit pas qu’un manque d’éducation, elle révèle une agression contre la société entière, elle s’assimile à un blasphème craché au culte national de la langue –, mais il se plaignit d’avoir dû avancer l’argent de son billet pour « monter sur Compiègne », et grommela un bon quart d’heure sur ce thème. Questionné par Maître Plissier, il commit ensuite la maladresse d’avouer reconnaître Gabrielle de Sarlat « par sa photo dans les journaux » puis n’apporta que des explications odieuses sur sa mollesse à secourir le corps, « c’est sûr qu’après une chute pareille, ça ne pouvait être que de la charpie, pas besoin d’aller vérifier, je ne suis pas con, quand même ».
En dehors du berger, tout corroborait l’innocence de Gabrielle. L’avant-dernier jour, elle se détendit un peu. Du coup, lorsque le médecin de famille vint à la barre, elle ne s’attendit pas à être fauchée par l’émotion. Le docteur Pascal Racan, fidèle ami du couple Sarlat, racontait plusieurs anecdotes anodines concernant Gab et Gaby, au milieu desquelles celle-ci :
— Rarement vu un couple aussi amoureux. Lorsque l’un d’eux entreprenait quelque chose, ce n’était pas pour lui, c’était pour l’autre. Ainsi, Gaby voulait continuer à plaire à son mari et, pour ce, pratiquait le sport, me demandait des conseils de diététique. Gab lui, quoique sec et mince, souffrait d’hypertension et s’inquiétait, non pas de cette maladie contrôlée par de bons médicaments, mais des effets du traitement. Comme vous le savez, les bêtabloquants baissent la libido, diminuent l’appétit sexuel. Il venait fréquemment m’en parler car il craignait que sa femme pense qu’il la désirait moins. Ce qui était faux, il avait juste moins envie. Jamais vu une telle angoisse chez un homme. Jamais connu quelqu’un aussi soucieux de sa compagne. Dans ces cas-là, la plupart des hommes ne pensent qu’à eux, qu’à leur santé ; et lorsqu’ils constatent que l’appétence décroît, ça les arrange, ça diminue leur taux de relations adultères, ils sont ravis de devenir plus vertueux pour des raisons médicales sans que ça leur coûte d’efforts. Gab, lui, ne songeait qu’à la réaction de Gaby.
En entendant ce détail inconnu d’elle, Gabrielle fut incapable de retenir une crise de larmes. Elle promit de se rétablir mais, bouleversée, n’y parvint pas, de sorte que Maître Plissier demanda une suspension d’audience que la cour lui accorda.
Les membres de l’assistance crurent comprendre pourquoi Gabrielle avait été émue. Celle-ci n’avoua rien à Maître Plissier mais, dès qu’elle se montra capable de parler, elle lui formula une requête :
— S’il vous plaît, je m’enfonce, je ne résiste plus… Pouvez-vous demander un service à ma fille aînée ?
— Oui.
— Qu’elle m’apporte ce soir à la prison les quatre boîtes à biscuits qui se trouvent sur une petite table basse, dans la pièce de leur père. Elle comprendra de quoi je parle.
— Il n’est pas évident qu’elle ait le droit de vous communiquer cela au parloir.
— Oh, je vous en supplie, je vais m’effondrer.
— Allons, allons, plus que vingt-quatre heures. Demain sera le dernier jour, le jour des plaidoiries. Nous serons fixés le soir.
— J’ignore ce qui sera décidé demain, vous aussi, malgré votre confiance et votre talent. Allons, maître, s’il vous plaît, je ne peux plus tenir, je vais faire une bêtise.
— En quoi ces boîtes de biscuits…
— S’il vous plaît. Je ne supporte plus rien, je ne réponds pas de moi.
Il comprit qu’elle le menaçait, sincère, d’attenter à sa vie. Constatant son trouble, redoutant qu’elle n’aille pas jusqu’au bout d’un procès dont l’issue lui semblait victorieuse – une pierre blanche dans sa carrière –, il eut peur d’un faux pas et jura qu’il apporterait lui-même les boîtes qu’elle demandait. Tant pis, il prendrait le risque !
À sa vive surprise, car elle ne l’avait pas habitué aux effusions, il fut saisi aux épaules par Gabrielle qui l’embrassa.
L’audience reprit mais Gabrielle n’y prêta pas l’oreille, elle ne songeait qu’au témoignage du médecin, aux boîtes à secrets, au « déclic », à ce qu’elle taisait depuis deux ans et demi.
De retour dans la fourgonnette qui la ramenait à la prison, elle relâcha ses jambes et réfléchit. À force de n’écouter que des gens qui parlaient d’elle et de lui sans savoir, elle finissait par brasser des idées confuses.
Pourquoi l’avait-elle tué ?
À cause du « déclic »… Se serait-elle trompée ?
À la prison, elle demanda la permission exceptionnelle d’aller à la douche. À cause de son comportement exemplaire et du traitement complaisant que les médias donnaient à son procès, elle l’obtint.
Elle se glissa sous l’eau presque brûlante. Se laver ! Se purifier des sottises qu’elle avait pu débiter ou entendre ces derniers jours. Repenser à ce qui s’était passé, au « déclic »…
Le « déclic » était venu de Paulette… Lorsque cette grande femme dégingandée aux traits virils vint s’établir avec son mari à Senlis, elle fréquenta souvent le magasin de Gabrielle pour meubler et décorer sa nouvelle maison. Même si, au premier abord, elle la jugea vulgaire par son apparence – autant de couleurs sur Paulette que sur un perroquet du Brésil – et par son verbe, Gabrielle se divertissait beaucoup avec cette cliente car elle appréciait son insolence, son mépris du qu’en-dira-ton, ses reparties percutantes, incongrues mais pertinentes. Plusieurs fois, elle la défendit contre son personnel ou des chalands effarouchés. Elle lui accorda un crédit particulier : la nouvelle venue avait le don de repérer les coups tordus. Méfiante et perspicace, Paulette attira son attention sur un trafic de fausses opalines, puis sur un gang qui démontait les cheminées anciennes ; enfin et surtout, elle repérait d’un seul coup d’œil les vices et les secrets des villageois, dépravations obscures que Gabrielle soit méconnaissait, soit avait mis des années à découvrir. Éblouie par la clairvoyance de Paulette, Gabrielle aimait passer du temps avec elle, assise sur les fauteuils à vendre.
Un jour, alors qu’elles bavardaient, Gabrielle remarqua l’œil noir de Paulette qui, de côté, tel celui d’un oiseau, suivait par accrocs les mouvements d’un intrus. L’objet de scrutation était Gab, que Paulette n’avait encore pas rencontré. Amusée d’apprendre ce qu’elle en dirait, Gaby ne lui signala pas que son mari adoré venait de débouler au magasin. Si la conversation roulait, Gabrielle saisissait bien que Paulette ne perdait pas une miette des déplacements, des attitudes et réflexions de Gab.
— Qu’en penses-tu ? demanda soudain Gabrielle en lançant un clin d’œil en direction de Gab. — Celui-là ? Oh là là, c’est le parfait faux cul. Trop poli pour être honnête. Hypocrite de chez hypocrite. Avec mention spéciale et compliments de la maison.
Gabrielle fut si déconcertée qu’elle demeura bouche ouverte jusqu’à ce que Gab se précipitât vers elle, l’embrassât puis saluât Paulette.
Dès qu’elle comprit sa bévue, celle-ci changea d’attitude, s’excusa le lendemain de sa réflexion auprès de Gabrielle, mais il était trop tard : le ver s’était introduit dans le fruit.
À partir de cet instant, jour après jour, l’œil que porta Gaby sur Gab changea. Si Paulette avait affirmé cela, il y avait une cause : elle ne se trompait jamais ! Gaby observa Gab comme s’il lui était devenu étranger, s’efforçant d’oublier tout ce qu’elle savait de lui, ou ce qu’elle croyait savoir. Pis, elle tenta de justifier le jugement de Paulette.
À son extrême surprise, ce ne fut pas difficile.
Gab de Sarlat, poli, courtois, habillé avec un goût négligé dans le style gentleman-farmer, disponible pour rendre service, assidu aux offices religieux, peu enclin aux excès de langage ou de pensée, pouvait fasciner autant qu’horripiler. Traditionnel dans ses sentiments, ses discours et son comportement – voire son physique –, il attirait les gens pour les mêmes raisons qu’il en éloignait d’autres, certes peu nombreux : il avait l’air parfait, idéal.
Suspecté par l’instinct de la féroce Paulette, il posa soudain à Gabrielle le même problème que deux ou trois meubles dans sa vie d’antiquaire : original ou imitation ? Soit on voyait en lui un honnête homme soucieux de son prochain, soit on y repérait une imposture.
En quelques semaines, Gabrielle se convainquit qu’elle vivait avec une escroquerie. En prenant une à une les qualités de Gab, elle retournait la carte et découvrait le défaut. Son calme ? La carapace d’un hypocrite. Sa galanterie ? Une façon de canaliser une libido débordante et d’attirer de futures proies. Sa gentillesse envers les sautes d’humeur qui affectaient Gabrielle ? Une indifférence abyssale. Son mariage d’amour, union osée d’un noble avec une roturière ? Un contrat d’argent. Sa foi catholique ? Un costume de tweed en plus, un habit de respectabilité. Ses valeurs morales ? Des mots pour masquer ses pulsions. Soudain, elle soupçonna que l’aide qu’il apportait au magasin – les transports de meubles, soit lors de l’acquisition, soit lors de la livraison – n’était qu’un alibi destiné à lui déblayer du temps libre, assurer des déplacements discrets. Et s’il rejoignait des maîtresses à ces occasions ? Pourquoi, après vingt-sept ans de confiance amoureuse, Gabrielle se laissa-t-elle gangrener par le doute ? Le poison instillé par Paulette n’expliquait pas tout ; sans doute Gabrielle avait-elle du mal, l’âge venant, à affronter les modifications de son corps, l’empâtement contre lequel elle luttait, les rides qui s’approfondissaient, la fatigue plus lourde, l’éclatement de vaisseaux sanguins sur ses jambes naguère si belles… Si elle douta facilement de Gab, ce fut aussi parce qu’elle doutait d’elle, de ses attraits. Elle s’emportait contre lui parce qu’il vieillissait mieux qu’elle, parce qu’il plaisait toujours, parce que les jeunes filles lui souriaient avec plus de spontanéité que les jeunes hommes à Gabrielle. En société, sur la place du marché, à la plage ou dans les rues, il était encore remarqué alors que Gabrielle se trouvait transparente. Quatre mois après le « déclic » de Paulette, Gabrielle ne supportait plus Gab. Elle ne se supportait pas davantage : chaque matin, son miroir lui présentait une étrangère qu’elle détestait, une femme large au cou épais, à la peau couperosée, aux lèvres crevassées, aux bras mous, affectée d’un épouvantable bourrelet sous son nombril que, même en s’affamant, elle n’arrivait pas à diminuer, ses régimes ne contribuant pas à la rendre enjouée. Elle n’allait pas gober que Gab aimait ça ! Qui pouvait aimer ça ? Personne ! Du coup, toutes les douceurs – sourires, attentions, amabilités, gestes tendres – que Gab avait pour elle le reste du jour la blessaient. Quel hypocrite ! Paulette avait tiré dans le mille : un faux cul de la Maison Faux Cul, exemplaire certifié conforme ! Il finit par la dégoûter. Comment peut-on se montrer si mielleux ?
Le seul moment où il ne feignait pas, c’était lorsqu’il s’exclamait, quoique sur un ton affectueux, « ma vieille ». Ça, allez comprendre pourquoi, ça lui échappait ! Gabrielle haïssait ces occasions ; à chaque fois, son dos frémissait comme si on la fouettait.
Elle commença à songer au divorce. Cependant, lorsqu’elle s’imaginait devant un avocat ou ses enfants pour justifier la séparation, elle réalisait qu’elle manquait d’arguments recevables. Ils allaient s’opposer : Gab est merveilleux, comment peux-tu énoncer des bêtises pareilles ? Sa fille aînée serait capable de l’envoyer chez un psychiatre – elle envoyait ses enfants chez le psychiatre. Il fallait s’y prendre autrement.
Elle décida de réunir des preuves contre Gab. « Les hommes, avait clamé la péremptoire Paulette, il faut les pousser à bout pour voir ce qu’ils ont dans le moteur. » Variant d’avis sur tout, désirant fréquenter tel restaurant puis refusant, chamboulant à quinze reprises la date ou la destination des vacances, elle multiplia les caprices pour le débusquer et obtenir qu’il sortît de ses gonds. En vain, à chaque occasion, il se pliait à sa nouvelle exigence. Au plus parvint-elle à déclencher un soupir, une lueur de fatigue au fond de ses prunelles le soir où elle se révéla fort odieuse. « Qu’est-ce qu’il a dans la culotte ? » aurait dit Paulette. Ce fut la question qu’elle se posa alors. Au lit, depuis quelque temps, s’ils échangeaient des gestes tendres, plus grand-chose ne se produisait. Certes elle en avait moins envie qu’auparavant, estimant qu’ils avaient copulé à foison et qu’après des décennies, remettre ça, c’est comme passer des vacances au même endroit : lassant. Si elle s’en était accommodée, elle réfléchit et se demanda si cette paix n’avait pas une autre signification pour lui. Ne profitait-il pas de ses excursions en camionnette pour la tromper ? Du coup, elle s’imposa lors de ses voyages. Il s’en déclara ravi et devisa avec entrain pendant les centaines de kilomètres qu’ils parcoururent ensemble ces semaines-là. À deux reprises, il lui proposa de s’arrêter pour faire l’amour, une fois à l’arrière de la voiture, une autre au milieu d’un pré. Bien qu’elle acceptât, elle en fut catastrophée. C’était la preuve ! La preuve qu’en déplacement, il avait l’habitude d’assouvir ses besoins sexuels.
Elle cessa de participer aux expéditions et s’assombrit, communiquant de moins en moins, sauf avec Paulette. Celle-ci se révélait intarissable sur les trompeurs masculins.
— En ce moment, ces crétins sont piqués par leurs femmes parce qu’elles regardent les appels qu’ils composent ou reçoivent sur leur téléphone portable. Je m’attends à ce que les détectives privés défilent dans la rue pour protester contre le tort que le portable occasionne à leur chiffre d’affaires, rayon adultère.
— Et quand l’homme n’a pas de portable ? demanda Gabrielle en songeant à Gab qui refusait qu’elle lui en offrît un.
— L’homme qui n’a pas de portable, méfiance ! Méfiance absolue ! Celui-là, c’est le roi des rois, l’empereur des enfoirés, le prince des abuseurs. Celui-là, il travaille à l’ancienne, il ne veut pas être découvert, il se sert des cabines téléphoniques qui ne laissent pas de traces. Il sait que l’adultère n’a pas été créé avec le portable et il continue les combines éprouvées qu’il a peaufinées pendant des années. Celui-là, c’est le James Bond de la saillie illégitime : tu le traques mais tu ne le coinces pas. Bon courage !
Dès lors, Gabrielle développa une obsession relative à la cachette du troisième étage. Les secrets de Gab devaient être là, les preuves de sa perversité aussi. Plusieurs fois elle s’y rendit avec des outils, désireuse de défoncer le mur ; chaque fois la honte la retint. Plusieurs fois elle essaya d’entortiller Gab en réalisant un numéro de séduction dont le but consistait à le décider à l’ouvrir ; chaque fois, il inventait un nouvel argument pour se dérober : « Il n’y a rien dedans », « Tu vas te moquer de moi », « Il sera toujours assez tôt pour que tu le découvres » « N’ai-je pas droit à mes petits secrets ? », « Ça te concerne mais je ne veux pas que tu saches. » Ces refus contradictoires les uns avec les autres agaçaient Gabrielle au plus haut point, jusqu’à ce qu’il prononçât cette phrase : « Tu le découvriras après ma mort, ce sera bien assez tôt. »
Cet avertissement l’indigna ! Quoi, elle devrait attendre dix ans, vingt ans, trente ans, pour avoir la preuve qu’il s’était moqué d’elle toute sa vie et qu’elle avait partagé son existence avec un arriviste sournois ! Il la provoquait ou quoi ?
— Tu es taiseuse, en ce moment, ma Gabrielle, s’exclamait Paulette lorsqu’elles prenaient un thé ensemble.
— Je ne formule jamais ce qui ne va pas. J’ai été élevée comme ça. Mon père m’a fourré dans la tête qu’on ne devait exprimer que les pensées positives ; les autres, on devait les garder pour soi.
— Foutaises ! Faut t’extérioriser, cocotte, sinon tu vas faire un cancer. Les femmes qui se taisent font des cancers. Moi, je n’aurai pas de cancer parce que je gueule et je râle toute la journée. Tant pis si j’emmerde : je préfère que ce soient les autres qui souffrent plutôt que moi. C’est ainsi que le projet prit forme – se désengluer des doutes, donc supprimer Gab –, projet qui trouva son exécution dans les Alpes.
Les cheveux mouillés, Gabrielle fut ramenée dans sa cellule et s’effondra sur le lit pour continuer à réfléchir. Voilà ce qui s’était passé dans son crâne pendant les trois dernières années de leur couple, voilà ce qu’elle celait à chacun, voilà comment sa vie s’était vidée de sa saveur et de son sens pour se réduire à un cauchemar continu. Au moins, tuer Gab, ce fut agir, en finir avec cette intolérable inquiétude. Elle ne le regrettait pas. Or, cet après-midi, le témoignage du médecin l’avait violentée : elle avait appris pourquoi Gab se montrait moins sensuel, et la souffrance qu’il en retirait. Cette remarque avait entaillé son bloc de convictions.
Pourquoi ne le découvrait-elle que maintenant ? Auparavant, elle croyait qu’il l’évitait pour consacrer son énergie à ses maîtresses. Cet irresponsable de docteur Racan n’aurait pas pu lui en parler plus tôt ?
— Gabrielle de Sarlat au parloir. Votre avocat vous attend.
Ça ne pouvait pas tomber mieux.
Maître Plissier avait posé sur la table les quatre boîtes en fer.
— Voilà ! Maintenant, expliquez-moi.
Gabrielle ne répondit pas. Elle s’assit et ouvrit, vorace, les couvercles. Ses doigts agitèrent les papiers qui gisaient à l’intérieur, puis en tirèrent certains pour les déchiffrer, d’autres encore, d’autres…
Après quelques minutes, Gabrielle tomba sur le sol, prostrée, suffoquant. Maître Plissier alerta les gardiennes, lesquelles l’aidèrent à déplier la prisonnière, l’obligèrent à respirer. Une civière
emporta Gabrielle à l’infirmerie où on lui administra un calmant.
Une heure plus tard, ayant retrouvé son souffle, elle demanda où était passé son avocat. On l’informa qu’il était reparti avec les boîtes pour se préparer à l’audience. Après avoir supplié qu’on lui donnât un sédatif, Gabrielle sombra dans l’inconscience. Tout plutôt que penser à ce que recelaient les coffrets métalliques.
Le lendemain, eurent lieu les plaidoiries. Gabrielle ressemblait à son vague souvenir, pâle, hagarde, l’œil humide, le teint brouillé, les lèvres exsangues. Aurait-elle voulu attendrir les jurés, elle n’aurait pu mieux s’arranger.
L’avocat général tint un réquisitoire plus volontaire que dur qui n’impressionna guère. Puis Maître Plissier, les manches frémissantes, se leva tel un soliste appelé pour son morceau de bravoure.
— Que s’est-il passé ? Un homme est mort en montagne. Éloignons-nous de l’acte et considérons les deux versions opposées qui nous réunissent devant la cour : accident, dit son épouse ; assassinat, prétend un berger inconnu. Éloignons-nous davantage, mettons-nous très loin, à peu près aussi loin que le berger, si c’est possible de distinguer quelque chose avec un tel recul, et cherchons maintenant les raisons d’un meurtre. Il n’y en a pas ! En général, il m’est difficile d’exercer ma fonction d’avocat car je défends une personne que tout accuse. Dans le cas de Gabrielle Sarlat, rien ne l’accuse, rien ! Ni motifs ni mobiles. Pas d’argent en jeu. Pas de conflits de couple. Pas de trahisons. Rien ne l’accuse sauf un. Un homme. Enfin, un homme qui vit avec les bêtes, un garçon qui ne sait ni lire ni écrire, rebelle au système scolaire, incapable de s’insérer dans la société sinon en s’en isolant. Bref, ce berger, un employé qu’il me serait aisé de charger car il a été renvoyé par différents patrons, un travailleur qui ne donne satisfaction à personne, un mâle sans femmes ni enfants, bref, ce berger l’a vue. À quelle distance se tenait-il ? Ni à deux cents mètres, ni à trois cents mètres, ce qui déjà handicaperait la vue de n’importe qui, mais à un kilomètre et demi, selon les données de la reconstitution ! Soyons sérieux, mesdames et messieurs, que voit-on à un kilomètre et demi ? Moi, rien. Lui, un crime. Fabuleux, non ? De plus, après avoir constaté l’attentat, il ne se précipite pas au chevet de la victime, il n’appelle ni les secours ni la police. Pourquoi ? Selon ses allégations, parce qu’il ne peut pas abandonner son troupeau. Voilà un individu qui assiste à l’assassinat de son prochain mais qui continue à penser que la vie d’animaux – qui finiront en brochettes – compte davantage… Je ne comprends pas cet homme, mesdames et messieurs. Ce ne serait pas grave s’il ne montrait du doigt une femme admirable, une épouse intègre, une mère accomplie, en l’incriminant de la dernière chose qu’elle eût souhaitée, la mort de son Gabriel, Gabriel surnommé Gab, l’amour de sa vie. Il se tourna, violent, vers les bancs des jurés.
— Alors, vous m’objecterez, mesdames et messieurs les jurés, que rien n’est jamais simple ! Même si chacun témoigne de leur amour si fort et si visible, que se passait-il derrière les crânes ? Cette femme, Gabrielle de Sarlat, avait peut-être la tête pourrie de soupçons, de jalousie, de doutes. Qui nous prouve qu’elle n’avait pas déployé une névrose paranoïaque à l’égard de son conjoint ? Outre tous les témoins que vous avez entendus ici qui n’ont pas laissé la moindre prise à une telle théorie, je voudrais ajouter, mesdames et messieurs, mon propre témoignage. Savez-vous ce que cette femme a fait, hier soir ? Connaissez-vous la seule faveur qu’elle m’ait demandée en deux ans et demi de détention préventive ? Elle m’a supplié de lui apporter quatre boîtes de biscuits dans lesquelles elle entreposait, depuis trente années, leurs lettres, ainsi que les souvenirs de leur amour. Tout s’y trouve, depuis les billets de théâtre, de concert, les menus des fiançailles, des mariages ou des anniversaires, les petits mots notés au matin et déposés sur la table de la cuisine, du sublime à l’anodin, tout ! Trente ans. Jusqu’au dernier jour. Jusqu’au départ pour ces vacances tragiques. Les gardiennes vous confirmeront qu’elle a ensuite passé des heures à pleurer en songeant à celui qu’elle avait perdu. Je vous le demande et je finirai par cette question : un assassin fait-il cela ?
Gabrielle s’effondra sur sa chaise pendant que ses enfants, ainsi que les âmes les plus sensibles de l’auditoire, retenaient avec peine leurs larmes.
La cour et le jury se retirèrent pour délibérer.
Dans le couloir où elle attendait sur un banc à côté de Maître Plissier, Gabrielle songeait aux lettres qu’elle avait feuilletées la veille. Celle qui révélait que, dès leur jeunesse, il l’appelait « ma vieille » : comment avait-elle pu l’oublier et prendre ce mot pour une cruelle moquerie ? Celle où il la décrivait, vingt-cinq ans auparavant, comme « ma violente, ma sauvage, ma secrète, mon imprévisible » : voilà ce qu’il pensait de celle qui le tuerait, « violente et imprévisible », comme il avait raison, le pauvre. Ainsi, il l’avait vraiment aimée telle qu’elle était, avec son caractère emporté, ses rages, ses colères, ses cafards, ses ruminations, lui si paisible que ces tempêtes l’amusaient.
Ainsi, le secret de son mari, c’était elle.
En imagination, elle avait détruit leur amour. Hélas, ce n’était pas en imagination qu’elle l’avait balancé dans le vide.
Pourquoi avait-elle donné tant d’importance à Paulette ? Comment avait-elle pu descendre au niveau de cette femme sordide, qui déchiffrait l’univers de façon abjecte, mesquine ? Non, trop facile, ça, d’accuser Paulette. C’était elle, la coupable. Elle, Gabrielle. Rien qu’elle. Son plus puissant argument pour perdre confiance en Gab avait été celui-ci : « Il est impossible qu’un homme aime la même femme plus de trente ans. » Maintenant, elle comprenait que le véritable argument, tapi sous le précédent, avait plutôt été : « Il m’est impossible d’aimer le même homme plus de trente ans. » Coupable, Gabrielle de Sarlat ! Seule coupable !
Sonnerie. Cavalcades. Agitation. L’audience reprenait. On avait l’impression de retourner aux courses après un entracte.
— À la question : « Les jurés estiment-ils que l’accusée a attenté volontairement à la vie de son mari ? », les jurés ont répondu non à l’unanimité. Un murmure d’approbation parcourut la salle. — Aucune charge n’est donc retenue contre Gabrielle de Sarlat. Madame, vous êtes libre, conclut le juge.
Gabrielle vécut la suite dans le brouillard. On l’embrassa, on la congratula, ses enfants pleurèrent de joie, Maître Plissier paradait. Comme remerciement, elle lui déclara qu’en l’entendant plaider, elle avait ressenti en profondeur ce qu’il disait : il était impossible, impensable, qu’une femme aussi favorisée et épanouie par son mariage ait accompli ce geste. En son for intérieur, elle ajouta que c’était une autre, une étrangère, une inconnue sans rapport avec elle.
À ceux qui lui demandaient comment elle comptait occuper son temps dans les jours qui venaient, elle ne répondit rien. Elle savait qu’elle devait entreprendre le deuil d’un homme merveilleux. Ignoraient-ils qu’une folle, deux ans et demi auparavant, lui avait enlevé son mari ? Pourrait-elle vivre sans lui ? Survivre à cette violence ?
Un mois après son acquittement, Gabrielle de Sarlat quitta sa demeure de Senlis, repartit dans les Alpes et loua une chambre à l’Hôtel des Adrets, non loin de l’hôtel Bellevue où elle était descendue avec son mari la dernière fois.
Le soir, sur l’étroit bureau en pin blanc qui jouxtait son lit, elle écrivit une lettre.
Mes chers enfants,
Même si ce procès s’est achevé par la proclamation de mon innocence et a reconnu l’impossibilité où j’étais de tuer un homme aussi merveilleux que votre père Gabriel, le seul homme que j’aie jamais aimé, il m’a rendu encore plus insupportable sa disparition. Comprenez mon chagrin. Pardonnez mon éloignement. J’ai besoin de le rejoindre.
Le lendemain, elle remontait au col de l’Aigle et, du chemin où elle avait poussé son mari deux ans et demi plus tôt, elle se jeta dans le vide.
FIN



/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F56%2F94%2F1142505%2F126620607_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fp0.storage.canalblog.com%2F08%2F11%2F1142505%2F126465232.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F08%2F11%2F1142505%2F126465232_o.jpg)