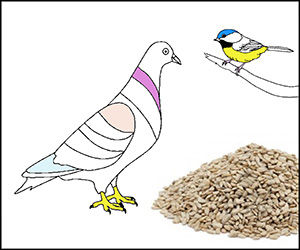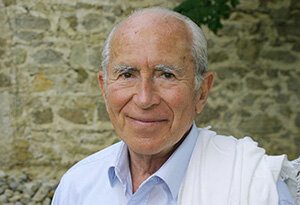Charles Ferdinand Ramuz
SI LE SOLEIL NE REVENAIT PAS
Bibliothèque numérique romande ebooks-bnr.com
Cette édition se réfère à l’édition Mermod (1941) pour laquelle C. F. Ramuz a effectué un important travail de correction et voire de réécriture du texte original. La bibliothèque numérique romande dédie cette édition numérique de « Si le soleil ne revenait pas » à Donald Barr-Wells, décédé le 6 février 2018.
◄►
I
Vers les quatre heures et demie, ce jour-là, Denis Revaz sortit de chez lui. Il boitait assez bas.
C’était son genou qui n’« allait pas », comme il disait ; et on lui disait : « Comment va votre genou ? » il répondait : « Il ne va pas fort. »
Ainsi il a longé non sans difficulté la petite rue qui traverse le village, et on l’a vu ensuite s’engager sur sa gauche dans un sentier qui menait à une vieille maison.
À peine si on l’apercevait encore dans l’ombre, cette maison ; on distinguait pourtant que c’était une maison de pierre avec un toit couvert en grosses dalles d’ardoise, et il se confondait par sa couleur avec la nuit, mais est-ce bien la nuit ? ou est-ce le brouillard ? ou encore autre chose ? parce qu’il y avait déjà plus de quinze jours que le soleil était disparu derrière les montagnes pour ne reparaître que six mois plus tard.
Et puis c’était ce genou qui n’allait pas.
Revaz s’était arrêté pour laisser se calmer un instant la douleur ; alors, dans l’obscurité grandissante, par l’ouverture des fenêtres qu’il y avait sur le devant de la maison, une lueur roussâtre s’était mise à bouger comme une aile de chauve-souris.
Ces fenêtres n’avaient ni contrevents, ni rideaux, tandis que la façade elle-même, traversée par une large lézarde, faisait penser à une page de cahier qu’on aurait biffée à la plume ; et c’est dans le bas de cette façade qu’on voyait cette lueur monter, descendre, paraître, disparaître, comme un lambeau d’étoffe déteinte qu’on aurait agité derrière les carreaux.
Ce qui a fait que Revaz a été tout de suite assuré qu’Anzévui était chez lui (d’ailleurs comment n’y aurait-il pas été ?) et Revaz s’était remis en route malgré son genou malade, mais heureusement que le trajet n’était pas long.
Il est arrivé devant le perron. C’étaient trois marches sur le côté de la maison, et par un bout elles étaient enterrées dans la pente. C’étaient trois marches qui bougeaient sous le pied parce qu’elles étaient descellées ; elles menaient à une vieille porte cintrée dans le haut. Et il n’y avait plus de poignée à la porte ; c’était une grosse ficelle qui faisait manœuvrer à l’intérieur le loquet, car tout était ancien ici et ruiné, devant quoi Revaz s’était arrêté, ayant fait du bruit avec ses gros souliers à clous sur les marches de schiste ; pourtant on n’avait pas bougé dans la maison.
Il a cogné du poing contre la porte.
— Antoine Anzévui, êtes-vous là ?
On ne répondait pas :
— C’est moi Revaz, Denis Revaz ; est-ce qu’on ne pourrait pas entrer ?
Cependant il ne tirait toujours pas sur la cordelette et ainsi a dû attendre encore qu’on se levât à l’intérieur, comme il a entendu enfin qu’on faisait au bruit d’un meuble qui a été déplacé ; puis, la porte ayant été lentement tirée, quelque chose de blanc s’est montré dans l’entrebâillement :
— Ah ! c’est toi. Qu’est-ce que tu veux ?
— Je voudrais vous parler.
Alors la porte s’était ouverte toute grande, de sorte que Revaz n’avait eu qu’à entrer.
Au premier moment, on ne voyait rien ; puis on voyait qu’il y avait un feu qui brûlait sur le foyer.
Ensuite on voyait qu’il y avait un grand manteau qui s’avançait hors du mur vers le milieu de la pièce et, sous l’avancement, une vieille table de noyer était couverte de toute espèce d’objets disposés dessus pêle-mêle, tandis qu’un fauteuil à siège de paille défoncé était tiré entre elle et le feu.
La porte s’était refermée ; Anzévui s’avança devant Revaz en traînant les pieds. Il prit un escabeau qu’il plaça en face du fauteuil devant le feu : « Assieds-toi là », avait-il dit ; ensuite il avait regagné sa place ; mais alors on avait vu qu’elle était occupée par un gros livre à reliure de parchemin veiné de rouge, usée aux nervures, rongée dans les coins, qu’Anzévui souleva avec lenteur et respect, puis posa sur la table, les feuillets en dessous.
Il avait une grande barbe blanche ; il avait de longs cheveux blancs qui lui tombaient sur les épaules.
— Eh bien ? dit-il.
— Antoine Anzévui, dit Revaz, je suis bien fâché de vous déranger. Vous étiez en train d’étudier. Vous êtes un savant ; vous lisez dans les livres. Qu’est-ce que c’est ? c’est-il la Bible ?
Anzévui ne bougeait pas.
Il tenait l’une dans l’autre sur ses genoux ses mains noires ; et, comme il faut du temps pour s’habituer à l’obscurité, c’est seulement à présent que la vue pouvait percer jusqu’aux murs et permettait de distinguer que la pièce où on se trouvait était une très grande pièce. La lueur du feu faisait un demi-cercle sur les dalles disloquées ; elle s’élargissait parfois, gagnant jusqu’aux fenêtres qui étaient percées dans le mur opposé ; et on s’apercevait aussi que cette pièce avait été une très belle pièce, comme il arrive dans nos montagnes où on trouve souvent parmi les petites maisons de bois une de ces grandes maisons de pierre qui ont été bâties par un homme du village de retour au pays après s’être enrichi au service étranger. Seulement, avec le temps, et parce que l’argent a manqué, elles ont été négligées ; c’est ainsi qu’il y avait des trous dans le plafond, que la plupart des carreaux avaient été remplacés par des feuilles de papier d’emballage et que, la fumée du foyer s’étant déposée sur les murs passés à la chaux, il n’y avait dans la chambre qu’une seule tache encore blanche qui était les cheveux et la barbe d’Anzévui.
Anzévui était un homme qui se connaissait en maladies de toute espèce ; on venait de loin lui demander conseil parce qu’il allait chercher des herbes dans les montagnes, et on lui achetait ses herbes, et ses herbes vous guérissaient.
C’était de quoi Anzévui vivait ; c’était également la raison pour laquelle Revaz était venu, ce soir-là ; de sorte qu’il avait repris :
— Écoutez, Antoine Anzévui, il faut me dire si je vous dérange, j’aurais besoin de vos conseils ; j’ai le genou droit qui ne va pas.
— Qu’est-ce que tu t’es fait au genou ?
— Je ne sais pas, dit Revaz, je me le suis maillé. C’est en faisant les regains. C’est déjà vieux, comme vous voyez. J’ai dû faire un faux mouvement… Et, depuis ce temps-là, il ne désenfle pas, bien au contraire ; chaque fois que je bouge, tout est à recommencer.
— Montre-moi ça.
L’autre releva son pantalon. À la lueur du feu, on vit sa jambe qui était maigre, de couleur grise, avec des nœuds de veines vertes, et cependant il tirait sur l’étoffe qui était de la grosse mi-laine brune et résistait ; mais il continuait de la ramener en arrière.
— Vous comprenez, c’est pourquoi je me sers d’un bâton, je peux plus sortir sans bâton, c’est ennuyeux. Je suis comme les vieux. Et c’est pourquoi je me suis dit : « Je vais aller demander conseil à Anzévui », et c’est pourquoi je vous demande : « Qu’en pensez-vous, Antoine Anzévui ? »
Il était penché sur son genou, tenant des deux mains son pantalon ramené sur sa cuisse ; et son genou était comme une grosse betterave rouge, la jambe se renflant brusquement à la place de l’articulation en même temps qu’elle changeait de couleur, puis au-dessous de l’articulation elle s’amincissait de nouveau.
— Approche-toi, dit Anzévui.
Revaz, d’un coup de reins, avança son tabouret, puis l’avança encore un peu, l’autre n’ayant pas quitté son fauteuil, mais sa barbe vint en avant et en même temps il tendait la main ; alors on a été étonné de voir combien elle était précautionneuse et délicate, parce qu’il avait posé le doigt sur la place malade :
— Ça te fait mal ?
Revaz secoua la tête. Anzévui appuya plus fort, plus de côté :
— Et à présent ?
— Un peu.
Et Anzévui :
— C’est pas grand’chose. Je vais te donner une tisane. Tu prends une bonne poignée d’herbe, tu la mets sur le feu avec le contenu d’un verre d’eau ; tu la laisses bouillir un petit quart d’heure. Et puis, quand le liquide est bien réduit, tu l’étends toute bouillante dans un linge, tu te l’appliques sur le genou.
Il s’était levé. Il tendit la main, il vous tournait le dos. On le voit qui mettait la main dans des sacs de papier qui étaient rangés sur le bord de la table, tirant de l’un une poignée d’herbages rosâtres, de l’autre une autre d’herbages jaunes, puis une autre et une autre encore ; il mélangea le tout sur une feuille de journal qu’il tordit aux quatre coins :
— Tu peux seulement rebaisser ton pantalon, disait-il à Revaz.
Et Revaz :
— Combien est-ce qu’on vous doit ?
— Attends de voir l’effet que ça te fera. Tous les soirs, en te mettant au lit, un bon cataplasme bien chaud. Mais ça sera peut-être long et il ne faut pas te décourager … Quand tu seras au bout de la provision, tu n’auras qu’à revenir, si tu n’es pas tout à fait guéri.
Revaz avait rebaissé son pantalon ; Anzévui s’était rassis ; et heureusement qu’il y avait toute une pile de bûches contre le mur tout à côté de la cheminée, parce qu’Anzévui n’avait qu’à tendre le bras pour raviver le feu ; cependant qu’on devinait que Revaz était un peu gêné parce qu’il avait une dette et il aurait voulu s’en acquitter.
— Écoutez, disait-il, écoutez, Anzévui ; j’aimerais mieux si ça ne vous faisait rien…
Mais Anzévui n’a pas paru l’entendre. Anzévui avait repris son livre. Il s’était déplacé légèrement de côté et l’avait tiré à lui non sans peine, car il semblait peser lourd, ce livre, qu’Anzévui retourna de manière à l’avoir sur ses genoux. Il prit également un papier et un crayon qui étaient à côté du livre sur la table ; c’était une page de carnet déchirée tout de travers et un bout de crayon de charpentier, de forme plate, large et mince ; puis voilà qu’il mouillait le bout du crayon entre ses lèvres :
— Tu sais calculer, Revaz… hein ?... tu as l’habitude ? Eh bien, 8 fois 237, combien ça fait-il ?… Moi, je me fais vieux ; j’ai peut-être oublié mon arithmétique.
— Ma foi, dit Revaz, faire ce calcul de tête…
— Tiens. Anzévui lui avait passé le crayon, la feuille de papier ; et Revaz, au bout d’un instant :
— Ça ferait 1896…
— C’est bien ça… Ajoute 41.
— 1937.
— Tu vois, dit Anzévui.
Il avait repris le papier ; il examinait ses propres calculs ; pendant ce temps Revaz cherchait à voir ce qu’il y avait dans le livre, mais, à cause de son inclinaison et parce que, par rapport à lui, le texte en était renversé, il voyait seulement que les pages étaient partagées en deux colonnes, l’une imprimée en noir, l’autre en rouge, avec beaucoup de chiffres et toute espèce de signes qui étaient des croissants, des globes surmontés d’une croix et d’autres qui l’avaient en bas ; des lunes, des circonférences, des triangles.
— C’est bien ça… Et alors 4 et 13 : le 13 du 4… Peut-être que ça se voit déjà. Tu n’as rien remarqué ?…
— À quoi ?
— À l’air, à la couleur de l’air, parce qu’il se pourrait bien qu’il fût déjà malade. Le ciel, dit-il… Parce qu’il est possible qu’il s’assombrisse peu à peu… Les bêtes, parce qu’elles auront peur… Tu comprends ? C’est dans le voisinage du soleil que ça se passe… Tu n’as pas fait attention, ces jours-ci…
— Ma foi, nous autres, c’est bien sûr, on n’est pas tant privilégiés.
Il faut dire que, pour eux, chaque année, vers le 25 octobre, le soleil était vu pour la dernière fois et il ne reparaissait pour eux que le 13 avril. Le 25 octobre, à l’heure de midi, au-dessus de la montagne qui est au sud, il y avait encore une traînée de feu, une vague gerbe d’étincelles comme quand avec un bâton on attise un brasier ; et c’était fini pour six mois. Même quand le ciel est dans toute sa pureté, l’astre est trop bas derrière la chaîne pour s’annoncer autrement à nous que par une certaine coloration plus pâle de l’azur, qui dit qu’il est là, mais il passe sans se montrer.
C’est une commune haut perchée dans la montagne et sur son versant nord : ce qui donne un petit village qui n’a même pas d’église ; et il est accroché là, derrière un premier mamelon, au pied d’un autre mamelon lui-même dominé par des pointes de rocher. D’en bas, du fond de la grande vallée où coule le Rhône, on vous dit : « Vous voyez, là-haut ?… » On ne voit rien. On voit seulement les hautes pentes noires qui se dressent, moussues de taillis, barbues de sapins, tachées de gris de place en place par l’affleurement des roches qui sont suintantes d’humidité ; coupées par des gorges et à d’autres endroits couturées par d’énormes tubes d’acier où l’eau fait une chute de quinze cents mètres pour faire tourner les turbines des usines électriques qui sont dans le bas ; mais on a beau renverser la tête, on ne voit pas autre chose. Alors les gens vous disent : « Plus à droite. Là où la montagne fait avancement parce qu’il y a une vallée derrière. Juste sur la crête, vous voyez. Il y a une encoche dans la crête. Eh bien ?… » Alors on finit par apercevoir, entre les pointes des sapins qui font comme les dents d’une scie, une petite tache grise qui se confond presque tout d’abord avec la terre et les prés d’alentour ; c’est les toits couverts de bardeaux qui empruntent à la roche sa couleur. C’est les cent habitants à peine de Saint-Martin d’En Haut où ils n’ont même pas d’église, mais descendent pour la messe à Saint-Martin d’En Bas ; c’est presque séparé du monde par l’hiver, c’est séparé du soleil tout l’hiver à cause de la hauteur de la montagne.
— Et justement, a dit Anzévui, ce qu’il faudrait savoir, c’est si on ne va pas en être séparé pour toujours.
— On n’est pas tellement privilégiés, disait Revaz, mais enfin quoi ? on prend patience…
— Tu as pourtant refait les calculs et tu es arrivé au même résultat que moi… Eh bien, je vais te dire, parce que tu n’as pas compris. Eh bien, dans le livre, il y a une guerre ; – il y a justement une guerre à présent. Mais il y a aussi une guerre dans la région du soleil. 1896 et 41, ça fait le compte. Il est dit aussi, dans le livre, que le ciel s’obscurcira de plus en plus et, un jour, le soleil ne sera plus revu par nous, non plus seulement pour six mois, mais pour toujours.
Revaz demande :
— Rien que pour nous ?
— Pour tout le monde.
Un petit vent s’était mis à souffler ; il descendait dans la cheminée où il faisait tourbillonner la cendre mêlée à la fumée, tout en poussant par moment une espèce de long soupir.
Un petit vent s’était mis à souffler. Il passait par-dessous la porte, faisant bouger sur la table le bord redressé des sacs en papier qui craquaient ; il passait sur le toit où il déplaçait par moment de menus cailloux ronds qu’on entendait rouler tout le long de sa pente ; et Revaz : « Ah ! » et Revaz : « J’ai pas bien compris. Vous étudiez dans des livres. C’est-il écrit dans vos livres que le soleil ne reviendra pas ?… »
Il semblait à la fois effrayé et incrédule ; c’était un assez gros homme, d’une cinquantaine d’années :
— Voyons, c’est pas possible, depuis le temps qu’il fait son même tour.
— Savoir.
— Depuis le temps qu’il est habitué à nous et nous habitués à lui. Et, l’hiver, je sais bien, il nous quitte, mais ce n’est que pour un temps ; il ne nous quitte pas pour dire, il s’écarte seulement de nous…
— Il s’écartera tout à fait.
— On avait fait amitié avec lui et il nous était bien utile.
— Eh bien, il faudra apprendre à s’en passer.
— Alors quoi ? il fera nuit ?
— Voilà, disait Anzévui, c’est un dérangement qu’il y aura dans les astres ; c’est une maladie que feront les étoiles. Qu’est-ce que tu veux ? c’est écrit. Seulement, disait-il, l’important est que les calculs soient justes. Je me demandais si je ne m’étais pas trompé. Mais du moment qu’on les a faits ensemble.
Il disait :
— Veux-tu qu’on recompte ?
II
Revaz était rentré chez lui et, ayant déposé le paquet d’herbages sur la table de la cuisine, il avait dit à sa femme : « Tu en mettras une poignée dans un verre d’eau que tu feras bouillir pendant une demi-heure. C’est pour mon genou. »
— Où as-tu été ?
— Chez Anzévui.
Il avait dit ensuite :
— Et Lucien, où est-il ?
— Tu sais bien.
— Oh ! avait-il dit, c’est pas le moment de fréquenter ; il faudra que je lui en touche un mot…
Et la femme de Revaz aurait bien voulu l’interroger plus longuement, mais il avait déjà passé la porte. Lucien, c’était son fils qui avait une bonne amie ; et, lui, il avait dit : « C’est pas le moment. » Il sort, il faisait nuit ; le jour était tout à fait tombé. Toute espèce de lumière s’était finalement éteinte à la hauteur du sommet des montagnes, là où le soleil se couche sans qu’on puisse le voir d’ici, mais il s’y marque d’ordinaire par des taches rouges comme des traces de sang sur un linge. Ce soir-là, le ciel était uniformément noir. Seule, de-ci de-là, à une petite fenêtre ou à une des rangées de petites fenêtres qui étaient alignées, les unes au-dessus des autres, sur le devant des maisons, la lumière d’une lampe indiquait à peu près la direction de la rue ; sans quoi on eût été comme l’aveugle et tout à fait privé de la faculté de se conduire ; de même qu’on n’entendait rien, mais rien du tout, les gens s’étant enfermés chez eux et ayant mis entre eux et vous l’épaisseur de la porte bien fermée, l’épaisseur de leurs doubles fenêtres. C’est une petite rue, longue d’une cinquantaine de mètres au plus, où beaucoup de passages aboutissent, serpentant entre les fenils et ce qu’ils appellent des raccards, qui sont des espèces de remises où ils logent leurs provisions ; c’est une centaine de bâtiments, dont une vingtaine habités, lesquels pour la plupart bordent la rue. Quelques-uns ont deux et même trois étages, étant bâtis en beau bois de mélèze sur un soubassement de pierre passé à la chaux, mais ils étaient eux-mêmes couleur d’ombre et de nuit, ajoutant encore à l’obscurité.
Revaz s’avançait avec lenteur et précautions, à cause de son genou malade, faisant un bruit sourd avec sa canne, au milieu de ce petit village dont on dirait qu’on l’a serré entre ses mains pour en réduire le volume, avant de le poser là-haut dans la montagne, hors du monde. Il y fait d’habitude une petite tache ronde ; – à cette heure, on n’aurait même pas su qu’il existait sans la vitrine du café à Pralong.
Il y avait dans le café plusieurs lampes électriques qui donnaient une forte lumière sur les murs revêtus d’une boiserie passée au copal et sur les quatre tables entre lesquelles la grosse Sidonie s’essuyait justement les mains à son tablier. Plusieurs lampes, une T.S.F., quatre tables ; et, par une porte ouverte, on voyait la cuisine qui servait de comptoir.
Sidonie riait à cause d’une voix de femme qui sortait de la boîte en bois poli où il y avait des découpures en forme de feuillages, garnies à l’intérieur d’un fin treillis métallique (est-ce pour empêcher les mouches d’entrer ?) pendant que les hommes écoutaient d’un air sérieux : ils étaient six.
« … toi, tu t’la mettras sur la tête,
moi, je m’la mets dans l’estomac. »
C’était fini. Revaz posa sa canne dans un coin. Une autre grosse voix se fit alors entendre ; elle parlait du nez ; et voilà que Morand disait : « Il a le rhume. » C’était une conférence sur la musique chinoise. Les hommes se sont tournés vers Revaz ; ils lui ont dit : « Comment vas-tu ? » Morand, Follonnier, Lamon, Antide ; Morand Ernest, Follonnier Placide, Lamon Érasme, Antide Augustin ; c’est-à-dire quatre hommes d’âge et un jeune ; et il y en avait encore un dont on ne voyait pas la figure, parce qu’il la tenait penchée vers la table où ses bras étaient posés l’un sur l’autre.
— Ça ne marche toujours pas, ton genou ? disait Follonnier.
— Pas tant.
— Je sais ce que c’est ; quel âge as-tu ?
— Cinquante et un.
— Eh bien, c’est l’âge.
— C’est pas des maladies, disait Follonnier, c’est qu’on s’use. On est comme les outils qui ont trop servi ; il y a toujours une place où ça frotte plus qu’aux autres.
Revaz s’était assis avec un soupir.
— Vois-tu, les genoux, ça nous porte ; les genoux, c’est la charnière. Et, dans un pays comme le nôtre, tout en bosses et en creux, ça travaille, la charnière. Le mal se met aux places qui travaillent le plus. Par exemple, ceux qui boivent, c’est le coude. Ceux qui sont trop retenus d’argent, c’est les boyaux.
Il parlait et riait beaucoup : c’était un homme de bonne humeur et la grosse Sidonie s’amusait ; mais Revaz gardait une figure soucieuse, n’ayant même pas regardé Follonnier à qui il a dit seulement : « Je voudrais t’y voir. »
Et il y avait Arlettaz qui ne disait rien.
C’est ainsi qu’ils ont été ensemble, chez Pralong, s’y étant retrouvés comme souvent l’hiver où les soirées sont longues ; dès cinq heures on n’y voit plus, et même avant cinq heures, quand le ciel est bouché, comme il l’avait été particulièrement aujourd’hui ; alors ils sont là de six à neuf heures et soupent au retour, si le cœur leur en dit, mais le vin est nourrissant, de sorte que les femmes ne les attendent même pas ; ils les trouvent le plus souvent couchées quand ils reviennent, se couchant alors eux-mêmes à leur côté dans le grand lit pour une nouvelle nuit qui est retranchée de leur vie, comme quand on arrache un feuillet à un livre qui n’en a déjà plus beaucoup.
Ils sont, pour le moment, chez Pralong, ils parlent de leurs affaires en buvant un litre ou deux de muscat. Ils discutent sur le prix des mulets et des vaches, s’il est à la hausse ou à la baisse, s’il faut vendre ou bien acheter ; sur la qualité du regain, sur le taux des prêts hypothécaires, sur les prochaines élections, sur les nouvelles de la guerre, car il y a toujours des guerres (il y en avait une en Espagne, cette année-là) ; et, à présent que cette télégraphie sans fil existe, de temps en temps, ils se taisent pour écouter les nouvelles.
C’est une voix qui vient on ne sait pas d’où, née de nulle part ou de partout, née de rien, fille du néant. C’est de la musique, des violons, des trompettes, des tambours ; c’est une femme, une foule, des canons qui tonnent, des fusils qui partent, dix mille hommes ou un seul, le bruit du vent, le bruit des vagues. Et ce bruit a été d’abord des choses, mais elles ne sont plus pour nous que du bruit. L’oreille n’en distingue même pas le point d’origine. Son plus ou moins d’intensité est sans signification quant à la distance qu’il a parcourue, les lieues ne le fatiguent pas, il est insoucieux des myriamètres ; de sorte qu’il est faible et on vous dit : « C’est Genève », il a toute sa force, mais il vient de New-York. Dans la montagne, l’écho dévie bien les sons et, en les répercutant, les entrecroise, faisant venir de la paroi opposée le son qui y a été projeté ; mais les yeux ont vite fait de vous renseigner quand même sur sa provenance réelle, parce qu’on est soi-même une réalité dans un monde qui lui aussi est quelque chose de réel ; – ici, dans cette salle à boire, les clients avaient eu beau se pencher au commencement sur la boîte, cherchant à distinguer par les ouvertures comment c’était fait en dedans et à connaître le truc ; ils ont eu vite fait de voir qu’il n’y avait rien à voir, point de rouleaux, ni de rouages, ni de disque, ni d’aiguille, rien que des lampes, et c’était la grosse Sidonie qui décidait d’un simple mouvement des doigts quel pays allait se faire entendre : une femme comme nous ; de sorte qu’ayant connu le miracle, du même coup ils l’avaient accepté.
Maintenant ils n’écoutaient même plus ce que disait le poste qui était comme un robinet et le matin on ouvrait le robinet. C’était Revaz qu’on écoutait, parce qu’il s’était mis finalement à répondre à Follonnier.
Il lui disait :
— Je voudrais t’y voir. Regarde-moi ça.
Il avançait son genou dans la direction de Follonnier :
— Tâte seulement, c’est comme une tête d’enfant ; à peine si je peux plier la jambe.
— C’est du rhumatisme, disait Lamon.
— Du rhumatisme ? j’en ai dans l’épaule, elle n’a pas enflé, tandis que, ce genou, à mesure qu’on s’avance dans la journée, il devient plus gros, il devient plus lourd, il devient plus chaud… Alors…
On voyait qu’il avait quelque chose à dire, et il hésitait à le dire, mais il ne pouvait pourtant pas ne pas le dire :
— Eh bien, oui, dit-il, j’ai fini par aller demander conseil à Anzévui.
Follonnier éclata de rire.
— Et il t’a donné de ses plantes ?
— Oui, des compresses à faire tous les soirs.
— Bien entendu.
— C’est un savant, disait Lamon.
— Oui, il s’entend à profiter du monde.
— C’est un savant, disait Morand.
— Il sait des choses qu’on ne sait pas, nous autres, disait Revaz.
Arlettaz ne disait toujours rien.
— Il étudie dans des gros livres.
Et Augustin écoutait et Revaz :
— Et même, quand j’ai été le trouver, il était en train de lire dans un de ses livres, il faisait des calculs…
— Des calculs sur quoi ? demanda Follonnier.
— Des calculs sur le soleil.
Alors Follonnier se mit à rire plus encore, et les autres devenaient attentifs, tandis que la grosse Sidonie, attirée par le bruit, était apparue sur la porte de sa cuisine.
— En tout cas, disait Follonnier, il a toujours su se tirer d’affaire. Il a toujours été sans le sou, mais il a toujours su vous en tirer, à vous, qui n’êtes pourtant pas faciles à vous laisser faire. Il a eu la chance que le monde soit fait pour une bonne moitié de femmes, hein ? avec ses herbes et ses tisanes…
— C’est pas ça, disait Revaz.
— Et qu’il y ait eu des filles qui avaient des inquiétudes à leurs fins de mois…
— C’est pas ça.
— C’est quoi ?
— C’est le soleil.
— Le soleil ?
— Oui.
— Et qu’est-ce qu’il va arriver au soleil ?
— Du pas tant bon, dit Revaz.
Il avait ramené à lui sa jambe qu’il tenait allongée sous la table et prit son verre et son autre jambe était pliée à angle droit ; il a vidé son verre d’un seul coup comme pour se donner du courage ; tout le monde le regardait, sauf Arlettaz, et tout le monde s’était tourné vers lui :
— Eh bien, il dit que le soleil n’en a plus pour longtemps à nous éclairer, nous autres. Il a fait des calculs. Il dit qu’ils donnent 1937 et ils donnent 4 et 13. Ça ne fait plus que quatre ou cinq mois. Et puis alors il s’en ira.
— Qui ça ? Anzévui ?
— Non pas, le soleil.
Follonnier se tapa sur la cuisse. Mais, au même temps, Arlettaz avait relevé sa grosse tête à petits yeux :
— Tant mieux.
— Pourquoi ?
— Je n’aurai plus besoin de la chercher…
— Tu es fou, criait Follonnier, tu es fou, Arlettaz, mais pas tant que le conseiller, et lui pas tellement qu’Anzévui, mais celui-ci on le connaît ! Alors, taisez-vous, disait-il, parce que Revaz n’a pas fini de s’expliquer… Il fit de nouveau claquer sa cuisse :
— Alors ce soleil ?
— Eh bien, je sais pas, moi ; je ne suis pas un savant comme Anzévui ; j’ai pas lu ses livres…
— On te demande seulement de nous dire comment ça se passera, le soleil qui n’éclaire plus. Pourquoi est-ce qu’il n’éclairera plus ?
— Je sais pas, il y a extinction, ou bien c’est nous qu’on cesse de tourner…
— Oh ! justement, disait Follonnier, c’est qu’on tourne et on ne peut pas cesser de tourner. Comment veux-tu qu’on cesse de tourner ?
— Je sais pas.
— On tourne même doublement, parce qu’on tourne autour du soleil et ensuite autour de nous-mêmes, et ça fait la nuit et le jour. Pour qu’il n’y ait plus pour nous que la nuit, il faudrait qu’on soit comme la lune.
— Justement…
— Ou bien que le soleil éclate en morceaux ; comment est-ce qu’il peut éclater en morceaux ? Il faudrait qu’il rencontre une comète.
— Justement.
— Mais il n’y a point de comète… Ou bien qu’il se refroidisse tout à coup et qu’il devienne noir comme quand on pisse dans le feu…
Mais une voix plus forte dans le poste de télégraphie sans fil disait à ce moment : « Événements d’Espagne. Les nationaux approchent de Malaga… Un de leurs détachements s’avance par la route qui longe la mer, l’autre vient de déborder la ville en passant par la montagne… La prise de Malaga ne semble plus être qu’une question de jours. »
C’est ce qui a encouragé Revaz :
— Il m’a dit (c’est Anzévui) qu’il y aurait une guerre et qu’avant la fin de cette guerre, le soleil se détournerait de nous. Et c’est tout ce que je sais, mais je voulais vous en prévenir, parce que, si par hasard Anzévui avait dit vrai, il ne serait pas mauvais qu’on le sache à l’avance. Il y aurait peut-être des précautions à prendre.
— Quelles précautions ? mon pauvre ami.
— Je sais pas, s’enfermer chez soi, faire des provisions.
— Mon pauvre vieux, tu serais tout de suite gelé.
— Justement, si on avait assez de bois, on pourrait attendre…
— Attendre quoi ?
— Qu’il revienne.
— Moi, dit Arlettaz, j’espère qu’il ne reviendra pas, ça m’arrangerait bien qu’il ne revienne pas.
C’est que depuis deux ans il courait le pays à la recherche de sa fille, une grande belle fille de dix-neuf ans, qui avait quitté la maison ; et elle avait laissé sur la table de la cuisine un billet où elle avait écrit qu’elle allait chez une cousine qu’elle avait à Sion. Et lui, Arlettaz, une ou deux semaines plus tard, avait été à Sion pour la voir ; elle n’y était déjà plus. La cousine avait ri. « Oh ! elle n’est pas restée longtemps chez moi ; pas moyen de la retenir. » — « Et où est-elle ? » — « Je ne sais pas. » Alors Arlettaz s’était mis à chercher sa fille partout, étant absent de chez lui des semaines entières et reparaissant tout à coup ; il avait été jusqu’à un des bouts du pays, du côté allemand, et jusqu’au glacier du Rhône : il ne l’y avait pas trouvée ; et, de l’autre côté, jusque par-delà Saint-Maurice, tout aussi inutilement ; – tandis qu’il tournait maintenant vers vous dans une figure tout en plis et de parmi sa grosse barbe, deux petits yeux bleus étonnés :
— Ça serait enfin le repos ; et pas seulement pour les jambes, disait-il, parce qu’il n’y a pas seulement les jambes qui se fatiguent, mais l’esprit aussi, à cause qu’on est tout le temps forcé de penser et d’imaginer…
Car ça va faire près de trois ans ; et sa tête était retombée.
Follonnier, par deux fois, hausse les épaules, mais il était peut-être le seul à être tout à fait d’aplomb, une vague inquiétude ayant gagné tous ceux qui étaient là, y compris Augustin ; et Augustin disait :
— Enfin, il faut bien dire qu’il fait un drôle de temps, cet hiver. C’était un jeune homme.
— Vous ne trouvez pas ? depuis un ou deux mois, depuis qu’on n’a plus revu le soleil… Mais enfin, ça, c’est dans la règle. Ce qui ne l’est pas, hein ? c’est ce brouillard, ce plafond qu’on a sur la tête. Peut-être bien qu’Anzévui a raison ; peut-être bien que le soleil s’affaiblit…
— Voyons, dit Follonnier, il ne faudrait pourtant pas qu’on en oublie de boire ; qu’en dis-tu, Arlettaz, toi qui n’aimes pas le goût de l’eau ?…
Mais il ne semblait pas qu’on l’écoutât et même la grosse Sidonie sur le seuil de sa cuisine s’était tournée vers Augustin à qui on répondait :
— Ma foi, peut-être bien.
— Moi, disait Morand, tout ce que je sais, c’est qu’Anzévui est un homme qui a de l’instruction et beaucoup… Et, après tout, ce qu’il annonce, oui, ses prédictions…
— Je pense, moi aussi, que la chose est possible, disait Lamon, et même très possible, bien que ça ne se soit jamais vu, mais je dis que c’est un savant…
« Mesdames, Messieurs, veuillez écouter les prévisions météorologiques pour demain : Temps incertain… Précipitations dans la plaine, brouillard sur la montagne… Température douce… Les taches que l’on constate dans le soleil seront peut-être la cause de troubles assez inhabituels en cette saison. »
— Tu entends, des taches dans le soleil, disait Revaz.
— Hein ? des taches dans le soleil, disait Arlettaz.
Pendant ce temps, elle attendait son mari, et s’impatientait à l’attendre ; ils n’étaient mariés que depuis six mois. C’était Isabelle Antide, la femme d’Augustin. Elle l’attendait dans leur chambre à eux, toute boisée de beau mélèze neuf, avec la lumière électrique et, autour de l’ampoule, un abat-jour en perles roses.
Elle était assise sur une chaise à côté du grand lit recouvert d’une guipure à fond grenat, qui était un cadeau de ses amies de noces ; elle se disait : « Qu’est-ce qu’il peut bien faire ? »
À ce moment, Augustin avait voulu se lever de dessus son banc chez Pralong ; on lui avait dit :
— Tu es bien pressé.
Elle, elle se tenait à côté du grand lit et, autour d’elle, sur le mur, il y avait toute leur parenté en agrandissements ou simples portraits photographiques : sa mère à elle dans un cadre noir à filet d’or, un cousin qui était gendarme, un cousin qui était sergent dans l’armée, un cousin qui était dans les chemins de fer, tous les trois en uniforme ; et il y avait encore un tableau représentant sainte Cécile, en robe de satin bleu, qui levait ses belles mains à hauteur de sa figure, les doigts à demi engagés entre les cordes de l’instrument.
C’est une harpe à pédales.
Augustin s’était levé de nouveau, chez Pralong ; on lui avait dit : « Attends un moment. » Mais alors Follonnier s’était mis à rire : « Laissez-le faire ! On sait bien pourquoi il est si pressé. » On avait laissé aller Augustin.
Et eux, dans le café, avaient repris leur discussion ; lui, il avait été un instant dans la nuit, puis la porte de la chambre s’était ouverte d’elle-même en haut de l’escalier de bois parce qu’elle, elle était derrière ; et c’est elle qui l’a reçu sous la lumière de la lampe avec la lumière de ses yeux.
— Ah ! te voilà enfin.
Mais, tout de suite :
— Qu’est-ce que tu as ?
On leur avait bâti une petite maison à côté de la vieille où habitaient le père et la mère Antide ; on l’avait bâtie tout exprès pour eux l’été d’avant, avec une chambre et une cuisine au rez-de-chaussée, et deux chambres encore au-dessus.
— J’ai rien.
— Que si, dit-elle, je vois qu’il y a quelque chose qui ne va pas.
— Ah ! c’est que c’est un savant, dit-il.
Elle avait la figure comme l’abricot quand il est bien mûr.
— Qui est-ce qui est tant savant que ça ?
Elle l’avait pris par le cou ; elle l’avait fait tomber sur une chaise ; elle s’est assise sur ses genoux.
Augustin a dit :
— Il lit dans les livres.
Et elle :
— Qui ça ?
— Anzévui.
— Et alors ?
— Alors, dit-il, ça ne va plus aller longtemps, parce que tout va s’arrêter…
— Quand ?
— Bientôt.
Mais elle l’a lâché. Elle s’est mise à rire. « Benêt ! dit-elle. Voyons, Augustin, voyons, est-ce que tu vas croire à ses histoires ?... Je le connais bien, ton Anzévui !… Quand on était petites filles, une fois on était montées à quatre ou cinq chercher des fleurs pour la Fête-Dieu dans le bois de Chassoures ; il y était justement. Tu sais bien, lui, c’est des plantes qu’il cherche ; on l’avait vu de loin qui les cherchait, mais lui ne nous avait pas vues. C’était il y a dix ans peut-être ; oh ! il n’était pas si vieux qu’aujourd’hui. Il avait bien une barbe, mais pas si longue et pas si blanche qu’à présent ; il n’était pas si mal habillé non plus, pourtant on avait déjà peur de lui, nous autres. On s’était cachées derrière des troncs. Et voilà qu’un peu plus loin, il y avait Brigitte, la vieille Brigitte, mais elle n’était pas si vieille non plus, et elle était en train de ramasser du bois. Sais-tu ce qu’il a fait, Anzévui ? il l’a appelée : elle ne voulait pas venir. Il lui disait des choses, oh ! des choses ; il lui disait : « Allons, arrive, on ne sera pas dérangés. » Mais elle lui a tiré la langue. Nous autres, on s’était mises à rire ; on riait même tellement qu’Ambroisine Pralong nous disait : « Taisez-vous, il va nous entendre… » Quant à lui, il s’était mis à courir après Brigitte qui s’était sauvée ; seulement elle avait de l’avance… Tais-toi, dit-elle, tais-toi… Elle le faisait taire avec sa bouche, parce qu’on voyait qu’Augustin avait envie de recommencer à parler. Elle lui mettait les lèvres sur les lèvres ; puis :
— Voilà ce que c’est, ton Anzévui. Ce n’est qu’un homme, et un pas très honnête homme. Tu sais, Ambroisine Pralong, elle a été chez lui, elle, il n’y a pas bien longtemps. Elle avait des tournements de tête ; elle disait : « Je ne sais pas ce que c’est. » Il lui a dit : « Ambroisine, tu as été avec des garçons. » Ah ! comme elle s’amusait en me racontant sa visite. Elle me disait : « Si seulement il avait pu dire vrai, ah ! si seulement c’était ça. » C’est qu’elle a bientôt vingt-quatre ans. « Ah ! disait-elle, il n’a pas été malin… Dieu sait pourtant si je voudrais… Mais on ne sait jamais ce qui peut arriver… » Tais-toi ! Tais-toi, disait-elle. Et en effet le faisait taire ; puis :
— Qu’est-ce que ça peut nous faire, ses histoires ? il est vieux à présent, il est très vieux, il va mourir. Il y a bien longtemps qu’il ne paie plus le loyer de sa maison ; elle lui coule sur la tête ; un de ces jours, elle va tomber. C’est peut-être de sa maison qu’il veut parler ou bien de lui, parce qu’elle ne durera plus guère…
Elle lui disait : « Tais-toi ! » Elle lui mettait un baiser sur un œil, et puis sur l’autre. Elle lui disait : « Tu as les joues douces aujourd’hui, tu es bien rasé. »
Elle lui mettait un baiser sur chaque joue. Et un autre baiser encore plus bas, de sorte qu’il ne pouvait plus rien dire, il ne pouvait que secouer la tête ; pour finir, il n’avait même plus eu la force de la secouer du tout.
III
À quelque temps de là, le fils aîné de Denis Revaz était venu rendre visite à ses parents, parce qu’il travaillait dans les vignes au bord du lac. Il était arrivé le samedi soir ; et, le dimanche, comme c’est la coutume, il avait été faire la tournée des ménages avec qui il était lié d’amitié.
C’est ainsi que, vers les deux heures, il s’était présenté chez Augustin Antide, qui était un peu son cousin. On l’avait fait asseoir ; on lui disait :
— Comment es-tu venu ?
— Avec le camion de la Consommation.
— Jusque où ?
— Jusqu’à Saint-Martin d’En Bas.
— Il n’y a pas trop de neige ?
— Oh ! disait-il, c’est qu’ils ont un bon camion et un bon chauffeur ; c’est un Italien. Il passe partout, par tous les temps. Mais quel drôle de pays que le nôtre ; c’est un pays triste, disait-il. — Et celui de là-bas ?
— Ici, c’est gris ; là-bas, c’est bleu. On a eu le beau, cette année, tout le temps de la vendange. Ici, on n’a point de soleil de tout l’hiver, là-bas ils en ont deux tout le long de l’année. Vous comprenez, ça fait une différence.
On lui disait :
— Deux ?
— Oui, il y a celui qui est dans le ciel et puis celui qui est dans l’eau.
On lui disait :
— Celui qui est dans l’eau ?
— Oui, c’est qu’il y a le lac. Oh ! c’est raide là-bas, c’est encore plus raide qu’ici. C’est une côte au bord de l’eau, c’est comme un côté de baignoire, ça a deux cents mètres de haut. Et la terre n’y tiendrait pas toute seule, mais ils ont fait partout des murs qu’ils ont mis les uns au-dessus des autres, qui la soutiennent ; et où ils cultivent la vigne avec des fossoirs, remontant chaque hiver dans des hottes la terre qui est descendue. Ils sont là, voyez-vous, comme sur des marches d’escalier, et ils sont dans l’air, voyez-vous, parce qu’il y a de l’air partout. Il y a au-dessus d’eux l’air qui est bleu, en face d’eux la montagne qui est bleue, au-dessous d’eux le lac qui est bleu. Le soleil vous tape sur la tête, mais il y en a un autre, celui d’en bas, qui vous tape dans le dos. Ça en fait deux : celui d’en haut, qui est en un point, tout rassemblé ; celui d’en bas qui est tout cassé en morceaux et éparpillé, parce qu’il y a l’eau qui le balance et en bombarde la côte ; ça en fait deux qui chauffent ensemble : c’est pourquoi ils ont du bon vin.
— Alors tu te plais là-bas ?
— Ma foi, disait Julien Revaz, pas tant : vous comprenez, on a l’ennui de chez soi… Ou du moins pas tant jusqu’à hier, et j’étais content de rentrer…
— Et, à présent, tu n’es plus content ?
— Oh ! dit-il, c’est à cause du changement de temps. Jusqu’à Sion, il a fait clair.
— Et depuis Sion ?
— Eh bien, vous voyez… Parce que c’est à Sion que j’ai trouvé le camion, et, jusqu’au Rhône, il a fait clair. Mais, là, il y avait une barre à travers la plaine ; c’était l’ombre des montagnes. Et, jusque-là, il n’y avait pas eu de neige, mais ensuite tout est devenu blanc. En même temps c’est l’air qui a changé, la couleur de l’air, la couleur des choses, parce que vous n’avez plus le soleil. Et il n’y a plus d’eau non plus pour le doubler.
— C’est vrai qu’il fait gris cette année, dit le père Antide.
— Alors, disait Julien Revaz, on est monté ; la route est ouverte jusqu’à Saint-Martin d’En Bas, mais c’est tout juste si le camion peut y passer ; il y a un bon mètre de neige de chaque côté du chemin. Et heureusement encore, dit-il, parce qu’on dérape, mais c’est un bon chauffeur. Je lui disais : « Qu’est-ce que tu transportes ? » — « Du macaroni, du riz, des harengs pour le Carême, du sucre, un sac de café. » Le difficile, c’est les tournants ; il me disait : « Ne fais pas attention. » Et moi, je levais la tête ; eh bien, voyez-vous, il n’y avait plus rien, ni Corne du Diable, ni Dents Rouges, ni Grimpion : rien que comme une voûte de cave avec des taches d’humidité…
— C’est vrai qu’il fait bien couvert cette année, dit la mère Antide.
— Et l’ennuyeux, disait Julien Revaz, c’est qu’on n’ait pas le temps de s’y habituer, oui, disait-il, à ces différences, à ces changements, on va trop vite. J’avais encore le lac dans la tête et les vignes, c’était encore plein de fleurs, dans ma tête, aux fentes des murs : bon, je me sens glisser de côté, tu penches, tu regardes où tu penches, tu vois que tu es au-dessus du vide. C’était au tournant des Goillettes et là, vous savez, on est juste au-dessus de la gorge de la Serine ; vous savez bien, là où le roc fait avancement ; c’est un à pic qui a bien trois cents mètres. Mais, moi, ce n’était pas seulement cet à pic qui m’inquiétait : c’est qu’il faisait gris, c’est qu’il faisait triste… Heureusement qu’on est bien arrivé à Saint-Martin d’En Bas et qu’on y a trouvé de quoi boire.
— Eh bien, dit Isabelle, il te faut reboire. Nous autres, notre soleil est en bouteilles… Hé ! Augustin… Augustin avait été chercher une bouteille et des verres.
— Notre soleil à nous, on le tient à la cave, on n’a pas besoin d’aller loin pour le trouver.
Ils burent ; on a dit à Julien Revaz :
— Comment ça va-t-il chez toi ?
— Justement, ça ne va pas.
— Ça ne va pas ?
— Eh bien, non, ça ne va pas tant bien. Le père se plaint de son genou. Mon frère, eh bien, vous savez qu’il fréquente, mais, là non plus, on ne sait pas bien ce qui se passe, parce que le père est fâché, le père dit : « Ce n’est pas le moment de penser à se marier » ; alors Lucien est obligé de voir sa bonne amie en cachette, et personne n’est content.
Il regardait autour de lui.
— Ils ont mauvaise mine, et, vous, c’est vrai que vous n’avez pas bonne mine non plus, vous êtes tout pâles. Oui, vous, le père Antide, et vous, la mère Antide, et toi aussi, Augustin.
— Et moi ? dit Isabelle.
— Oh ! pas vous.
— Et moi ? dit alors Jean qui était le frère d’Augustin.
— Oh ! pas toi ; et comment est-ce que ça se fait, dit-il, puisque vous vivez tous à l’ombre, qu’il y ait cette différence ? Est-ce l’âge ? Mais tu n’es pas vieux, Augustin. Si vous veniez d’où je viens, vous auriez le soleil écrit sur la figure, parce qu’il va durer, il dure, on ne connaît pas l’hiver là-bas ; le soleil renoue par-dessus l’hiver le temps où les feuilles de la vigne sont jaunes avec celui où les souches pleurent serré et mouillent la terre sous elles, tellement il leur sort d’eau par le travers des bois taillés…
Est-ce parce qu’il avait déjà beaucoup bu, mais il était parti, on ne pouvait plus l’arrêter :
— Il renoue par-dessus l’hiver l’automne au printemps…
— Écoute, disait Augustin.
— Il renoue par-dessus l’hiver les grappes mûres aux grappes vertes : qu’est-ce que vous allez faire sans lui ?
— C’est justement…
Isabelle avait tiré Augustin par la manche. Il n’en continuait pas moins :
— Tu ne sais pas encore, il y a du nouveau… Il paraît que ça ne va pas…
Isabelle lui a mis la main sur la bouche, mais il a fait un brusque mouvement en arrière :
— Le soleil… Sa voix a été étouffée de nouveau ; il reprend :
— C’est Anzévui, il est savant, eh bien…
Il tenait à présent Isabelle par les poignets :
— Il dit qu’il ne reviendra pas, le soleil, et que c’est écrit dans ses livres.
— Alors, avait dit Julien Revaz, tu y crois, à ses histoires ?… Oh ! disait-il, ça ne m’étonne pas que tu y croies : un pays comme le nôtre, un pays pauvre, un pays triste, un pays où il n’est pas là pendant six mois. Ça vous donne des idées.
— Et moi, dit Brigitte, j’ai vu Anzévui.
Elle était là depuis un moment, mais personne n’avait fait attention à elle. Elle était tout habillée de noir, avec un mouchoir noir noué autour de la tête, et, assise un peu en arrière du monde dans un coin, sa petite personne s’y confondait toute avec l’ombre. On lui a demandé :
— Vous l’avez vu ?
— Bien sûr, j’ai été le trouver.
— Et qu’est-ce qu’il vous a dit ?
— Il m’a dit que c’était écrit…
— Et vous y croyez ?
— Moi, j’y crois.
L’étonnant est qu’à ce même moment Julien Revaz s’était levé.
On lui avait dit : « Qu’est-ce que tu fais ? »
— « Je m’en vais. »
— Mais voyons, tu as bien le temps. Tu nous avais dit que tu avais l’intention de rester jusqu’à demain.
— J’ai changé d’avis.
— Comment vas-tu t’y prendre pour t’en retourner ? Tu ne vas pourtant pas t’exposer à être sur la route de nuit…
— Je m’arrangerai bien. Au revoir ! Peut-être, au printemps prochain !
IV
« Le soleil vomira rouge, et puis il ne sera plus là. »
C’est ce qu’Anzévui avait dit à la vieille Brigitte et elle faisait peur aux femmes à qui elle racontait ce que lui avait dit Anzévui.
— Vous comprenez, il m’a demandé de venir tenir son ménage. Il se fait vieux, comprenez-vous ? Il marche difficilement, il toussote, il a trop couru dans sa vie, il est fatigué. Il est sous ses plantes ; si vous en voulez ?…
On lui disait :
— Peut-être bien… À l’occasion…
— Il se tient sous ses plantes ; des fois il tousse, des fois il ne tousse pas. C’est quand il allait rôder par la montagne ; il en faisait des bouquets, comprenez-vous ? Il les a pendus au plafond, la tête en bas. Oui, disait-elle, avec des ficelles, aux poutres et avec des ficelles. Il y en a qui font transpirer ; il y en a qui sont bonnes pour la poitrine ; d’autres, c’est pour l’estomac. Oh ! elles sont bien un peu vieilles, c’est sûr, ses plantes, mais enfin si vous en voulez… Et ça ne vous coûtera rien, disait-elle…
— Oh ! merci bien…
— Seulement il faudrait vous dépêcher, parce qu’il ne va plus y avoir que trois mois… Et lui, je pense qu’il passera en même temps que le soleil. Il dit qu’il va baisser comme lui, tout doucement, parce qu’il s’en va peu à peu, le soleil, et lui aussi il s’en va peu à peu ; et tant mieux pour lui, disait-elle, parce qu’il y a ceux qui devront tout lâcher d’un coup.
Justine Émonet venait d’avoir un enfant :
— C’est pas juste !
Elle le tenait dans ses bras, c’était un bébé en sucre. C’était un bébé en sucre, tellement il était bien enveloppé dans une couverture en grosse laine blanche ; elle lui ôtait de dessus la figure un mouchoir blanc aussi, dont elle l’avait couverte à cause du froid :
— Regardez-moi les belles couleurs qu’il a pourtant. Et il est intelligent, il sait déjà rire. Est-ce que ce serait juste qu’on finisse avant même d’avoir commencé ? Elle se baissait alors sur la petite place ronde et chaude qu’il y avait au creux de son bras gauche dans l’air froid ; dans l’air glacé ; elle y collait ses lèvres, elle n’arrivait pas à les décoller. Quant à Brigitte, elle continuait :
— Il m’a dit : « J’ai encore un peu d’argent dans le tiroir de la table. Il suffira bien. » J’y ai dit : « Oh ! vous n’avez plus besoin de grand-chose. Peut-être un peu de fromage. » — « J’en ai. »
— « Et puis du pain. » — « J’en ai aussi, mais il est sec. Il faudra le faire tremper. » J’ai dit : « Je le ferai tremper ; on vous fera des soupes au pain. » On s’est arrangé comme ça que c’est moi qui lui fais ses courses et, de temps en temps, je viens et je lui fais son lit ou je donne un coup de balai…
On a vu, à ce même moment, Cyprien Métrailler qui entrait chez son ami Tissières. Le jour continuait à être triste et bas. Il n’y avait plus de ciel ; il y avait seulement un brouillard jaunâtre qui était tendu d’une pente à l’autre, comme une vieille serpillière, un peu au-dessus du village, et les montagnes sont derrière, ou bien est-ce qu’elles n’existent plus, les pointues, les carrées, les rondes, celles qui sont comme des tours, celles qui sont comme des cornes, celles qui sont tout en rochers, celles qui sont tout en glace, et elles brillaient toutes ensemble autrefois sous le ciel bleu ? Métrailler avait trouvé Tissières qui se chauffait devant son feu. Métrailler s’était assis à côté de Tissières.
— Je m’ennuie. Et toi ?
— Je m’ennuie aussi.
— Eh bien, il te faut venir avec moi.
— Où ça ?
— Il te faut venir avec moi pour tâcher d’aller retrouver le soleil, quelque part au-dessus des forêts du Bisse(1). À nous deux, c’est bien le diable si on ne tire pas une chèvre, parce qu’elles doivent être descendues à présent.
Ils étaient de vieux amis, ils chassaient toujours ensemble, et pas seulement en temps de chasse, mais toute l’année ; et ils n’avaient jamais eu de permis, ce qui fait d’abord une économie, mais ce qui vous vaut surtout le plaisir de narguer le gouvernement. Ils connaissaient à fond tous les recoins de la montagne, tous ses passages, toutes ses cachettes, ce qui leur permettait de ne pas trop s’occuper des gardes-chasse. Seulement, ce jour-là, Tissières a secoué la tête. Métrailler lui a dit :
— Pourquoi ?
— Il y a trop de neige.
— Elle porte, disait Métrailler.
— Qu’en sais-tu ?
— Il a gelé fort toutes ces dernières nuits.
— Oui, mais il y a le vent.
— Il n’y a point eu de vent.
— Et puis c’est ce drôle de temps…
Tissières tendait le bras vers la fenêtre. Il faisait brun, en effet, entre les croisillons des vitres aux tout petits carreaux ; il faisait partout singulièrement brun et triste, avec une singulière immobilité de l’air, de sorte que le jour ne pénétrait qu’à peine dans la pièce.
— Le temps, disait Métrailler, qu’est-ce que tu veux que ça nous fasse, le temps ?
— Le brouillard…
— C’est pas du brouillard. Et puis, comme si c’était la première fois qu’on se mettait en route quand le ciel est couvert…
Mais Tissières ne voulut rien entendre. Il ne répondait même plus ; il secouait simplement la tête. Métrailler ne le reconnaissait pas.
Et il a dit :
— Eh bien, tant pis, j’irai quand même. Ça n’empêche rien, disait-il. Je veux aller retrouver le soleil, disait-il, parce qu’il se cache trop longtemps pour nous quand on reste enfermés dans le village ; et c’est bête, puisqu’on a des jambes ; et puis je m’ennuie, recommençait-il, et toi, je vois bien que tu t’ennuies aussi, seulement tu ne veux pas l’avouer.
Tissières ne disait toujours rien, en effet : alors Métrailler a pris congé. Il vivait avec son vieux père qui était devenu presque aveugle avec l’âge. Le père Métrailler ne voyait plus des choses du monde que la vague clarté qu’elles émettent, non leur forme ; il ne voyait plus du monde que des places sombres et des places claires ; et voilà que depuis quelque temps déjà il disait : « Est-ce que tout devient plus gris, parce que ça tend à s’égaliser ? »
On lui disait :
— C’est que le soleil n’est plus là.
On lui disait :
— Il vous faut attendre. Les choses sont sans couleur tant qu’il n’éclaire pas. Seulement prenez patience ; et le jour viendra bien où on pourra vous apporter un bouquet de gentianes et un bouquet de primevères ; vous ferez tout de suite la différence, vous verrez. Et c’est bientôt, père Métrailler.
Cependant Métrailler fils avait préparé son fusil. C’était un fusil à balles. C’était un mousqueton de cavalerie qui est une arme plus courte et plus légère que le fusil des fantassins. Un fusil trop long est gênant dans les rochers ; un fusil trop lourd serait mal commode, vu qu’il n’est pas toujours facile de prendre la position qu’il faut dans cette pierraille où on ne peut ni se mettre à genoux, ni rester debout, ni s’étendre, où il vous faut souvent lâcher votre coup à bras tendu et au jugé. Il avait préparé aussi tout ce qu’il lui fallait pour le lendemain en fait d’habits et de provisions ; et, maintenant, à la lumière de la lampe, vers les deux heures de l’après-midi, il était occupé à graisser son arme. Il avait complètement démonté la culasse dont les pièces étaient éparses devant lui sur la table, chacune étant posée sur un carré de chiffon, car il était un homme soigneux ; puis, prenant son fusil par le petit bout, il le dirigeait de telle façon que la lumière de la lampe (car d’ordinaire on vise le soleil, mais il n’y a plus de soleil) fût juste en face de lui à l’autre bout du canon. Et, de nouveau, il passait le cordeau dans le canon, jusqu’à ce qu’il ne restât plus la moindre tache sur l’acier où la lumière doit être comme un fil d’argent bien tendu, sans solution de continuité.
Personne ne le vit partir, le lendemain matin, parce qu’il n’était même pas six heures. Il avait pris grand soin en se levant de ne pas faire craquer son lit. Il avait réussi à poser ses pieds sur le plancher de façon qu’il restât parfaitement silencieux, ce qui n’était pas commode, vu la longueur des vieilles planches que l’âge a fini par faire jouer et qui sont simplement clouées sur les poutres qui les séparent de la chambre de dessous, sans aucun revêtement de plâtre. Il s’était habillé sans bruit ; il avait descendu l’escalier de bois, pieds nus, s’arrêtant à chaque marche ; il avait ainsi gagné la porte ; là, il s’était tenu immobile, un moment. Mais rien ne bougeait dans la maison et rien ne s’y faisait entendre que le battement régulier et sourd d’une vieille pendule à caisse. Il s’était réglé sur son battement pour tourner la clé dans la serrure, tirer à lui la lourde porte, la refermer.
Il a vu alors qu’il n’y avait rien à voir autour de lui ou que du moins il ne voyait rien, comme s’il avait lui-même perdu la vue. C’est en tâtonnant avec les mains qu’il avait fini par trouver le banc qui se trouvait placé tout contre le mur de la maison, à l’abri de l’avant-toit. Il s’y était assis pour mettre ses souliers. Il n’avait eu ensuite qu’à étendre la jambe pour que son pied rencontrât une bonne épaisseur de neige ; de sorte que, pour ce qui était du bruit, il n’avait plus rien à craindre ; mais il y avait l’obscurité et c’est ce qui le gênait. Métrailler levait la tête, il ne lui semblait pas qu’il la levât ; il la tournait de tout côté, il ne lui semblait pas qu’il la tournât, toute altitude se trouvant supprimée, toute profondeur et toute distance ; pendant qu’il se disait : « Cochon de Tissières ! » il se disait : « Qu’est-ce qu’il fait ? il dort, l’animal » ; et il se disait pour finir : « Eh bien, allons-y quand même ! » mais il y avait en lui une voix qui chuchotait : « Tu ne te tireras pas d’affaire tout seul, Cyprien ; tu ferais mieux de rester où tu es. »
Il s’était mis en route. Il lui fallait porter le pied de côté pour distinguer à travers la semelle la place et la direction du chemin. Il avait été ainsi amené à la rue, il l’avait suivie d’un bout à l’autre. Et, là, il était arrivé devant ce qui, en temps ordinaire, était toute une vaste vue ouverte sur la vallée, toute une perspective de hautes montagnes, de pâturages, de forêts, de rochers, de névés, de glaciers solitaires avec le double versant des pentes qui se rejoignaient bien plus bas dans les profondeurs ; mais il n’en restait rien dans la perfection de la nuit qui n’avait même plus de couleur, qui était seulement la négation de ce qui est ; il n’en restait qu’une faible lueur, quelque chose comme une émanation ou une vague phosphorescence.
Il avançait pourtant, n’écoutant point la voix de la prudence, laquelle voix lui répétait : « Ne va pas, Métrailler ! Même si tu devais tirer une chèvre, même si tu devais en tirer deux. Est-ce qu’il ne faudrait pas d’abord que tu sois sûr d’être en mesure de la descendre sur ton dos ? est-ce qu’il ne faudrait pas aussi que tu sois plus sûr que tu n’es de pouvoir te descendre toi-même, Cyprien, dans ces dessus ? »
Il s’est obstiné, tenant ses yeux fixés juste devant lui, où il faisait lever peu à peu par l’habitude qu’il en prenait, de dedans rien, une chose, une autre ; et opérait ainsi une séparation entre les choses qui sont en bas et celles qui sont en haut, entre le sol et l’air, entre ce qui résiste à votre venue et ce qui y cède, faisant sortir devant lui tantôt une barrière, tantôt plus loin un buisson, puis un bouquet de mélèzes, à quoi il avait reconnu qu’il était dans la bonne direction. Il s’élevait en travers de la pente qui domine le village. Il faut dire que la neige portait. Il faut dire qu’elle était peu à peu devenue distincte de la nuit à qui elle servait de base. Métrailler voyait maintenant ses pieds et même sa main quand il étendait le bras, étant d’ailleurs chaudement et solidement équipé (c’est un chasseur), pourvu de manger et de boire, armé aussi, son mousqueton pendu à l’épaule, les jambes prises dans des molletières, la tête et les oreilles dans le passe-montagne dont les deux brides se nouent sous le menton. Il a été encouragé ainsi dans sa résolution. Et, à mesure qu’il avançait, il séparait de plus en plus les éléments contraires ; il reconstruisait le monde tel qu’il devait être, tel qu’il allait être, imaginant le jour avant le jour, refaisant le jour d’avance avec ses yeux impatients. Les grands vents de la montagne n’avaient pas soufflé depuis longtemps sur le pays, étant restés enfermés dans leurs outres. Il y avait ainsi une grande égalité dans l’épaisseur et la consistance de la neige, qui, quand elle est au contraire chassée et partout promenée, devient comme le sable des déserts, s’entassant dans les replis du sol dont elle laisse à nu les exhaussements. Elle était du reste recouverte d’une mince feuille de glace pas plus épaisse qu’une vitre, laquelle cassait sous le pied avec un bruit comme quand un caillou arrive dans un carreau ; Métrailler laissait derrière lui des traces aussi nettes que si elles avaient été découpées avec des ciseaux dans une feuille de carton. Et il savait à chaque pas où il était, à cause de l’apparition d’objets qu’il attendait l’un après l’autre, tellement ils étaient connus de lui : c’était une croix, ou une grosse pierre, et il quittait la croix attendant de voir sortir devant lui la pierre, puis c’était un mélèze isolé. Il avait vu enfin paraître le village ; et le village, blanc sur blanc, aurait été pareil à rien du tout, s’il n’y avait pas eu le bois noir de ses façades qui, vues d’en haut et de côté, faisaient dedans comme des trous, comme s’il y avait eu des infiltrations d’eau dans la superposition des neiges. Et la nuit s’en allait quand même et c’est lui qui la dissipait. Il a tendu le bras en avant ; il voyait qu’au geste de son bras le jour s’éveillait par degré. Il se disait : « Et voilà ! ça y est ! Et, eux, ils sont morts là-dessous parce qu’ils consentent à la mort. Ils sont couchés ensemble dans le mauvais air sous un édredon, sous un plafond, sous un toit, puis sous un autre qui est la neige, et un troisième toit encore qui est la nuit ; eh bien, moi, je vais chercher la lumière parce que je suis vivant. Je vais leur ramener le soleil qu’ils n’ont plus ; et, pour le moment, je refais la lumière » ; parce qu’il croyait qu’il la faisait naître, quoique petite et incertaine encore, au-dessus de ce village qu’il a salué. D’ailleurs, presque en même temps, il l’avait perdu de vue. Il s’était engagé sur une arête qui surmontait la pente qu’il venait de dépasser. Là, en temps ordinaire, on est comme sur une corde raide. C’est le lieu de rencontre de deux penchants qui se trouvent ainsi coïncider à leur sommet ; c’est un chemin pas large, pendu dans les airs, d’où on a en temps ordinaire une vue magnifique sur les déserts haut perchés des glaciers et de la rocaille ; mais où il n’y avait rien d’autre, ce matin-là, que ce peu de neige et quelques bosses de rocher sur un espace de quelques mètres en avant de lui. Et, quand on se retournait, de quelques mètres derrière vous, pas autre chose. Une immensité vague et illimitée de fin brouillard, si c’était bien du brouillard et non pas un simple empêchement au jour ; car le jour s’était levé un peu, mais à présent il ne se levait plus, étant immobile et comme noué sur lui-même. Métrailler tira sa montre de sa poche ; il vit qu’il était huit heures. Et il poussa plus avant. Il y voyait très suffisamment pour se conduire, bien qu’il n’eût pas d’autres repères que ceux qui se trouvaient dans sa proximité immédiate, mais ils lui suffisaient, car on te connaît. On te connaît dans les plus petits détails, ô montagne ; tu es comme une femme avec qui on a longtemps couché ; il n’y a pas une tache, pas le moindre défaut, pas le moindre grain de beauté sur ta peau qu’on n’ait du moins touché une fois des doigts ou des lèvres. « Voilà comment tu es pour moi, se disait-il ; on peut souffler la lumière, je n’ai pas besoin de chandelle. Je vais suivre l’arête jusqu’au pied des rochers de Vire, et puis, par le couloir, j’arriverai au Grand-Dessus. Là on est en domination. Et même si Satan s’en mêlait, il n’empêchera pas que le soleil ne me fasse visite ; je leur en rapporterai, à ceux d’en bas, un peu dans mes poches ; je leur dirai : « Vous voyez bien qu’il existe toujours ! » parce qu’ils auraient fini par en douter… Je tirerai sûrement une chèvre pendant la traversée. Je leur rapporterai le soleil dans mes poches, la chèvre sur mon dos. »
C’est le temps, en effet, où les chamois, des gazons suspendus où ils passent l’été, descendent dans les basses combes où ils grattent la neige avec leurs petits sabots tranchants pour trouver la mousse qu’il y a dessous. Ils descendent ainsi jusque dans les forêts, et quelquefois jusqu’aux fenils où ils mangent le foin qui dépasse au dehors par l’intervalle entre les poutres. Métrailler s’était donc assuré, une fois de plus, que les six cartouches de son magasin étaient bien en place et il en avait une septième dans le canon de son fusil ; l’affaire n’étant plus maintenant que d’attendre que la vue se fût un peu élargie, comme il pensait bien que ce serait le cas quand il aurait gagné encore plus en hauteur.
Il avait maintenant laissé l’arête à sa gauche, se glissant dans le bas de son exhaussement. Entraînée par son propre poids, la neige n’avait guère tenu dans le haut des éboulis faits de menu gravier et de cailloux de petite grosseur que Métrailler s’était mis à longer et qui par place étaient à nu, quoique durcis et collés ensemble par la gelée. Il avançait toujours sans trop de peine ; alors, en même temps que lui, une sorte de chambre ronde de demi-clarté s’avançait, au milieu de laquelle il se déplaçait et elle se déplaçait du même mouvement que lui. Comme il avait fait halte, le bruit qu’il faisait avec ses semelles et son souffle s’était tu subitement ; et, dominant la secrète étendue, il l’avait imaginée et vue en esprit, qui venait seulement à lui par son silence et où il n’entendait plus que le bruit de son cœur. Elle venait, il écoutait ; il y avait seulement sous sa vareuse de gros drap brun ces coups réguliers qui étaient derrière ses côtes pareils aux battements d’une montre. Rien d’autre qui fût en vie et aussi bien derrière lui que devant lui et à sa droite qu’à sa gauche, si loin qu’il pût imaginer ; et la voix se faisait entendre de nouveau : « Retourne d’où tu es venu, Métrailler. Si tu glisses, il n’y aura personne pour te porter secours ; si tu te perds, qui t’entendra ? Si tu te cassais la jambe, qu’est-ce que tu ferais, Métrailler ? Il suffit d’un faux mouvement, Métrailler ; il y a de la glace sur les pierres. » Mais, lui, il secouait la tête pour dire non ; ayant gagné tout au travers des éboulis le pied de la paroi où se trouve le couloir qui mène au Grand-Dessus.
La montée dans le couloir fut longue et difficile. Il creusait avec la pointe de son soulier des trous dans la neige gelée et par ces trous de l’un à l’autre, comme à des degrés, se soulevait d’en bas, tandis qu’il se tenait avec les doigts dans la croûte dure comme aux barreaux d’une échelle.
Il se disait toujours : « Là-haut il y a le soleil. » Et, en effet, il semblait bien que le soleil dût bientôt se montrer, parce qu’il se faisait au-dessus de Métrailler un amincissement dans les nuées comme quand la trame d’un linge est usée, et, de l’autre côté de la crête, une coloration rousse avait commencé à paraître. Métrailler levait la tête, se disant : « Et Tissières verra bien, et eux, les autres, verront bien ! » s’enorgueillissant à présent de sa solitude. Il avait fini par arriver au Grand-Dessus. C’est une espèce de plateforme qui se détache de l’arête et culmine. Par le beau temps, la vue porte de là à plus de cent kilomètres de tous les côtés. On ne voyait rien, mais Métrailler ne cherchait pas à rien voir, de ce qui était la vue. Où il tenait son regard tourné, à présent, c’était vers en haut. Il s’était assis sur la neige gelée et levait la tête avec étonnement du côté d’une fenêtre qui venait d’être percée dans la voûte amincie du brouillard un peu au-dessus de lui vers le sud, de l’autre côté d’une grande chaîne qu’on commençait à deviner. Et c’est là qu’enfin, en effet, il était paru, le soleil, ou ce qui aurait pu être le soleil, et c’est là qu’il devait en effet sortir de derrière la chaîne pour aussitôt s’y recacher. Mais il était devenu rouge et la roche où Métrailler se tenait devint rouge ; et le soleil là-haut ne s’était pas montré, mais il semblait qu’on le montrât ; il ne s’était pas soulevé, il semblait qu’on le soulevât : échevelé, et tout enrubanné, tout enserpenté de nuées qui étaient elles-mêmes comme des caillots de sang.
Tout à fait pareil à une tête coupée autour de quoi la barbe et les cheveux pendraient encore fumants ; qu’on a levée en l’air un instant, puis qu’on a laissée retomber. Et déjà le brouillard et l’obscurité étaient revenus là où avait été sa place.
Alors, vers les quatre heures le père Métrailler était sorti de chez lui : « Est-ce qu’il fait jour encore ? Hé ! vous-autres, dites-moi ; Cyprien, où est-ce qu’il peut bien être ? »
— Hé ! vous autres, vous qui voyez. Parce qu’il est parti ce matin. Et voilà, je sors de chez moi parce qu’il faudrait l’aller chercher, seulement je n’y vois plus…
Il tâtait autour de lui le sol avec sa canne.
— Il n’a point fait de bruit, disait-il, il est sorti pieds nus de la maison. Et à présent où est-ce qu’il est ?
Il disait :
— Hé ! vous autres.
Car il était seul encore dans la rue, mais on venait, car il parlait haut et fort ; on venait, on lui parlait ; et il disait : « Toi, qui es-tu ? » et c’était Follonnier qui disait : « Placide Follonnier » ; puis Lamon qui disait : « Érasme Lamon » ; puis d’autres, des hommes, des femmes, et la vieille Brigitte encore.
Follonnier avait pris la parole :
— Ne vous en faites pas, sûrement qu’il va revenir, vous comprenez, il devait avoir des démangeaisons dans les jambes, à force de rester tranquille. C’est pas fait pour des garçons comme lui, la tranquillité. Il aura été faire un tour dans la montagne, du côté des chèvres, avec Tissières.
Mais quelqu’un, à ce moment-là :
— Il n’est pas avec Tissières.
— Comment le sais-tu ?
— Vous n’avez qu’à aller le lui demander, à Tissières, il n’a pas bougé de chez lui.
— Alors il faut vite aller le chercher, mon garçon, disait le père Métrailler… Ah ! disait-il, je ne vous vois pas, je vous vois tout pâles, vous êtes seulement comme les ombres de vous-mêmes ; ou bien si c’est que le jour est mauvais…
— C’est que le jour n’est pas tant bon et puis la nuit vient déjà ; vous savez bien qu’elle vient tôt, et puis le ciel est couvert.
Mais, lui, tournait de tout côté ses yeux déteints bordés de rouge, ses yeux comme des œufs de caille, c’est-à-dire gris et vaguement teintés de bleu. Cependant que Tissières était arrivé, et disait :
— J’ai pas voulu aller avec lui, je lui ai dit : « C’est pas prudent », mais il n’a pas voulu m’écouter…
Alors les larmes s’étaient mises à couler des yeux du vieux Métrailler, bien qu’il les gardât grands ouverts, et il ne faisait pas bouger ses paupières d’où l’eau suintait, avec difficulté, comme la résine de l’arbre. Puis il se porte brusquement en avant, faisant des trous dans la neige avec sa canne et on lui courait après ; on lui disait : « Où allez-vous ? » Il disait : « Je vais le chercher. » On le retenait par le bras, il se débattait : « Allez-vous le laisser périr tout seul ?... »
— On ne peut pas aller le chercher, il va faire nuit. Et puis où voulez-vous aller ?
— Eh bien, allumez des feux.
— Il y a du brouillard.
— Eh bien, il faut sonner la cloche, il faut tirer des coups de fusil ; il se dirigera d’après le son.
Tissières, va prendre ton fusil.
Le village avait été mis sens dessus dessous parce que Tissières va prendre son fusil d’ordonnance et des cartouches à blanc. Il tirait en l’air. De temps en temps, il lâchait un coup de feu, l’arme tournée vers le ciel qui était si bas qu’on aurait dit que Tissières allait le toucher avec le bout de son fusil. Pendant ce temps les maisons se vidaient une à une, laissant couler sur les perrons et jusque dans les ruelles leur contenu de femmes et d’enfants, qui demandaient : « Qu’est-ce qu’il y a ? »
— C’est Métrailler qui est perdu.
Il allait faire nuit, les lampes s’allumaient dans les cuisines, et aussi des hommes étaient survenus, tenant à la main leur falot-tempête, qui a une anse comme un panier ; de ceux dont on se sert dans les écuries pleines de paille ou dans les granges pleines de foin ; c’est pourquoi il convient que la flamme en soit protégée. C’est pourquoi elle est entourée d’un globe de verre épais, lequel est entouré à son tour d’une armature de fils de fer qui le tient à l’abri des chocs.
Les falots faisaient un peu au-dessus de terre des points rouges qui bougeaient à peine comme les gouttelettes d’une pluie arrêtée en route. Et ceux qui les portaient disaient aussi : « Qu’est-ce qu’il y a ? » pendant que Tissières lâchait encore un coup de feu ; après quoi tout le monde faisait silence, pour écouter s’il n’allait pas y avoir de réponse ; quelque part, dans la montagne, au-delà de ce mur de brume, et à quoi la nuit qui venait allait ajouter comme un second mur.
Un coup de feu, et ils écoutent et il y a un coup de feu à votre gauche ; ils écoutent encore, il y a au bout d’un moment un deuxième coup de feu à votre droite, puis trois ou quatre coups de feu de suite, mais sourds, mous, ralentis qui ne vous parvenaient plus que tout juste, et qui se terminaient par une espèce de long soupir, c’est tout.
Alors on a vu le vieux Métrailler s’agiter de nouveau ; et il est parti droit devant lui avec sa canne, disant : « Si vous ne venez pas, moi, j’y vais. »
Il n’y avait plus qu’à le suivre.
Ils inclinaient leurs falots tempête pour tâcher de lire dans la neige les places où il avait passé, écrivant dans la neige bout à bout des lettres qui faisaient des mots, des mots qui faisaient des phrases comme sur les télégrammes ; ils se démenaient en désordre sans trop savoir ce qu’ils allaient faire, quand ils ont entendu tout à coup derrière eux le son d’un cornet.
On vit que c’était Jean Antide qui venait ; il soufflait dans son cornet de cuivre qui avait un bout de corne.
C’est le cornet des bergers des chèvres et il faut qu’on l’entende de loin quand le berger de grand matin va, de maison en maison, recueillant une à une les bêtes de son troupeau ; il faut qu’on l’entende de loin aussi le soir, quand il rentre, de manière que les femmes puissent venir chercher leurs bêtes sans le faire attendre.
Jean Antide avait été berger des chèvres ; alors il souffle dans son cornet et rit.
Le beau-frère d’Isabelle, faisant voir ses dents blanches qui brillaient dans la nuit à cause de sa figure brune et il avait les cheveux frisés, comme on voyait.
— Écoutez, si vous voulez, j’irai devant et je soufflerai dans mon cornet. Parce qu’il en connaît bien le son, Métrailler, si toutefois il est perdu. Je souffle de temps en temps un coup, ça va bien, et même je peux faire deux notes quand je veux.
Il a fait ses deux notes grâce à un changement dans la position de la langue ; le cuivre du cornet brillait à la clarté des falots-tempête qu’on soulevait pour le mieux voir.
— Et ça porte plus loin que tes coups de fusil, Tissières, et on distingue mieux aussi d’où le son vient ; c’est plus prolongé, c’est doux ; tandis que, toi, tu sautes à tous les bouts de la montagne, tu es partout et nulle part. Voulez-vous ?
On avait rattrapé le père Métrailler, on l’avait pris par le bras, Jean Antide allait devant ; ils étaient une douzaine. Les femmes disaient : « Mon Dieu ! mon Dieu ! » Elles avaient fait rentrer les enfants, puis, étant ressorties et ayant refermé derrière elles la porte de la maison, elles regardaient de loin ces points de feu qui allaient s’éloignant, ces gouttes roses, qui ont pâli, qui en pâlissant se sont étalées comme de l’encre sur un buvard et peu à peu ont été dissipées, bien qu’elles eussent dû, en temps ordinaire, continuer d’être longtemps visibles à cause de la pente bien découverte pour le village où elles s’élevaient peu à peu.
C’est le temps. Ce n’est pas seulement qu’il fasse nuit ; c’est que l’air n’est plus de l’air. L’air est grenu comme de la cendre, il est opaque comme du sable.
Jean Antide soufflait tantôt une note, tantôt deux notes. On tenait le père Métrailler par le bras.
Il continuait à ne faire aucun vent, de sorte que les traces du matin n’étaient nullement effacées. Ils s’étaient dit : « Il faut les suivre aussi longtemps qu’on pourra, parce que, lui-même, sûrement, il devra les suivre au retour », bien qu’ils pensassent pour la plupart qu’il lui était sûrement arrivé un malheur, sans quoi il aurait déjà été là. Et le vieux Métrailler leur disait : « Êtes-vous bien sûrs qu’on soit sur ses traces ? » — « Pardieu ! » disait-on. On voyait leurs bouches fumer quand ils se penchaient sur leurs lanternes, à cause du grand froid qu’il faisait et toujours aucun vent ; et, penchant leurs lanternes, ils n’avaient qu’à les porter un peu de côté pour rendre les traces encore plus visibles parce que le creux s’en remplissait d’ombre ; c’est pourquoi ils disaient : « On ne peut pas s’y tromper. »
Mais Métrailler disait à Jean Antide : « Fais une note » ; et il se passait un petit moment et il disait à Jean Antide : « Fais deux notes. »
Ainsi Cyprien était appelé comme la grive par l’appeau, mais c’était un appeau qui portait à grande distance, bien plus loin que la voix de l’homme, – eux qui s’arrêtaient, et prêtaient l’oreille, puis repartaient, faisant ensemble dans la neige un bruit comme quand on casse une vitre, puis il y avait un bruit d’enfoncement comme le « han ! » que pousse le bûcheron quand il abat sa hache sur un tronc.
Ils ont marché ainsi une bonne demi-heure, ils commençaient à se décourager. Même, si le père Métrailler n’avait pas été là qui les houspillait à aller quand même, disant tout le temps à Jean Antide : « Souffle ! » et puis de nouveau : « Souffle ! » et Antide soufflait, ils fussent sûrement pour finir revenus sur leurs pas. Mais Antide soufflait toujours ; c’est ainsi qu’ils étaient arrivés jusque sur l’arête, hésitant à s’y engager, quand Antide a soufflé une nouvelle fois.
Et tous, arrêtés là-haut, ils se retenaient de respirer ; ils ont dû attendre aussi que leur cœur eût cessé de battre et il leur a fallu du temps à cause de ses battements durs, comme des coups de pied dans une porte, et qui ne se sont calmés que peu à peu.
Ils écoutent, mais il n’y a rien.
Ils écoutent encore, il n’y a rien que ce bruit au-dedans de vous qui va mourant et laisse venir à sa suite l’immense silence qui est sur le monde comme si le monde n’était plus ; comme si on n’était plus au monde, comme si on était suspendu bien au-dessus de la terre dans le grand désert où les astres en tournant sont silencieux.
Ils écoutent, il n’y avait rien, toujours rien ; mais tout à coup c’est le vieux Métrailler qui avait levé le bras à hauteur de son oreille et avait pris le pavillon de son oreille dans sa main. « C’est lui, c’est lui !… vous entendez ? »
On n’osait pas le contredire ; on n’osait même rien dire.
Et tous ils faisaient silence encore une fois, puis on n’a pas su si c’était de joie ou parce qu’il pleurait, et peut-être qu’il pleurait de joie, mais il y avait des larmes dans la voix du vieux :
— Écoutez ! Écoutez, il appelle, ça se rapproche.
— Où ça ?
— Là, dans le fond. Où est-ce qu’on est ?
— On est monté, on est sur l’arête.
— Eh bien, là, dans le fond, à main droite… Vous n’entendez pas ? ah ! a-t-il dit, c’est que vous y voyez et que jamais tout ne nous est donné à la fois ; vous, vous avez vos yeux, mais, moi, j’ai mes oreilles.
On lui disait :
— Alors taisez-vous !
Il s’était tu ; et eux alors, l’un après l’autre, avaient commencé à entendre des appels qui venaient d’en bas et de tout à fait au fond de la gorge ; faibles, incertains, qui s’étaient tellement usés en route qu’ils étaient comme sans poids et sans force dans l’air.
— Souffle ! Souffle deux fois !
Jean Antide a soufflé dans sa corne.
— Souffle encore et souffle plus fort, qu’il sache bien qu’on est là.
Maintenant les appels devenaient plus distincts, parce qu’on devait s’être rapproché, on s’était avancé vers eux, on devait chercher à les rejoindre. Mais, eux, qu’est-ce qu’il leur fallait faire ? C’est Tissières qui a dit :
— Il faut aller à sa rencontre. Je m’en charge. Antide viendra avec moi. Prêtez-moi une lanterne, et toi, Antide, prends la lanterne.
On lui disait :
— Est-ce prudent ?
— Laissez-moi faire, disait-il ; le pays, ça me connaît.
Ils avaient fait asseoir le père Métrailler dans la neige, regardant au-dessous d’eux les lumières des lanternes qui s’élargissaient vite et se sont tellement élargies en s’affaiblissant qu’elles ont fini de nouveau par ne plus être ; mais il y avait le son du cornet et il y avait cette voix qui lui répondait ; et le son du cornet et la voix avaient dû pour finir se rejoindre, parce qu’à présent on n’entendait plus ni la voix, ni le cornet…
Ils durent porter Cyprien, ou presque, pour le ramener au village. Ils éclairent devant Métrailler le jeune la place où il devait poser le pied, parce que c’est à peine s’il se tenait debout. Il chancelait comme un qui a trop bu. Il avait la figure blanche ; son passe-montagne arraché lui pendait dans la nuque. Il n’avait plus de fusil, il n’avait plus de chapeau. Il ne disait rien. Aux questions qu’on lui avait posées, il avait répondu par des signes et tout juste ; de sorte que Tissières et Antide lui avaient passé le bras autour de la taille et lui-même avait jeté les siens autour de leur cou. Heureusement qu’on était à la descente, heureusement que la neige était dure.
Et il y avait son père qui disait :
— Comment est-il ? Est-il abîmé ?
— Bien sûr que non.
— Alors pourquoi est-ce qu’il ne parle pas ?
— C’est la fatigue.
Et le père Métrailler disait :
— Cyprien, c’est vrai que tu es là ? Est-ce vrai que tu n’es pas blessé ? Pourquoi est-ce qu’il ne répond pas ? Laissez-moi que je le touche.
V
Cependant on voyait Brigitte aller, tous les matins, ramasser du bois mort dans un bosquet de mélèzes qui était un peu au-dessus du village. Elle s’était ouvert ainsi, avec ses souliers bien trop grands pour elle, un petit chemin dans la neige ; et, comme elle faisait chaque jour plusieurs voyages, il se trouvait que le chemin durait, pareil à un bout de faux fil qu’on aurait oublié sur un drap de ménage. Et ainsi le trajet était facile de chez elle jusque dans le bois ; mais c’était sous les mélèzes que commençaient les complications, à cause que les branches mortes se trouvaient prises dans la neige gelée, d’où généralement elles ne sortaient que par le bout ; de sorte qu’il lui fallait creuser tout autour avec ses mains. On avait commencé par se moquer d’elle :
— Qu’est-ce que vous faites ? Vous manquez de bois ?
— Que non, disait-elle.
— Alors ? disait-on.
— C’est pour le cas où le soleil ne reviendrait pas.
Toute courbée devant vous sous le poids de son fagot, sa jupe noire frottée d’une espèce de poussière grise, sa figure devenue toute jaune avec des taches de café sur le fond de la pente blanc :
— Et, continuait-elle, bien sûr que j’avais comme toujours ma provision pour jusqu’au printemps, mais s’il n’y a point de printemps, si au lieu de faire plus clair à ce moment-là il se met à faire nuit, si au lieu que la chaleur vienne le froid augmente… Il faut prendre ses précautions.
Les femmes commençaient à être inquiètes :
— Voyons, est-ce vrai ? Voyons, disaient-elles, est-ce que c’est possible, des choses comme ça ?
— Il a dit que la terre peut parfaitement se mettre à pencher de côté parce qu’elle est en l’air. — En l’air ?
— Oui, en l’air, supportée par rien, une boule qui tourne en l’air et pas fixe ; et, si on ne la voit pas bouger, nous autres, c’est seulement qu’on bouge avec… Alors, vous comprenez, rien qu’un coup de pouce…
— Comment savez-vous ça ?
— C’est Anzévui qui me l’a dit. Attendez, disait-elle, que j’aille poser mon fagot…
Elle entrait chez elle, puis reparaissait, parce qu’elle aimait à causer ; il y avait toujours ce même ciel bas, immobile et sombre, sous lequel à présent beaucoup de femmes l’entouraient.
— Il ne parle plus guère, disait Brigitte, mais des fois il parle. Il tourne les pages de son livre, ça fait du bruit. Il est sous ses plantes devant son feu, oh ! disait-elle, c’est qu’il ne va pas tant bien, il s’affaiblit tous les jours un peu plus, il peut à peine se déplacer. Il va de son lit à son fauteuil et de son fauteuil à son lit. Il m’a dit : « Je ne durerai pas plus que le soleil. Quand ce sera sa fin, ce sera la mienne… Vous me trouverez mort en bas et, lui, vous le chercherez dans le ciel, mais il ne bougera pas davantage que moi. » Et je lui ai dit : « Quand est-ce que ce sera ? » et, lui, il m’a dit : « Attendez ! » Vous comprenez, il recommence tout le temps ses calculs, avec un bout de crayon sur un bout de papier… Il dit que c’est là le difficile, il m’a dit que ça allait faire encore quinze semaines ; alors, moi, chaque dimanche, j’enfonce un clou et j’en ai déjà planté sept… Et moi, disait-elle, j’ai allumé ma lampe à huile, parce que j’ai encore toute une bonbonne d’huile de colza, pour qu’au cas où la nuit viendrait subitement, j’aie du moins ma lumière à moi.
Elle avait fait comme elle disait. On voyait toutes les nuits la fenêtre de sa cuisine être éclairée, et toute la nuit elle était éclairée, puis le jour venait, mais elle ne s’éteignait pas. Tout le jour, elle continuait à luire avec persévérance dans la façade de bois noir, où elle continuait à être vue, tellement le jour était sombre, tandis que Brigitte tirait à elle un tabouret.
C’est qu’elle était de petite taille, mais heureusement que le plafond était bas. Elle allait prendre une hache, elle allait prendre une boîte de carton sur laquelle était écrit : Pointes 6 cm. Elle montait sur le tabouret, elle levait le bras, et, renversant le haut du corps en arrière, enfonçait la pointe brillante dans le côté de la poutre encroûtée de fumée où il y en avait déjà sept.
Elle comptait, et, à présent, ça fait huit.
Je plante un clou chaque dimanche.
Puis allait voir s’il y avait encore de l’huile dans la lampe, pendant que la mèche pendait avec sa petite flamme au bout du bec ; et la mèche va vers en bas, mais la flamme vers en haut. Car c’est un crésus, comme on les appelle ; un récipient de laiton rond et plat, avec un bec et une poignée en demi-cercle par le moyen de laquelle il est suspendu en équilibre à un fil de fer.
Elle remplissait la lampe d’huile : elle mouchait la mèche sans l’éteindre, et ainsi on aura sa lumière à soi quand la grande ne sera plus.
C’était le dimanche matin. Qu’est-ce qu’on voit ici en hiver ? on ne voit rien. Le jour était quelque chose de gris et de vague qui se détortillait lentement hors de la nuit de l’autre côté des nuées comme derrière un carreau dépoli.
Qu’est-ce qu’on entend ? rien du tout. Même pas le bruit des pas à cause de la neige, même pas le bruit du vent, parce qu’il n’y a toujours point de vent. De temps en temps une voix, quelquefois un enfant qui pleure, pas un oiseau, pas même la fontaine, parce qu’elle coule dans un chéneau de bois pour éviter qu’elle ne se prenne peu à peu dans la glace, comme il arrive, si on la laisse couler librement à l’air.
Ils ne sonnent même pas les cloches ici, parce qu’ils ne sont pas une paroisse.
Il faut qu’ils descendent pour la messe à Saint-Martin d’En Bas où est l’église, c’est-à-dire qu’ils ont à faire une bonne demi-heure de chemin.
Et, le dimanche matin, on se prépare à descendre : c’est à-dire que les hommes se rasent devant la fenêtre aux croisillons de laquelle ils pendent un petit miroir rond cerclé de métal ou un petit miroir carré à cadre de bois noir ; quelques-uns avec le rasoir à lame, les jeunes avec des rasoirs mécaniques qu’on se passe sur la joue comme quand on rabote du bois ; mais ni les uns, ni les autres n’y voyaient, ce matin-là, et ils disaient : « Charrette ! » parce qu’ils se coupaient.
On n’avait ouvert la route qu’avec le petit triangle, de sorte qu’elle était beaucoup plus étroite que dans la belle saison, n’ayant guère plus qu’un mètre de large ; en outre, c’est un chemin de surface, parce qu’il ne descend pas jusqu’à l’empierrement. On s’avance entre deux petits murs qui ont environ deux pieds de hauteur sur une épaisse couche de neige battue. On avait vu venir d’abord trois vieilles, parce qu’elles vont plus lentement et elles prennent leurs précautions. Trois vieilles, tout en noir, toutes petites et voûtées, mais, à mesure qu’on avance dans la vie, on décroît. Penchées en avant, les mains jointes, la tête dans un fichu noir, un châle de laine épais croisé sur la poitrine et noué dans le dos ; elles ne disaient rien. Quelquefois on entend jusqu’ici les cloches de Saint-Martin d’En Bas, parce qu’ils en ont quatre et un bon sonneur qui sait s’y prendre et qui se connaît en toute espèce de carillons ; mais aujourd’hui on ne les entendait pas, soit à cause de l’immobilité de l’air ou bien à cause de la neige qui est comme du coton partout et boit le son ; c’était un dimanche sans cloches. Et, dans la petite lumière, il y avait à présent les femmes qui venaient, puis venaient les filles. C’est alors qu’on a entendu le rire d’Isabelle. Ah ! elle, du moins, elle riait, elle du moins était brillante ; elle, elle se voyait de loin, ayant un corsage de soie bleu ciel, un tablier à fines rayures de toutes les couleurs, un mouchoir rose autour du cou.
Elle était avec deux amies, et, comme le chemin n’avait pas assez de largeur pour qu’on pût y passer trois de front, ses deux amies allaient un peu devant, sur chaque bord, elle un peu en arrière et au milieu.
On les voit qui se retournent, elles lui posent la question.
Elle, elle a regardé tout autour d’elle, comme pour s’assurer qu’on n’allait pas l’entendre :
— Bien sûr, c’est Augustin.
— Encore une !
— Pourquoi pas ?
Les deux autres s’étonnaient :
— Seulement, disait Isabelle, il faut savoir s’y prendre.
Et alors, comme quand le merle, bien avant les autres oiseaux, pousse en l’air ses notes vives dans le silence du matin, son rire de nouveau a été entendu.
— Ah ! il faut savoir y faire. Il me disait : « Tu as déjà deux robes. » Je lui disais : « Deux, qu’est-ce que c’est ? Est-ce que tu ne voudrais pas, des fois, que ta femme soit bien mise ? Allons toujours chez Anthamatten. » Augustin avait vendu un veau ; il faut savoir profiter de l’occasion. Je lui disais : « Ça ne fera que trois mètres en tout, à cinq francs le mètre. Et tu sais, c’est chez Anthamatten qu’on trouve les meilleures étoffes ; c’est du solide, c’est du durable, on n’est pas volé. » Il ne voulait pas. Mais on leur met alors la main sur l’épaule, ou bien on les prend par le bras ; il faut qu’ils sentent le chaud de vous à travers leur veste ou un peu plus bas. On leur dit : « Est-ce qu’on entre ? » Et, quand pour finir ils veulent bien, voyez-vous, c’est alors nous qu’on ne veut plus…
Et riait :
— On leur dit : « Peut-être que c’est trop cher ; allons-nous-en, ça vaut mieux. » Mais c’est à présent eux qui veulent, c’est eux qui vous forcent : « Pas de ça, puisqu’on y est ! » C’est eux qui choisissent la meilleure étoffe ; on n’a plus qu’à se laisser faire et puis à les récompenser. « Ah ! tu verras, on leur dit, tu verras, toutes les autres femmes vont être jalouses ! » Ils sont contents.
Elle riait.
— Et c’est justement… C’est justement quand il fait vilain qu’il faut se faire belles, c’est par les temps tristes qu’il faut être gai ; vous ne pensez pas ? Oh ! bien sûr, disait-elle, c’est dans le gros de l’hiver qu’on doit se tourner vers le printemps. Seulement, s’il n’y avait point de printemps, jamais plus : c’était de quoi les femmes plus âgées discutaient en descendant. Mais elles s’étaient dit : « Il ne faut pas leur en parler, à ceux d’en bas, ils se moqueraient de nous. » Et allaient, puis venaient les hommes par groupes, cinq ou six ensemble, habillés de brun ou de noir, avec des bonnets de poil ou des chapeaux de feutre, les mains dans les poches ; et il y avait le père Métrailler que son fils menait par le bras. Il y avait Revaz avec son genou, mais son genou allait mieux. Il disait : « Ça va mieux, il n’y a pas à dire… C’est Anzévui. » Il marchait à côté de Pralong ; il disait : « C’est ces compresses… L’enflure a disparu, j’ai seulement encore un peu de raideur dans la jambe, mais Anzévui m’a dit de la fatiguer. Et tu vois, ma canne ; eh bien, je la prends en cas de besoin, mais pour le moment… » Il la mettait sous son bras : « Tu vois ? »
— Ah ! disait-il, il est quand même intelligent, cet Anzévui : c’est un savant ; il ne comprend pas seulement les choses, mais la mécanique des choses. Tu vois que j’ai bien fait de l’écouter.
— Tu l’as revu ? demandait Pralong.
— Bien sûr, j’ai été lui montrer ma jambe. J’étais bien forcé : lui, ne sort plus. Oh ! il ne va pas tant bien, il est sous ses plantes, il fait ses calculs. Seulement, disait Revaz, s’il ne s’est pas trompé en ce qui touche mon genou, peut-être qu’il ne se trompe pas non plus en ce qui touche… Qu’en penses-tu ?
— C’est toujours pour le 13 avril ?
— À ce qu’il dit, mais le mieux serait de garder la chose pour nous…
— Et puis de se tenir prêt.
— Si tu veux.
— De mettre ses affaires en ordre…
Ils ont passé, ils ont disparu ; et maintenant c’était Follonnier qui venait avec Arlettaz. Arlettaz avait laissé pousser sa barbe. Il y avait bien trois semaines qu’il ne se rasait plus. Le poil avait poussé tout droit, noir et blanc, de tous les côtés, tout autour de sa figure, et il se mélangeait à ses cheveux qu’il n’avait pas coupés non plus, de sorte qu’il avait comme deux têtes, une de barbe, énorme et ronde, et au milieu une petite de peau, ronde aussi, où il y avait deux petits yeux bleus.
— Tu te souviens pourtant bien d’elle, Follonnier ? Il n’y a pas si longtemps qu’elle est partie. Combien ça va-t-il faire de temps ?
Il comptait dans sa tête :
— Ça fera trois ans au printemps… Eh bien, Follonnier, qu’en dis-tu, est-ce qu’elle n’était pas belle ?
— Oh ! que oui, disait Follonnier.
Ils étaient les derniers à venir sur le chemin et bien en arrière des autres, mais ils ne semblaient pas quand même être pressés, parce que tout le temps Arlettaz s’arrêtait.
— Je ne me rase plus, à quoi est-ce que ça servirait ? C’est qu’elle était belle, vois-tu…
Le chemin tourne. Le chemin est étroit et blanc. Le chemin est comme si on avait un tapis sous les pieds, à cause que la neige est élastique et porte : juste cette épaisseur de neige que le petit triangle a laissée entre nous et le macadam. La neige fait un petit mur du côté du mont, un autre petit mur du côté du vide ; on n’a pas besoin de s’occuper de la direction qu’on va prendre puisqu’elle vous est tout indiquée et qu’on est empêché par ces murs de s’en écarter. Mais, tout à coup, c’est Follonnier qui s’était arrêté, interrompant Arlettaz :
— Tu vois ?
Son bras s’était tellement abaissé qu’il semblait qu’il montrât le bout de ses semelles ; mais, par-dessus le petit mur de neige, c’est la ravine qu’il désignait. Il n’y avait plus qu’à laisser son regard rouler comme une pierre deux cents mètres plus bas :
— Là, à côté du sapin, tu vois ?… C’est carré, c’est gris, on dirait une grosse pierre. Eh bien, tu sais ce que c’est ? la voiture du docteur, celui qui s’est déroché l’année dernière.
Arlettaz avait seulement hoché la tête ; Arlettaz avait continué :
— Comme sur une médaille. Tu te rappelles, au café, quand ils me disaient pour me taquiner : « Alors quoi, Arlettaz, tu fais des affaires avec ta fille ; elle est ressemblante ; combien est-ce qu’il te donne, le gouvernement ? » Ils sortaient un écu de leur poche, tu te rappelles, Follonnier ? Moi, je ne disais rien, bien sûr, mais je pensais : « Ils ont raison, c’est ressemblant. » Ah ! dix-neuf ans, disait-il. Et comme sur une médaille ; ah ! belle et bien faite et grande ; et c’est à sa mère et à moi qu’elle devait ça, mais sa mère est morte ; alors est-ce qu’il n’était pas juste que je la garde ? Eh bien, dis donc, j’ai pas pu.
Follonnier a haussé les épaules ; Follonnier a dit : « On ne peut jamais. » La route tournait encore une fois, et la vue, en temps ordinaire, change du même coup tout entière parce que tantôt on va vers le nord, tantôt vers l’est, tantôt vers l’ouest. Tantôt on va dans la direction des montagnes qui se dressent de l’autre côté de la gorge à deux mille mètres au-dessus de vous, tantôt du côté de la plaine qui est à mille mètres plus bas et on plane au-dessus comme dans un avion ; – ce jour-là, on ne voyait rien qu’un bout de chemin devant soi, un bout de pente d’un côté, le trou de l’autre.
— Y comprends-tu quelque chose ?
— On ne comprend jamais rien à rien.
— Pourquoi est-ce qu’elle est partie ?
— Pourquoi est-ce qu’elle serait restée ?
— Parce que, disait Arlettaz, parce que… Tu dois pourtant m’accorder ça, Follonnier, que c’était ma fille… Et, une fille, à quoi est-ce que ça sert, si elle n’est pas là ? Une fille, c’est pour le plaisir, et, quand elle est loin, le plaisir est loin.
— Tu aurais dû le lui dire.
— J’osais pas.
Il a réfléchi, il a repris :
— Et aussi on ne sait pas bien…
Des corbeaux criaient de temps en temps dans les airs au-dessus de vous et n’étaient pas vus. De temps en temps, parmi les sapins redressés contre l’escarpement lui-même à pic, des geais qui n’étaient pas vus non plus faisaient entendre des grincements comme ceux d’une girouette rouillée, sous les à-coups d’une rafale. Et Arlettaz se disait : « C’est ça, j’ai pas su. » Il se disait encore : « Et peut-être que, si j’avais su ?… » On voyait Arlettaz secouer la tête, marchant les bras écartés, son chapeau à la main ; mais il n’y avait rien pour lui répondre que les cris des corbeaux et le ricanement des geais.
— Cette fois, disait Follonnier, c’est le camion d’Antonelli.
Il y avait cette fois une petite paroi de rocher qui était posée sur une autre petite paroi de rocher, avec un replat entre elles deux ; et là, sur ce replat, était le camion retourné, les roues en l’air, mais il ne lui en restait que deux.
— Et, disait Arlettaz, qu’est-ce qu’il faut faire ? Et tu sais que je l’ai cherchée. Deux ans que je la cherche, dis donc… Et tu comprends que, si on me dit que c’est la fin de tout, moi, je réponds : « Tant mieux ! » Comme ça je n’aurai plus besoin de la chercher. Jusqu’aux deux bouts du pays, aux sources du Rhône et au lac, ça va faire trois ans, ça me fera du repos. Et ça viendra au bon moment, dit-il, parce que je n’ai plus rien. Mais c’est là que sans doute Follonnier l’attendait :
— Plus rien ?
— Non, plus rien, disait Arlettaz ; c’est que ça coûte cher, ces voyages, et ils donnent soif, qu’est-ce que tu veux ? J’ai vendu mes chèvres, j’ai vendu mes vaches, j’ai vendu mes prés, il ne me reste que mes outils. Est-ce que tu m’achètes mes outils ?
— Non, dit Follonnier, en fait d’outils, j’ai déjà ce qu’il me faut. Mais il y a ton champ des Empeyres, si tu veux.
— Il n’est pas à vendre.
— À quoi est-ce qu’il te servira, si c’est la fin ?
— Et à toi ?
— Qu’est-ce qui te dit que je veux finir, moi ?
— C’est que c’est un bon champ ; on y fait le meilleur seigle du pays. Dis donc, Follonnier, tu le voudrais, ce champ ?
— Oh ! disait Follonnier, j’y tiens pas… Seulement, je vois bien ce qu’il te faut. Tu as raison, tu veux avoir ta liberté. Et tu te dis que, si c’est la fin, il ne serait pas mauvais d’avoir un peu d’argent en poche pour l’attendre. Moi, si je t’achetais ce champ, ce serait bien pour te rendre service…
La route traversait un bois de mélèzes qui avait perdu ses petites plumes vertes, mais la neige avait pris leur place avec son léger duvet. Le bois était gris et blanc au lieu d’être vert et gris. Il était comme une fumée avec des trous dedans et par ces trous on ne savait plus si, ce qu’on voyait, c’étaient les branches chargées de neige ou la pente qui était derrière.
Puis Saint-Martin d’En Bas était paru, qui se trouve au fond d’un repli et serre autour d’une grande église de pierre beaucoup de maisons aux toits bas.
— Combien ?
— Ma foi.
Ils firent encore quelques pas sans rien dire, puis Follonnier :
— Dans les cinq cents.
— Quinze cents, dit Arlettaz.
L’église ne sonnait plus depuis longtemps. On a entendu qu’ils avaient commencé à chanter sous les voûtes, parce que la porte reste ouverte à cause de ceux qui n’entrent pas, mais écoutent la messe depuis dehors, devant la porte, ôtant par moment leurs chapeaux.
— Écoute, dit Follonnier, veux-tu qu’on reparle de la chose ce soir chez Pralong ? Apporte un papier pour le cas où, des fois, on arriverait à s’entendre.
Ils avaient assisté à la messe, ils étaient remontés à Saint-Martin d’En Haut ; il y avait eu une courte journée de six ou sept heures, c’est tout, à cause du ciel malade et de la hauteur des montagnes ; après quoi on avait vu dans l’ombre trembler une goutte de feu. C’est que la journée est finie. Encore une. Et puis combien encore en tout ?
Combien ça va-t-il faire encore de semaines ?
— Et combien est-ce que tu dépenses par semaine ?
Pralong n’avait pas l’air d’écouter. Pralong lisait le journal. La grosse Sidonie était en train de régler la T.S.F. Mais Follonnier n’avait plus lâché Arlettaz, sachant bien qu’il ne faut jamais abandonner une affaire avant qu’on ne l’ait menée à bonne fin. Il avait donc fait asseoir Arlettaz en face de lui.
C’est un beau parleur, il disait à Arlettaz :
— Voyons, combien est-ce qu’il te faut par jour ?
Il avait sa pipe au coin de la bouche, et il y avait une espèce de sourire de l’autre côté de sa bouche ; mais ses yeux, eux, ne bougeaient pas, tandis qu’il regardait Arlettaz avec fixité :
— Combien est-ce qu’il te faut par jour ? et qu’est-ce que tu bois par jour ? Oh ! tu peux compter largement, disait-il… Eh bien, c’est ça, mettons cinq litres. Et puis il te faudra aussi aller chez le coiffeur. La nourriture, le vin, les impôts, mais bah ! les impôts ne comptent plus, si tout est fini en avril… Ça ne fait rien, mets le tout ensemble.
— Il y a aussi les déplacements, c’est ce qui coûte le plus cher.
— Quels déplacements ?
— Oh ! dit Arlettaz, il faudrait pourtant bien que j’aille à présent jusqu’au Bouveret ; c’est le seul bout du canton que je n’aie pas encore tenu ; et, Dieu sait ? c’est au bord de l’eau ; peut-être qu’elle aime l’eau…
— Tu m’as dit que ce n’était plus la peine.
— J’aimerais mieux qu’elle soit avec moi, quand le temps en sera venu, parce qu’on passerait ensemble.
— Eh bien, mets les déplacements.
— J’ai déjà été à Brigue, j’ai déjà été chez les Allemands (2) et, de l’autre côté, j’ai fait Martigny, Saint-Maurice, Monthey ; il n’y a que ces bords du lac où les poissons sont logés par étages, les petits en haut, les gros au fond.
— 750 ?
— Non.
— 800 ?
— Non.
Les garçons étaient entrés. Ils étaient six jeunes gens, dont Lucien Revaz ; ils ont dit : « Bonsoir, Sidonie. »
— Et moi qui me disais que tu étais détaché de tout.
Mais ils prenaient Sidonie par la taille, parce qu’ils étaient plusieurs et qu’être plusieurs rend entreprenant. Ils étaient gais, ils n’ont pas écouté ce que les deux hommes pouvaient bien se dire ; ils avaient été s’asseoir à l’autre bout de la salle à boire, trois sur un banc, trois sur l’autre banc. « Tu me lâches ? sans quoi attention ! » disait Sidonie en levant la main, et, eux, ils riaient.
— Eh bien apporte-nous à boire, lui disaient-ils.
Ils s’installent, ils portent leurs figures à la rencontre les unes des autres, étant soutenus plus en dessous par leurs coudes qu’ils ont appliqués sur le bois peint en brun des tables, et il y a tout autour d’eux un lambrissage qui monte jusqu’à mi-hauteur des murs. Ils avaient fait marcher la T.S.F., c’était une valse ; puis étaient venues des nouvelles de la guerre d’Espagne ; alors ils s’étaient tus tous ensemble, ils avaient écouté, et ensuite étaient restés un moment encore silencieux. C’est alors qu’on avait entendu Arlettaz qui disait :
— Je suis détaché…
— On ne le dirait pas, a répondu Follonnier.
Eux, ils se poussent du coude. Ils se penchent de nouveau les uns vers les autres :
— C’est la faute d’Anzévui ; ils ont tous perdu la tête.
Ils se sont tournés vers Arlettaz. Ils voient que les poils de sa barbe qui sont raides pointent en avant de deux bons centimètres tout autour de sa figure, au-dessus de la chemise au col déchiré, sous un bonnet de poil, qui semble les continuer ; et, au milieu, il y a le rond de sa figure, et, dans le rond de sa figure, il y a deux petits yeux bleus. « Il ne lui manquait plus que ça, pensaient-ils ; il était déjà devenu fou à cause de sa fille ; le voilà à présent devenu fou deux fois. » Ils se poussent du coude, ils parlent à voix basse ; mais Lucien, tout à coup : « Il n’y a pas que lui. »
Il disait :
— Il y a mon père…
Il appelle Sidonie :
— Toi, tu es au courant. Eh bien, as-tu seulement vu Gabrielle aujourd’hui ? Et, moi, j’ai pas pu aller la trouver. C’est mon père qui me défend… Il a, lui aussi, perdu la tête, parce que je pensais me marier à la fin de l’hiver ; eh bien, mon père ne veut pas. Elle n’ose plus venir me voir ; moi, je n’ose plus aller chez elle… Et on n’a point d’argent, ni l’un ni l’autre.
Il dit :
— C’est Sidonie qui fait nos commissions… Tu es une bonne fille, Sidonie.
Il a dit :
— Il y a mon frère qui est dans le vignoble ; eh bien, je crois que je vais aller le rejoindre parce qu’il a du moins le lac pour se distraire, lui, de l’eau, du bleu et deux soleils à ce qu’il dit ; et nous rien que du blanc…
— Du blanc ! disait un des garçons, c’est plutôt du gris.
— Oui, du gris et point de soleil.
— Et encore moins dans quelque temps…
Mais alors ils éclatent de rire ; et Follonnier à l’autre table dit :
— Neuf cents.
Puis ils ne disent plus rien du tout, c’est-à-dire Follonnier et Arlettaz, et ne se regardent même plus, bien qu’assis en face l’un de l’autre ; tout ce qu’ils font c’est de temps en temps lever leur verre et se disent : « Santé ! » C’est qu’Arlettaz a soif et Sidonie rapporte un litre. Follonnier articule un chiffre, Arlettaz secoue la tête, c’est tout. Et c’est de l’autre côté de la salle à boire que vient maintenant tout le bruit, parce que c’est de la jeunesse et que la jeunesse est bruyante. Ils disaient à Sidonie :
— Dis donc, tu viens avec nous ? Oh ! c’est qu’on a besoin de toi, il faut qu’il soit embêté, Anzévui, tu comprends. Il nous faut une fille… Tu lui dirais : « Monsieur Anzévui, ça ne va pas, ça ne va pas. Il me faudrait de la tisane de fenouil… » Ils regardaient son ventre qui bombait sous le tablier, car elle était forte de sa personne :
— Et Dieu sait peut-être que tu n’auras pas besoin de dire un mensonge.
— Malhonnêtes ! Lâchez-moi !
— Dieu sait ; tu diras à Anzévui : « C’est cette fin de mois ; est-ce que je peux entrer ? » Nous, pendant ce temps, on se cache.
Mais elle s’était sauvée dans la cuisine dont on l’entend qui ferme la porte à double tour :
— Mille !
Le mot avait été lâché par Follonnier, mais, eux, à la table du fond ils ne l’avaient pas entendu : ils riaient trop et de trop bon cœur. C’est Arlettaz qui l’a reçu en plein dans son bonnet de poil, parce qu’il continuait à baisser la tête ; le mot a fait que le bonnet de poil s’est relevé, amenant à sa suite une petite figure ronde qui était au milieu de sa barbe comme la lune dans un halo. Et, cette fois, il ne l’avait pas secouée, il n’avait pas dit non, il n’avait rien dit : il regardait seulement Follonnier avec ses deux petits yeux bleus.
— Oh ! c’est bien parce que c’est toi, disait Follonnier, et c’est bien parce que j’ai souci de t’assurer une bonne fin de vie ; c’est la moitié de plus qu’il ne vaut, ce champ… Mais enfin, disait-il, si tu es content comme ça. As-tu le papier ?… Arlettaz ne disait toujours rien.
— Je pensais bien que tu ne l’aurais pas, c’est bien pourquoi j’en ai préparé un.
Il tire de la poche intérieure de son veston un vieux portefeuille en cuir brun, tout déchiré, qui était noué d’une ficelle ; il a dénoué la ficelle difficilement avec ses gros doigts, y mettant plus de temps peut-être encore qu’il n’aurait fallu, mais c’était un moyen de ne pas trop laisser voir le sourire de contentement qu’il n’avait pas pu empêcher de se marquer sur son visage ; il sort du portefeuille un papier plié qu’il a tendu à Arlettaz, qui continuait à être immobile et silencieux.
— Tiens.
Il y avait sur le papier : « Le soussigné déclare vendre au citoyen Follonnier Placide son champ des Empeyres pour la somme de (il y avait un blanc). Dessous : Signature. »
— C’est en attendant qu’on aille chez le notaire, parce qu’il faudra d’abord qu’on prenne rendez-vous. Si tu es d’accord, tu signes.
— Combien est-ce que tu me donnes d’avance, argent comptant ? dit Arlettaz, j’ai plus rien.
— Combien veux-tu ?
— Cent francs.
— Cinquante.
Mais cette fois Arlettaz avait tenu bon. Il voulait ses cent francs et tout de suite. Follonnier soupira. Et puis :
— Il nous faudrait une plume et de l’encre ; on ajoutera sur le papier : reçu 100 francs, et tu signes. Hé ! Sidonie. Il vit qu’elle n’était plus là, il vit que la porte de la cuisine était fermée. Dans leur coin, les garçons s’étaient mis à parler bas ; et l’un ou l’autre, de temps en temps, jetait vers les deux hommes un regard par-dessus l’épaule. Follonnier se lève. Follonnier cherche à ouvrir la porte de la cuisine, elle était fermée à clé :
— Hé ! Sidonie, où es-tu ?… C’est pour avoir de quoi écrire.
Elle avait entr’ouvert la porte dont elle retenait le bas avec le pied.
— Qu’est-ce qu’il y a ? disait Follonnier, qu’est-ce qu’il te prend ? il me faudrait une plume et de l’encre… Où, disait-il, où ça, qu’est-ce que tu dis ? Parce qu’elle se refusait à le laisser entrer :
— Derrière la caisse de la T.S.F.
Elle avait refermé la porte ; il avait été voir derrière le poste de T.S.F. ; il s’était aperçu qu’il ne fonctionnait plus, quelqu’un avait dû tourner le bouton, puis était revenu s’asseoir ; et eux, les garçons :
— Alors, c’est entendu, on y va. C’est toi, Lucien, qui feras la fille. Seulement Sidonie ne voudra jamais nous prêter ses habits.
— Il faudra pourtant bien qu’elle vienne, si elle veut qu’on la paie.
— Une vieille jupe, un caraco, un fichu et puis de quoi te faire la figure belle blanche, Lucien ; et puis une allumette pour les sourcils, tout sera dit… Et quelque chose pour faire rond par devant.
— Tu roules ta veste en boule. Ils regardaient toujours à la dérobée vers l’autre table, comme pour s’assurer qu’ils n’avaient pas été entendus ; c’est ainsi qu’ils ont vu Arlettaz qui prenait la plume et Arlettaz a dû écrire quelque chose, puis Follonnier avait tendu la main comme s’il s’attendait à ce qu’on lui passât le papier, mais Arlettaz n’y avait pas consenti : alors Follonnier avait rouvert son portefeuille. Arlettaz s’était mis à taper avec son litre vide sur la table ; heureusement qu’il était fait de gros verre avec un cul épais, parce qu’on ne venait pas et Arlettaz tapait de plus en plus fort. Enfin la porte de la cuisine s’est ouverte :
— Qu’est-ce qu’il y a ?
Et Arlettaz :
— Un litre. J’ai de l’argent.
Follonnier se lève et dit :
— Moi, je vais me coucher.
Il avait bien fallu que Sidonie vînt pour finir, à cause qu’il y a des obligations dans le métier, et, s’étant glissée par l’ouverture de la porte qu’elle avait seulement entrebâillée, était venue jusqu’à la table d’Arlettaz avec son litre.
— Oh ! disaient-ils, hé ! Sidonie, écoute, on te promet, on te laissera tranquille, on a quelque chose à te demander.
— Oh ! Sidonie, tu ne veux pas nous croire, eh bien, regarde…
Et Lucien et les autres, avec l’index de la main droite mis sur l’index de la main gauche, faisaient le signe de la croix. Arlettaz avait rempli son verre, l’avait vidé d’un coup, l’avait rempli de nouveau.
— Qu’est-ce que vous me voulez encore ? disait Sidonie.
Elle leur parlait de dessus le seuil de la cuisine, toute pleine de méfiance, prête à refermer la porte sur elle en cas de besoin ; et eux, riaient bas, eux d’un mouvement d’épaules désignaient Arlettaz assis à sa table, la tête penchée en avant sur ses bras rejoints ; mais il ne paraissait rien voir et ne paraissait rien entendre, étant tout occupé à des choses qui se passaient au dedans de lui, les yeux retournés vers l’intérieur.
— Tu viens ?
Elle a fait un pas de leur côté, ils lui ont fait signe de s’approcher encore.
— Écoute… Elle a vu qu’elle pouvait s’approcher tout à fait.
— Écoute, tu n’aurais pas une vieille jupe et un vieux caraco à nous prêter ?
— Pourquoi faire ?
Ils parlaient bas. Ils ont montré Arlettaz.
— On te dira ça une autre fois.
— Et puis un peu de farine et d’eau…
— Et puis un miroir…
Et ils ont dit :
— Si on allait à la cuisine ?…
Sidonie était intriguée ; en même temps, elle voyait bien que les garçons ne pensaient plus à elle, ayant sans doute leur idée ; la curiosité a été la plus forte :
— Si vous voulez.
Ils ont passé devant Arlettaz ; Arlettaz n’a pas bougé. On ne savait pas si, ce qu’on voyait, c’était son bonnet de poil ou bien le dessus de sa tête. On ne savait pas si, ce qu’on voyait, c’était sa barbe ou ses cheveux. Ils avaient pensé : « Il est saoul, ça lui arrive. » Et, étant entrés dans la cuisine, ayant poussé la porte derrière eux :
— Tu comprends, Sidonie, puisque tu ne veux pas venir, c’est Revaz qui va faire la fille. Oui, mets-toi là qu’il te copie… Il faudrait seulement encore un traversin, tu en as un ; on te le rapportera. On va aller en visite chez Anzévui avec une fille, mais c’est blanc, les filles, et c’est rond les filles, alors il faut que tu nous aides…
— Sidonie, disaient-ils, il faut que tu nous donnes un baiser…
Mais cette fois elle avait ri, puis était sortie de la pièce, pendant qu’eux allaient fouiller dans l’armoire où ils ont trouvé de la farine et ils en ont mis un peu dans une tasse. Sidonie revenait avec des habits sur le bras. C’était une jupe et un corsage.
Elle disait :
— Ah ! les malins. Et puis, demandait-elle, vous irez ? et puis quoi ?
— C’est pour lui faire peur, dis donc… Est-ce qu’il ne le mérite pas ?
— Comment est-ce que vous allez lui faire peur ?
— Eh bien, tu comprends, Revaz, c’est une fille et il entre.
Anzévui doit avoir l’habitude de recevoir des visites la nuit. Il vous dit : « C’est cinq francs » ; on les lui donne, on peut entrer… Il te faut seulement faire attention, Lucien, qu’il ne te reconnaisse pas… Pendant que Revaz enfilait la jupe, puis c’est Sidonie elle-même qui lui a arrangé la poitrine, parce qu’elle s’y connaissait.
— Et puis fais attention à ce que tu vas lui dire et puis fais attention à ta voix. Essaie d’abord, puisqu’on est là, on te dira si ça va.
— « Eh ! monsieur Anzévui, mon pauvre monsieur Anzévui, ça ne va pas. » Revaz avait une petite voix de fille ; on disait :
— Ça va.
— « Je ne sais pas ; ça n’a pas voulu venir le mois dernier ; ça va faire déjà quinze jours. Alors je suis venue voir si vous n’auriez pas quelque chose pour moi… quelque chose, monsieur Anzévui… »
— Ça va.
Ils éclataient de rire, puis se tiennent devant Lucien Revaz avec la tasse de farine et, avec le coin d’un linge qu’ils ont mouillé, lui faisaient le visage blanc.
— Parce qu’il faut, bien sûr, que tu aies mauvaise mine et puis ça va cacher ta barbe… À présent, mets ton fichu. Avance-le un peu sur le front… As-tu une allumette ? bon, allume-la.
Et, avec le charbon de l’allumette, ils lui ont mis du noir sous les yeux.
— Il te faudrait encore un peu de rouge à lèvres, comme les demoiselles de la ville. T’en as pas, Sidonie ? tant pis… Dis donc, un peu de sirop ? Parce qu’il y avait tout plein de bouteilles de sirop à moitié vides sur un rayon à côté de la porte ; et ils débouchent une bouteille de sirop de framboise avec quoi ils ont humecté l’autre coin du linge qu’ils ont passé sur la bouche de Lucien, lui tendant le miroir :
— Qu’en dis-tu ? — Ah ! charrette.
Lucien ne s’était pas trouvé vilain, même il s’est trouvé joli. Il s’était mis à rire pour mieux montrer ses dents qui étaient devenues plus blanches à cause des lèvres rouges :
— Eh bien, ça y est. Est-ce qu’on y va ?
— On y va. Et tu comprends, Sidonie, nous autres, on va faire la police, parce qu’on laissera entrer Revaz et puis on cogne à la porte : « Ouvrez-nous, au nom de la loi ! Inutile de chercher à vous expliquer, on a tout entendu… Arrivez !… »
Ils parlaient maintenant tout haut, et Sidonie a dit :
— Attention, il y a Arlettaz. Il pourrait vous vendre…
Mais quelqu’un, qui avait entre-bâillé la porte, passant la tête par l’ouverture, a regardé ce que faisait Arlettaz ; Arlettaz n’avait pas bougé, seulement son litre était vide.
— Il te faudra aller le lui remplir, ont-ils dit à Sidonie… Êtes-vous prêts ? se disaient-ils les uns aux autres… Parce que, tu comprends, on emmène Anzévui ; on lui dira qu’on va l’enfermer ; et il se trouvera bien quelque part un creux avec une bonne épaisseur de neige en poudre pour l’y envoyer nager…
Ils n’ont pas eu besoin de passer par la salle à boire : la cuisine avait une seconde porte qui ouvrait sur le dehors. Il était peut-être onze heures du soir. Il n’y avait pas une seule étoile. Heureusement qu’un des garçons a sorti de sa poche une lampe électrique. Ils sont modernes. Ils aiment les nouveautés. On n’avait qu’à peser sur un bouton. Ils s’étaient ainsi avancés tout le long de la ruelle ; alors ils avaient vu ces deux gouttes de feu pendre dans rien du tout, l’une plus proche et un peu au-dessous d’eux à main droite, l’autre plus lointaine et vague, au-dessus d’eux.
— Regarde-moi ça ! disaient-ils. C’est encore de sa faute au vieux… Montrant le point de feu d’en bas : c’était la lampe à huile de Brigitte parce qu’elle ne s’éteint plus jamais ; et il y avait là-haut l’autre fenêtre éclairée : c’est ce vieux fou, parce qu’il passe une partie de la nuit à lire dans ses livres ; juste de quoi attirer le malheur sur la commune, disaient-ils, parce qu’il doit être un peu sorcier, mais on va lui montrer qu’on l’est encore plus que lui, quand on veut.
Lucien Revaz s’est avancé tout seul dans la direction de la fenêtre éclairée ; eux, avaient été se cacher, deux d’un côté de la maison, trois de l’autre. Ils regardaient Revaz s’approcher et le distinguaient vaguement à cause de la lueur qui dépassait un peu le mur et dans laquelle il était entré : tout à fait une fille de chez nous, une pauvre fille ; laquelle alors avait joint ses mains sur sa ceinture et penchait la tête sous son fichu, pendant qu’ils étouffaient leurs rires, les garçons.
— Monsieur Anzévui… Oh ! mon pauvre monsieur Anzévui, ouvrez-moi…
Elle a heurté aux carreaux. Les autres regardaient de derrière chacun des angles de la maison et il s’est passé un petit moment, pendant qu’elle recommençait :
— Ouvrez-moi, monsieur Anzévui, c’est que j’ai besoin de vous. Oh ! je suis bien malheureuse… On ne venait pas ; elle cogne de nouveau aux carreaux.
— Monsieur Anzévui, c’est que c’est pressant… Oh ! monsieur Anzévui, ayez pitié de moi.
Mais alors les garçons avaient vu Revaz reculer un peu, reculer un peu plus encore ; puis faire brusquement demi-tour et disparaître dans la nuit. Ils s’y sont jetés à sa suite, essayant bien de le rejoindre, mais ils n’osaient pas appeler ; et il y avait seulement la lumière de la lampe de poche qui s’allumait soudain, faisant un rond blanc sur la neige, puis s’éteignait tout aussitôt.
VI
« Je plante un clou ; ça en fait douze… Je plante un clou tous les dimanches ; ensuite je vais voir s’il y a encore de l’huile dans la lampe, et il faut aussi la moucher. » Je monte sur un tabouret avec ma hache, je tiens la pointe de la main gauche et avec le dos de la hache je tape dessus. » La lampe éclairera quand le soleil sera éteint. Si le soleil s’en va tout à fait, elle, elle me reste. » C’est pourquoi il faut y mettre tous ses soins. Il faut veiller à ce que l’huile n’épaississe pas dans le récipient ; il faut prendre garde à ce que la mèche ne soit ni trop courte, ni trop longue ; quand elle est trop courte elle s’éteint, quand elle est trop longue elle charbonne. »
Elle s’était assise près de la fenêtre, elle était pleine de contentement ; elle ne savait pas pourquoi. Car le jour venait et ne venait pas. Il venait bien, parce que c’était l’heure, mais est-ce le jour ou le brouillard, cette coloration de l’air ? Ce n’était pas le vrai jour, c’était une fausse lumière ; et elle semblait monter de la neige à la couche accrue, comme si le peu de clarté qu’il y avait dans le peu d’espace qu’on pouvait voir provenait d’en bas, non d’en haut. Mais, Brigitte, elle était au chaud derrière sa fenêtre ; elle, elle avait sa lumière à elle, de sorte qu’elle n’avait qu’à laisser faire et était dans le repos.
« Et il dit qu’il ne sait pas, il ne sait pas bien encore, mais il calcule. Il est sous ses plantes et il calcule. Il voit que la terre va balancer un peu et le soleil n’éclairera plus, et, nous, nous serons dans la nuit, mais qu’est-ce que ça fait ? si nous sommes prêtes, nous autres, si nous avons notre petite lampe, et nous serons assises sous notre petite lampe, disant : « Que ce qui doit s’accomplir trouve son accomplissement. »
Elle écoutait ; on n’entendait rien. Il avait encore neigé pendant la nuit. Il n’y avait pas eu de vent, et la neige tombait du ciel, puis tombait, comme quand un arbre perd ses feuilles. Il n’y avait jamais eu autant de nez d’enfants aplatis derrière les vitres que ce matin-là, parce qu’on les empêchait de sortir. Sitôt levés, ils couraient à la fenêtre où leur haleine faisait fondre la glace ; du dehors, on voyait leurs figures être au milieu d’un petit rond noir, avec un nez écrasé et deux yeux qui vous regardaient. Elle se tenait bien tranquille.
« À midi, pensait-elle, j’irai chez Anzévui. Il est bien tranquille, lui aussi ; c’est que tous les deux on a fait sa vie. » Et on la repasse dans sa tête avant qu’elle finisse, songeant aux moments de bonheur qu’on a eus, qui font dedans comme des nœuds à une corde, ce qui l’empêche de vous glisser trop vite dans les mains, c’est ce qu’elle se disait ; pendant qu’Isabelle était dans son lit avec son mari Augustin Antide, et il y avait au-dessus du lit leur cousin le gendarme dans son bel uniforme.
— Quelle heure est-il ?
— Huit heures.
— Déjà.
C’était à cause du peu de jour qui se voyait dans les petites fenêtres, car on ne peut pas dire qu’il entrait. Il venait, il se heurtait au verre et là il était arrêté.
« L’été, j’y mettrai des fleurs dans des caisses ; mais, toi, qu’est-ce que tu fais, Augustin ? Qu’as-tu besoin de bouger comme ça ? »
— Je vais me lever.
— Tu as le temps.
— Et les bêtes ?
— Tu sais bien que c’est Jean qui gouverne ce matin. Ah ! l’agité…
Puis, se penchant à son oreille : « Qu’est-ce qu’il y a, Augustin ? On ne va pas pouvoir aller à la messe aujourd’hui ; il y a trop de neige. Et voilà alors que, pour une fois qu’on aurait l’occasion de faire la grasse matinée, tu ne peux pas rester en place. »
Elle passait doucement sa jambe contre sa jambe à lui, doucement frottait sa cuisse à sa cuisse ; puis, parce qu’il lui tournait le dos, a avancé à sa rencontre la bonne chaleur de sa poitrine.
— Ah ! le grand fou, disait-elle. Et puis elle lui disait : « Bouge pas ! » Et lui passant un bras par-dessous, l’autre bras par-dessus le corps, avec ses mains va le chercher.
— Est-ce que c’est à cause d’Anzévui ? Eh bien, si le soleil, sais-tu ce qu’on ferait ? si le soleil ne revenait pas. Dis donc, sais-tu ce qu’on ferait, nous deux ? On se mettrait au lit pour ne pas avoir froid. Elle lui soufflait chaud dans la nuque, peu à peu l’amenait à elle, peu à peu le faisait se tourner de son côté :
— Et puis sais-tu ce qu’on ferait ?
Alors elle a été le chercher avec sa bouche, et, faisant dans la nuit comme si elle se trompait :
— Augustin, où es-tu ? Oh ! disait-elle, c’est pas toi. C’est ton menton, tu piques… Et ça, qu’est-ce que c’est ? c’est ton nez, c’est pas toi… Mais, dis, sais-tu ce qu’on ferait ensuite ?… parce qu’il n’y aurait plus besoin de bouger ou on bougerait seulement un petit peu. Augustin, dis, si le soleil ne revenait pas… Eh bien, on serait là, on serait là ensemble… On ne verrait rien, on n’entendrait rien, on ne saurait rien ; et on ne serait que nous deux, parce que c’est bon, rien que nous deux.
Puis les mots ne sont plus venus ; mais c’est une souris qui est sortie de son trou dans le grenier au-dessus d’eux, et trotte ; puis il y a quelque chose qui dégringole, puis c’est comme si on roulait une noix ; – ce qui n’avait pas empêché, un instant plus tard, Augustin de se jeter à bas du lit et de s’habiller hâtivement.
Or, le lendemain ou deux jours après, Cyprien Métrailler était dans sa cuisine avec Tissières. C’était au commencement de l’après-midi ; eux, ils étaient dans la cuisine, et le père Métrailler était monté se reposer un moment dans sa chambre. On n’a pas beaucoup d’ouvrage l’hiver à la montagne, et il vaut encore mieux dormir que de ne rien faire. Toute la matinée, Métrailler avait été occupé à couper du bois et c’était le vieux qui le ramassait, empilant ensuite les morceaux contre le mur, ce qui est une besogne où on n’a pas besoin des yeux, parce que les mains y suffisent. Le vieux se baissait : on le voyait tâtonner sur le sol autour de lui ; et, ramassant les morceaux un à un, à mesure qu’il les rencontrait sous sa main, les logeait au creux de son bras comme un enfant qu’il aurait eu. Le vieux Métrailler tenait à montrer qu’il pouvait encore être utile. C’est ainsi que midi était venu.
Eux, étaient à présent dans la cuisine, c’est-à-dire juste au-dessous de la chambre du père Métrailler, avec une bouteille de marc. Cyprien avait posé la bouteille et les deux petits verres sur un tabouret, entre eux deux ; et, de temps en temps, ils tiraient tous les deux sur leur pipe, les pieds au chaud, ayant parlé de choses et d’autres, puis ils n’avaient plus rien dit. On voyait par la fenêtre au-dessus d’un premier toit, un second toit, c’était tout. Et ils n’étaient chacun, avec ses deux pentes, qu’un étroit triangle de bois noir, mais il y avait dessus deux énormes plumiers blancs de plus d’un demi-mètre d’épaisseur. Deux énormes sacs de plumes à demi-gonflés dans une couette bien propre, avec cette seule particularité qu’ils se présentaient par la tranche et sur cette tranche les différentes couches étaient marquées par un trait plus sombre, par le plus ou moins de densité de la neige, par son plus ou moins d’épaisseur. Ainsi venaient ces masses blanches qui s’appuyaient contre le gris du ciel, et c’était froid contre ce gris qui était triste.
Tout à coup Tissières avait levé la tête ; et, sans regarder Métrailler :
— Dis donc… Puis :
— Tu ne m’as jamais dit ce qui t’était arrivé.
— Quand ça ? — Quand on a été te chercher, tu sais…
— Oh ! je serais bien revenu tout seul…
Ils ne se regardaient ni l’un ni l’autre, parce que Tissières regardait le feu en fumant sa pipe, et Métrailler ses pieds, les coudes sur les genoux, penché en avant.
— C’est vrai ?
— Tu as bien vu ; j’étais pas loin d’être arrivé…
— Oui, mais où étais-tu ?
— Ah bien, oui, disait Métrailler, j’étais dans les fonds…
— Et il faisait nuit.
— Et puis quoi ? disait Métrailler.
Les mots lui sortaient difficilement de la bouche ; il ne répondait qu’avec peine et comme malgré lui. Seulement il semblait assez que Tissières fût décidé à tout savoir et à ne pas se laisser décourager par les silences de son collègue, de sorte qu’il avait poursuivi quand même :
— Ma foi, moi, j’étais inquiet, parce que ces fonds, la nuit… Et, nous autres, on suivait tes traces et on avait un falot : toi…
Cyprien s’était redressé, il a retiré sa pipe de sa bouche :
— Est-ce que je ne connais pas la montagne aussi bien que toi ?
— C’est pas ce que je veux dire ; seulement, disait-il, comment est-ce que tu avais fait, toi, pour perdre tes traces au retour ?
Ils étaient deux amis, ils chassaient toujours ensemble ; et voilà que Métrailler avait brusquement rebaissé la tête, ayant vu sans doute qu’il ne lui serait pas facile de tromper Tissières.
Il lui a dit : « Tu ne bois pas ? » Il a rempli les verres qui étaient vides. Ils ont bu, l’un et l’autre ; c’était un bon marc réchauffant. C’est une bouffée de chaleur avec un parfum qui vous descend par un tuyau jusque dans le ventre et par un autre vous monte dans la tête où elle vous dégèle les idées qu’on a. Si bien que Métrailler s’était décidé :
— Tu comprends, j’étais monté jusqu’au Grand-Dessus.
— Au Grand-Dessus !
— Oui.
— Pourquoi faire ? et puis tu as pu ?
— J’ai pu. Pourquoi est-ce que je n’aurais pas pu ? Et puis écoute bien. Tu te rappelles ce qu’a dit Anzévui. Eh bien, moi, ça m’a fait l’ennui du soleil et je me suis dit : « Allons le chercher… » Tu n’as pas voulu, toi ; c’est bien ta faute, tout ça, Tissières : oh ! je ne t’en veux pas, c’est oublié. Mais Dieu sait peut-être que, si tu avais été là, on aurait tiré une chèvre, quand même on n’y voyait pas à plus de vingt pas. Enfin on aurait été deux. Et tu aurais vu, toi aussi.
— Quoi ?
— Eh bien, dit Métrailler, la tête coupée, parce que c’est tout ce que j’ai vu.
— La tête coupée ?
— Ma foi oui, et, nous autres, on est dans le brouillard, mais peut-être vaut-il mieux qu’on y reste jusqu’à ce que… Parce qu’à moi ça m’a porté un coup. J’ai lâché mon fusil. J’ai voulu aller le chercher, j’ai glissé…
Mais alors on a entendu un craquement dans la chambre au-dessus d’eux, puis presque en même temps un bruit comme celui d’un corps qui tombe. Les deux hommes ont grimpé en courant l’escalier. Ils ont trouvé le père Métrailler étendu sur le plancher, à côté de son lit. Un peu d’écume lui sortait de la bouche ; il avait les yeux tout blancs. Ils l’ont pris l’un par les épaules, l’autre par les pieds ; il était raide, quoique chaud ; et eux le soulevaient comme s’il avait été une statue, une statue taillée dans de la pierre grise. Il y avait seulement un peu de sang sur le plancher parce qu’il était tombé à la renverse ; il y a eu seulement un peu de sang au creux de l’oreiller quand ils l’eurent couché sur le lit.
— C’est rien, disait Métrailler, père, c’est rien ? Dites donc, père, c’est moi, vous m’entendez ?
Tandis que Tissières avait ouvert la fenêtre et appelait par la fenêtre, puis est sorti en courant. Et alors le monde est venu. Et il est venu même plus de monde qu’on n’aurait voulu. Tout le village était arrivé, on disait : « Qu’est-ce qu’il y a ? » — « C’est le vieux Métrailler. » — « Qu’est-ce qu’il a eu ? » — « C’est un coup de sang, il est tombé de son lit. » Et les femmes disaient : « Il faut lui mettre des sangsues derrière les oreilles. » — « Oui, mais où les prendre ? » — « Il faut le faire boire chaud. » — « On ne peut pas lui ouvrir la bouche. » — « Il faut téléphoner au médecin. »
Et c’est bien à quoi on s’était décidé, mais le médecin ne put se mettre en route que le lendemain matin. Il avait fait la moitié du chemin dans son automobile, l’autre sur un mulet qu’on avait envoyé à sa rencontre. C’est Jean Antide, le beau-frère d’Isabelle, qui menait le mulet par la bride. Il la tenait solidement dans son poing fermé à côté du mors, parce que le pied vous manquait tout à coup là où la neige avait été entassée par le vent, tandis qu’à d’autres places le sol était gelé sous la neige qui le recouvrait et le fer du sabot ne mordait même pas.
On les vit venir vers les onze heures. Le vieux Métrailler n’avait pas bougé de toute la nuit : et c’était Brigitte qui l’avait veillé, avec d’autres femmes. On les a vus venir de loin, le médecin et Jean. Le mulet était sans jambes ; à côté du mulet il y avait un garçon sans jambes, un personnage raccourci. C’était comme si le ventre du mulet avait enflé. Il traînait presque au ras des gonfles (qui est le nom qu’on donne à ces accumulations de neige que fait le vent). Car il vient comme avec une pelle ; et c’est comme si toute une équipe d’hommes à certaines places avait travaillé, comblant entièrement le vide qu’il y a dans le bas des talus. Puis tout à coup la bête et l’homme se mettaient à pousser par en bas, s’allongeaient, étaient grandis, redevenaient complets : c’était aux places où le chemin avait été au contraire balayé, et eux apparaissaient dans toute leur hauteur avec, sur le mulet, le médecin et à côté Jean, avec sa figure drôlement brune, qui parlait en faisant des gestes : tantôt montrant le village qui était en vue, tantôt par-delà le brouillard des choses qu’on ne voyait pas, des choses qui avaient été, des choses qui ne sont plus, mais qui seront peut-être de nouveau, une fois ou l’autre : là-haut, sur la droite, et là-haut en face de lui, là où par le beau temps brille une pointe blanche, là où on voit par le beau temps des points noirs qui se déplacent devant une paroi de rochers : elle est rose, elle est grise, elle brille au soleil comme du verre ; elle est comme de l’or quand vient le soir. Mais, aujourd’hui, on ne voyait rien ; et eux seulement avaient été vus par les enfants qui les guettaient ; qui se mirent à courir jusqu’à la maison des Métrailler ; qui couraient en criant : « Les voilà ! les voilà ! »
Le vieux Métrailler n’avait pas bougé. Est-ce qu’il n’y avait pas une malédiction sur lui ? Il n’y avait plus que Brigitte et Cyprien dans la chambre.
On entre, les gros souliers à clous ont fait du bruit dans l’escalier. On entre : c’était le médecin, un homme encore jeune ; le vieux ne bouge pas. Et Cyprien avait commencé à raconter comment l’accident était arrivé.
Le médecin avait pris le poignet du père Métrailler, puis avait sorti sa montre. Le vieux Métrailler ne bouge pas. Il avait un peu d’écume autour des lèvres, comme les vieux mulets pas bien soignés ; un petit bruit régulier comme celui d’une lime à bois sortait de sa bouche. Le médecin a haussé les épaules. Il a dit : « Avez-vous de l’eau chaude ? »
— C’est qu’il n’y voyait presque plus, disait Cyprien.
— Quel âge a-t-il ?
— Septante-cinq.
— On va essayer de lui laver la bouche.
Il avait ouvert sa sacoche ; Brigitte avait été chercher de l’eau à la cuisine ; il a secoué dans le verre quelques gouttes d’un liquide brun :
— Il me faudrait une cuillère, une cuillère à soupe. Il disait à Cyprien :
— Il vous faut m’aider.
Ils ont cherché à asseoir le malade sur le lit, mais il résistait sans qu’il en eût conscience ; son corps tout entier résistait, par une espèce de volonté à lui et c’est que ses jointures ne voulaient plus jouer ; de sorte qu’ils n’ont pu qu’incliner un peu le corps du père Métrailler en lui glissant un traversin sous les épaules.
Le père Métrailler ne bougeait toujours pas. Ses yeux mi-clos ne vous regardaient plus ; en se penchant un peu, on aurait vu par-dessous les paupières qu’ils étaient gris comme sa peau. Ses yeux ne vous regardaient plus, ni personne, ni aucune chose ; et le médecin disait : « Enfin quoi ? il ne souffre pas, c’est déjà autant de gagné… » essayant pendant ce temps de lui ouvrir la bouche avec le manche de la cuillère qu’il avait introduit entre les gencives édentées ; et disait à Cyprien :
— C’est seulement pour essayer de lui faciliter la respiration. Tenez-lui la tête, c’est ça. Mais le manche pliait, les mâchoires restaient soudées ; et tout ce que le médecin avait pu faire avait été d’humecter un linge, avec lequel il lui avait lavé les lèvres et, l’enroulant autour de son doigt, l’avait passé sur le palais ; alors l’écume est reparue, tandis que le bruit de lime se faisait plus marqué, comme quand le menuisier reprend courage à son travail.
— Je vais essayer quand même de lui faire une piqûre… Vous lui mettrez un linge glacé sur la tête ; vous ferez chauffer du vinaigre, vous le lui appliquerez autour des chevilles. Il faut tout essayer, bien sûr… Vous n’aurez qu’à me donner un coup de téléphone, demain matin, s’il est encore là…
On entendait devant la maison le bruit de nombreuses personnes qui parlaient à voix basse. Car tout faisait silence à présent dans la chambre où brûlait une petite flamme d’alcool bleue et jaune. C’est tout le village qui avait profité de la présence du médecin pour venir lui demander une consultation, comme ils font ; et c’est bien un peu pourquoi, dans les montagnes, les médecins consentent à ces longs voyages qui leur feraient perdre sans cela toute la journée, à cause de la longueur et de la difficulté des chemins. Le médecin avait remis la seringue dans sa boîte :
— Attendons, disait-il, on ne sait jamais… Enfin téléphonez-moi et bon courage…
Il a serré la main à Cyprien, il est sorti. Et tout de suite Justine Émonet l’avait arrêté :
— Oh ! monsieur le docteur, je ne sais pas ce qu’il y a, c’est mon petit qui ne va pas.
Puis on avait vu Revaz s’approcher, c’était à cause de son genou.
Lui, là-haut, ne bougeait pas. Il a continué à ne pas bouger. Il a continué à faire son petit bruit régulier comme celui du ver au cœur d’une poutre. Le soir était venu, les gens s’en étaient retournés chez eux ; alors le bruit a commencé à se faire plus espacé, plus faible, comme le chant du grillon quand vient le mauvais temps. Revaz était arrivé, Revaz était entré dans la chambre, Revaz avait pris Cyprien à part :
— Sais-tu ? mon genou, le médecin l’a vu… Eh bien, il m’a dit qu’il était guéri. C’était une crise de rhumatisme articulaire. Eh bien, disait Revaz, qui est-ce qui l’a guéri ? Veux-tu que j’aille le chercher ? Cyprien secouait la tête :
— Il porte malheur, disait-il.
— Enfin qu’est-ce que tu vas faire ?
— J’en sais rien.
— Et tu vois bien que ton père va passer : alors qu’est-ce que ça te coûte d’essayer encore ?… — Oh ! bien sûr, disait Brigitte, qui s’était approchée. C’est qu’il est savant, lui, il voit profond… Et il y a son livre à lui, et c’est un vieux livre et un bien plus vieux livre que ceux des docteurs d’à présent… Il saura, lui, ce qu’il faut faire.
Cyprien n’avait plus rien dit. Revaz avait donc été chercher Anzévui. Et Anzévui tout d’abord n’avait pas voulu venir, mais Revaz lui disait : « Montrez-leur ce que vous pouvez faire… Vous m’avez déjà guéri le genou et lui, le vieux, Dieu sait où est le mal, mais vous le trouverez, le mal, et l’irez chercher où il est. »
Anzévui disait :
— C’est trop loin ; j’ai trop de peine à marcher.
— Le chemin est fait, vous savez bien, puisque c’est Brigitte qui le fait ; et moi, je suis solide de nouveau sur mes jambes. Il vous faudrait seulement un paletot.
Il y avait, pendus à un clou, une vieille pèlerine que Revaz lui a jetée sur les épaules et un gros cache-nez de laine qu’il lui a mis autour du cou. Alors Anzévui s’est penché sur son bâton. Il avait d’un côté son bâton, de l’autre Revaz ; et, appuyé d’une main sur la grosse tige d’épine à corbin, son autre bras était passé sur celui de Revaz, qui le soutenait. Ainsi il faisait un pas, puis encore un, dans la nuit noire. Il avançait le pied, puis s’arrêtait, puis il avançait l’autre pied. Revaz lui disait : « Là, faites attention, il y a une bosse, là il y a une bonne place, ça y est » ; et on n’y voyait goutte et ils étaient sans lumière. Seulement, ce soir-là, toutes les fenêtres du village étaient éclairées juste en avant d’eux et un peu au-dessous d’eux, de sorte que les bords surélevés du chemin se distinguaient à peu près ; où ils se sont avancés peu à peu les deux hommes, tandis qu’on entendait par moment Anzévui soupirer, et il toussotait ; mais Revaz disait : « On approche, on y est presque… Et puis c’est un brave homme, vous savez, et il était déjà en train de perdre la vue ; et il faudrait bien empêcher que tous les malheurs ne lui tombent dessus à la fois… Attention ! bon, allez-y toujours, je vous tiens… Et puis je crois bien qu’il avait votre âge, voyez-vous… Oui, c’est un coup de sang… Il est tombé à la renverse en voulant sortir de son lit… »
Ils durent se mettre à deux pour lui faire monter l’escalier. On avait fait sortir le monde de la chambre ; on avait poussé le fauteuil au chevet du lit ; on avait dit à Anzévui : « Mettez-vous là. » Il s’était laissé aller en arrière contre le dossier ; il tenait son bâton entre ses jambes. Le grand chapeau de feutre aux bords usés qu’il avait gardé sur sa tête laissait échapper de côté deux longues mèches de cheveux blancs qui lui tombaient sur les épaules et par devant sa barbe lui tombait jusque sur le ventre. Il regardait le vieux Métrailler avec ses petits yeux gris. Il l’a regardé ainsi un long moment sans bouger (sauf un léger tremblement qui était dans ses mains et un autre léger tremblement qui faisait remuer sa barbe sur sa poitrine) ; puis :
— Martin !...
— Martin, disait-il, tu me reconnais ?
Mais l’autre n’avait toujours pas bougé ; alors Anzévui l’avait considéré de nouveau, en hochant la tête ; après quoi, il avait dit :
— Martin, je vois ce que c’est ; il te faut seulement aller.
Alors on avait vu le corps du vieux brusquement se détendre ; sa souplesse lui avait été rendue comme à de la terre gelée quand un vent chaud souffle dessus ; il a levé un peu les mains, sa bouche s’est entr’ouverte comme s’il allait dire quelque chose ; et sa mâchoire est allée vers en bas lentement, à quoi on a vu qu’il était mort.
Alors les vieux du village sont venus, l’un après l’autre, lui faire visite, et ils n’étaient guère que trois ou quatre, pendant qu’on entendait les coups de marteau dans l’atelier du menuisier. Ils se tenaient sur le pas de la porte, ils regardaient vers le lit, ils disaient :
— C’est toi, Martin Métrailler ?
Ils s’avançaient, ils prenaient sur la table la brindille de mélèze qui trempait dans l’eau bénite ; et debout devant le lit :
— Au revoir, Martin Métrailler, bon voyage ! Tu as été un brave homme, Martin Métrailler… Ils le regardaient encore une fois ; on lui avait mis ses habits du dimanche, c’étaient des habits noirs. On lui avait mis sa chemise du dimanche, c’était une chemise blanche, et sa cravate du dimanche, c’était une cravate en soie ; ses mains, qui étaient comme deux paquets de petites choses dures et longues enveloppées dans du vieux papier de journal, tenaient le crucifix sur sa poitrine.
— Tu as été un bon camarade. Et puis :
— Tu te rappelles, à la grande cible, le dimanche du patron… Eh bien, c’est fini, Métrailler. Mais ça ne fait rien, disaient-ils. Tu as peut-être de la chance. Tu es mort de ta mort à toi, tu es mort quand tu as voulu…
Le menuisier avait fini de planter ses clous. Le menuisier s’était mis à peindre le cercueil en noir. Et, le lendemain matin, ils sont partis pour Saint-Martin d’En Bas où les morts sont enterrés dans le petit cimetière qui entoure l’église. Il continuait à geler dur ; la neige, sous les pas des porteurs, plaignait comme un enfant malade. Le chemin avait été ouvert à la pelle une fois de plus ; il était bordé par place de murs de neige de plus d’un mètre et il avait peu de largeur ; alors ils soulevaient le brancard à bout de bras et la caisse noire là-haut balançait d’arrière en avant, semblable, tout parmi le moutonnement de la neige, à un petit bateau sur une petite mer.
Est-ce pour te montrer le pays encore une fois, Métrailler, parce qu’il est grand et beau, vu d’ici d’ordinaire ? Est-ce que c’est pour que tu le voies de plus haut encore comme quand on plane, comme quand on est dans les airs, comme quand le bon-oiseau sur ses ailes ouvertes a au-dessous de lui tout un grand vide bleu ? – mais on ne voyait rien, on continuait à ne rien voir. Et la terre dans le cimetière était même tellement gelée qu’en attendant qu’on pût s’y attaquer, il leur avait fallu déposer le cercueil sous un tas de neige, dans lequel ils avaient enfoncé la croix.
VII
« Je plante un clou ; ça en fait quinze. »
C’était de nouveau un dimanche ; Follonnier s’était dit : « C’est demain qu’on doit descendre ; il faut que j’aille voir chez Arlettaz si c’est toujours entendu. »
La maison d’Arlettaz autrefois était une des plus jolies du village. Il avait de l’argent, en ce temps-là ; il avait aussi une fille qui venait bien, en ce temps-là, ce qui faisait qu’Arlettaz était content. Il avait fait repeindre les contrevents de sa maison ; et puis, quand Adrienne avait eu dix-sept ans, avait fait remettre à neuf la cuisine. Des rideaux blancs bien propres et bien repassés, tenus relevés par des embrasses rouges, se voyaient à toutes les fenêtres ; tout le jour la cheminée fumait gaiement son joli bleu qui se hâtait, le long des pentes, pour aller retrouver plus haut le bleu du ciel.
« Aujourd’hui c’est différent », pense Follonnier, en levant la tête vers les contrevents qui ne tiennent plus, et les vitres au premier étage sont cassées. C’est là qu’elle était ; à présent elle n’y est plus, et tout change. On n’avait même pas ouvert le chemin sur le côté de la maison ; il fallait passer par-dessus un gros tas de neige où des traces de pas faisaient une espèce de sentier. « Les choses changent », c’est ce que pensait Follonnier. Il heurte ; on ne répond pas, il s’y attendait ; si bien qu’après avoir heurté encore une fois, comme par acquit de conscience, il avait pesé sur la poignée sans plus de façons. En effet, Arlettaz était là. On ne l’a pas distingué d’abord à cause de l’obscurité ; ce n’est qu’ensuite qu’on a vu la tache plus claire de sa figure se tourner lentement vers vous, et qu’il était assis devant une bouteille de goutte et un verre, à une grande table couverte de toute espèce d’ustensiles de cuisine et d’écuelles sales, son chapeau sur la tête ; car le feu était éteint.
Il faut croire que Follonnier avait l’habitude des lieux. Il s’est simplement avancé jusqu’à la hauteur d’Arlettaz :
— Ben, je vois que tu n’es pas prêt. Oh ! c’est pas pressant, a-t-il dit.
Il s’est assis en face d’Arlettaz, de l’autre côté de la table ; puis a relevé le col de sa veste, en disant : « Il ne fait pas chaud, chez toi » ; puis :
— Tu sais que c’est demain.
Alors Arlettaz a dit :
— Quoi ?
— Demain qu’on va chez le notaire ; il nous attend. J’ai le papier.
— Ah !
— Tu ne veux pas venir ?
— Que si, dit Arlettaz, j’ai plus rien.
— Et les cent francs ? Arlettaz montre la bouteille.
— Alors on a dit mille francs ; tu m’en as avancé cent ; tu ne vas plus me donner que 900 francs, voleur !
— 900, dit Follonnier, 900 comptant, 900 sur la table.
— Voleur !
— 900 en billets de banque ou en écus, comme tu voudras.
— Voleur !
— Je vois que tu n’es pas de bonne humeur, ce matin… Mais, si on descend, c’est ce que je voulais te dire, il faudrait… Il faudrait, puisqu’on descend, que tu t’arranges un peu. Il faudrait te raser. Et puis Lamon a une tondeuse…
— À quoi ça servirait-il ?
— Bien sûr, ça ne sert à rien, mais enfin il y a le monde.
— Je me fous du monde.
— Comme tu voudras.
Arlettaz a rempli à nouveau son verre de goutte, sans même penser à en offrir à Follonnier, ce qui est une grande impolitesse ; et Follonnier :
— Alors, c’est entendu ; je passe te prendre demain matin de bonne heure.
Seulement Arlettaz ne semble pas avoir entendu ; il est de nouveau dans les nuages ; il regarde devant lui du milieu de sa grosse barbe où ses oreilles ont disparu :
— J’ai retrouvé sa lettre ; tu te souviens ? je te l’avais montrée. Elle l’avait mise à la poste à Martigny…
Il fouille dans la poche de sa veste et finit par en sortir une feuille de papier pliée en quatre, toute coupée aux angles : « J’avais pas compris », disait-il.
— Tu te souviens, j’avais été la chercher chez sa cousine à Sion et elle n’y était plus. Eh bien, c’est quelque chose comme trois mois après qu’elle me l’a écrite, cette lettre. Pourquoi est-ce qu’elle me l’a écrite ? Il avait relu : « Mon cher père, je vais bien, j’ai une bonne place. Je vous écris pour vous dire de ne pas vous inquiéter de moi. Je vous donnerai bientôt plus longuement de mes nouvelles. »
— Bête ! disait-il, j’avais pas compris. Une belle fille : qu’est-ce qu’on peut en faire d’une belle fille ?… Ah ! dit-il tout à coup, il vaut mieux dans ces conditions qu’elle disparaisse. Et tout, dit-il, et toi, et moi…
— Et ça.
Il montrait les murs et par les fenêtres les choses du dehors qu’on pouvait voir ; il a vidé son verre d’un coup, il hausse les épaules.
— Ça ne fait rien, disait Follonnier, je viens te prendre demain matin. Ce sera quand même pour toi une bonne occasion de voir si tu ne la trouveras pas peut-être, cette fois-ci. Si tu veux, on ira la chercher ensemble, en sortant de chez le notaire…
Arlettaz n’avait dit ni oui ni non. Ce qui n’empêche pas que le lendemain, au petit jour, les deux hommes s’étaient mis en route. À mesure qu’il faisait plus clair, l’accoutrement d’Arlettaz étonnait davantage par le contraste que sa tenue offrait avec la netteté de la neige alentour. C’était effrangé, ça ne tenait plus ; c’étaient deux vestes, l’une brune, l’autre noire, qu’il avait passées l’une par-dessus l’autre et celle de dessus était plus courte que celle de dessous. C’était un pantalon déchiré aux genoux et un chapeau sans couleur qui tenait à peine sur sa tête, tellement ses cheveux étaient épais ; tandis qu’il s’était noué en guise de col un bas de femme autour du cou. Il marchait difficilement, ayant les pieds pris dans de vieux souliers presque aussi larges qu’ils étaient longs, couleur de pierre, lourds comme la pierre, durs comme la pierre, de sorte qu’il les traînait après lui, n’ayant pas la force de les soulever. Mais qu’est-ce que ça fait ? et à quoi ça peut-il servir d’être bien mis, puisque tout va s’en aller, toi aussi, moi aussi, et puis elle ; mais enfin la consolation est qu’on s’en ira ensemble, elle et moi, au même moment, tout d’un coup ; – c’est ce qu’il se disait en hochant la tête, les mains dans les poches, son bâton sous le bras. Ils étaient arrivés à Saint-Martin d’En Bas ; on leur disait : « Où allez-vous ? » — « On va faire un tour. » Et Arlettaz avait déjà soif et aurait bien voulu s’arrêter à l’auberge : « Juste le temps de boire un verre », disait-il ; mais Follonnier : « Pas de ça ! pas avant qu’on soit allé chez le notaire. Il faut que tu y voies clair pour signer. Si tu es sage, c’est moi qui te paie à boire à Sion, une fois qu’on aura fini nos affaires. » Arlettaz s’était arrêté devant l’auberge ; il y avait des enfants qui se moquaient de lui ; ils criaient : « Eh ! le moustachu ! » en éclatant de rire ; « eh ! la barbichette ! » puis, comme Follonnier se tournait vers eux, ils se sont dispersés en tout sens à grand bruit comme un vol de moineaux.
Arlettaz avait fini par céder, Follonnier l’ayant précédé sur le chemin où ils ont rencontré un peu plus bas un camion qui les a amenés jusqu’à la ville. Là, ils avaient été chez le notaire. Arlettaz ne disait plus rien. On l’avait fait asseoir à côté du pupitre où le notaire, l’acte en mains, s’était mis à en lire l’énoncé de derrière ses lunettes, s’arrêtant longuement sur la somme à payer : « Mille, nous avons dit mille. » Arlettaz n’avait pas bronché. Il avait dit seulement : « J’aimerais qu’on me paie en petits billets. » — « Oh ! on nous fera bien de la monnaie », avait dit Follonnier. — « Des billets de cinquante francs et de vingt francs ? Je vais envoyer mon commis faire le change. Vous êtes d’accord ? Voulez-vous signer ? »
Ils avaient signé l’un et l’autre.
Il n’y avait pas beaucoup de monde dans les rues. Ils avaient bu, puis ils avaient mangé. Puis voilà que Follonnier avait dit : « À présent, veux-tu qu’on aille la chercher ? Où est-ce qu’on va d’abord ? » Arlettaz ne savait plus. Il disait : « J’ai déjà été partout et il y a bien sa cousine, mais elle rit quand elle me voit venir. » Il disait : « Allons dans la rue. » Puis il a dit : « C’est moi qui paie à présent ; allons la chercher dans les cafés parce qu’il y a les sommelières. » Ils avaient été dans les cafés et Arlettaz disait aux servantes : « D’où êtes-vous ? » Elles disaient : « Est-ce que ça vous regarde ? » — « Oh ! disait-il, c’est que j’ai ma fille qui est, je crois bien, dans le métier. » — « Comment s’appelle-t-elle ? » — « Adrienne Arlettaz. » — « On ne connaît pas. » — « Une grande fille, oh ! plus grande que vous, disait Arlettaz, et plus forte ; oh ! disait Arlettaz, et puis bien plus belle que vous… » — « Espèce de malhonnête ! » Mais lui ne riait pas : « Vingt-deux ans, elle aura justement vingt-deux ans à la fin du mois… Si vous voulez voir son portrait ? » Il tirait de son porte-monnaie une pièce de cinq francs : « Hein ? disait-il, vous voyez, c’est le gouvernement ; des cheveux qui faisaient trois fois le tour de sa tête, et grande et forte, je vous dis, et de beau port… Vous ne l’avez pas vue ? » Et, de ces filles, les unes riaient, les autres se détournaient en haussant les épaules ; mais, lui, était de plus en plus dans les fumées du vin, tandis qu’il cherchait dans toutes ses poches avec ses mains noires sa pipe, ne la trouvait pas, l’oubliait ; puis se fâchait contre sa pipe qu’il se mettait à chercher de nouveau ; heureusement que Follonnier était de bonne humeur et veillait sur lui, faisant la monnaie à sa place ; et puis, vers les deux heures, l’avait pris par le bras.
Ils avaient eu de la chance. Ils avaient eu d’abord la nouvelle occasion d’une camionnette qui les avait menés jusqu’au pied de la montagne, de l’autre côté de la vallée ; là, celle d’une autre voiture qui montait jusqu’à mi-chemin de Saint-Martin d’En Bas ; il ne leur restait plus qu’une heure pour y arriver ; et Follonnier tenait toujours Arlettaz par le bras, tantôt le tirant en avant, tantôt l’empêchant d’aller de côté, parce qu’il n’était plus bien solide sur ses jambes. Arlettaz parlait, parlait tout le temps… Se désolait au sujet de son champ, se reprochait de l’avoir vendu, puis n’y pensait plus, pensant à sa fille ; puis, s’adressant aux sapins qui bordaient la route, il leur disait : « Je suis seul. » Puis c’était aux corbeaux qu’il tenait un discours, il leur disait : « Je suis tout seul dans la vie. » Et maintenant on ne savait plus à qui il s’adressait, parce que les corbeaux étaient rentrés dans l’épaisseur des bois. « Oh ! c’est pas gai, disait-il, mais heureusement que ça tire à sa fin. Bonjour, disait-il, ou bien si c’est bonne nuit. Bonjour, les lampes ! »
Car elles venaient d’apparaître dans le lointain aux fenêtres de Saint-Martin d’En Bas : « Et qui êtes-vous ? disait-il, mais vous vous éteindrez bientôt, voilà tout, toutes, c’est comme nous. »
— Tais-toi, disait Follonnier, on arrive.
— Voleur ! disait Arlettaz. Et puis :
— Hein ? si c’était possible, elle serait là, dis, et pas toi ; tu es trop laid, tu es trop gros, tu es mal mis. Dis, si elle revenait ! J’aurais été la chercher ; elle aurait fait une moitié du chemin, moi, j’aurais fait l’autre moitié ; et on voit de loin que c’est elle rien qu’à sa façon de tenir la tête.
— On y est, disait Follonnier.
Arlettaz s’est mis à pleurer ; il a ôté le bas de femme qui lui entourait le cou, parce qu’il avait trop chaud. Il riait parce qu’il avait vu la lumière de l’auberge ; il s’était remis à pleurer. Et, de devant la porte, il appelait le monde (vers les cinq heures du soir, à Saint-Martin d’En Bas) ; disant : « Venez ! venez tous, c’est moi qui paie. J’ai de l’argent, j’en ai trop. Car combien de temps ça va-t-il durer, hé ! Follonnier, où es-tu ? Voyez-vous, c’est un voleur… Mon champ des Empeyres, eh bien, disait-il, c’était un beau champ… »
On l’avait fait entrer. « Qui est-ce qui dira le contraire ? le plus beau champ du pays, une pose, et d’un seul tenant, en belle exposition, tout près du village ; une pose de bon seigle hâtif : eh bien ! savez-vous ce qu’il m’en a donné ? Voleur, où es-tu ? »
On accourait ; il a dit :
— Entrons, c’est moi qui paie. Hé ! Follonnier. Mais Follonnier avait disparu, ce qui avait fait rire Arlettaz. Et pour vous donner confiance, voilà qu’il tirait de sa poche tous les billets qui y étaient, près de neuf cents francs en petites coupures, ce qui faisait beaucoup de morceaux de papier.
Il les tenait à la poignée :
— Hardi, disait-il, allons-y ; il n’y a plus que quinze jours. Vous êtes combien ? comptez vous !… Hé ! patron, dix litres…
Aux environs de minuit, le patron, qui était en train de fermer son établissement, avait été à l’écurie ; et là, donnant un coup de pied dans les jambes de la vache, donnant un autre coup de pied dans le ventre du mulet, il avait fait une petite place à Arlettaz entre la vache et le mulet.
VIII
Quant à Métrailler, il s’était dit : « Il faut que j’en aie le cœur net. » Car, depuis la mort de son père, il ne pensait plus qu’à une chose et qui était qu’Anzévui devait avoir jeté un sort au vieux. « Mais je vais aller trouver Anzévui et il faudra bien qu’il me dise ce qui en est. »
Il s’était mis en route un peu après midi.
Sur le chemin, il avait rencontré Brigitte qui justement rentrait chez elle.
— Où vas-tu ? lui avait-elle demandé.
Il ne lui avait rien répondu. Et elle, tournée vers lui qui passait devant elle :
— Ne te tourmente pas, voyons, Métrailler ; tout va bien… Mais, lui, écoute, ne le tourmente pas non plus, parce qu’il baisse. J’ai donné un coup de balai ; tu le trouveras sous ses plantes. Fais doucement.
Métrailler ne l’écoutait pas. Il a heurté à la porte, il entre. Il voit le feu. Il y a un bon feu. Anzévui est assis dans son fauteuil de paille avec un vieux traversin dans le dos ; sa tête va en avant à cause de son poids, sa barbe traîne sur ses genoux.
— Qu’est-ce que tu veux ?
— Je voulais vous voir.
— Eh bien ?
— Et puis vous parler.
— Eh bien, dit Anzévui, assieds-toi.
Il tousse. Les plantes étaient attachées par leurs racines aux poutres et pendaient, la tête en bas, comme des chauves-souris. Devant Anzévui il y avait une table ; sur la table, il y avait le livre ; il était recouvert d’un parchemin marbré de rouge comme certains savons dont on se servait autrefois pour les lessives à la fontaine.
Métrailler disait :
— Voilà. Est-ce vous ?
— Quoi ?
— Oui, disait Métrailler, vous êtes venu et il est mort.
— Et toi, disait Anzévui, est-ce que tu ne mourras pas aussi ?
Métrailler s’était tu un moment, ayant besoin de réfléchir ; il avait recommencé :
— Mais peut-être qu’il ne serait pas mort si vous n’aviez pas été là. Ils disaient que vous alliez le guérir et Revaz me disait aussi que vous lui aviez guéri le genou …
— Il a obéi.
— Oh ! disait Métrailler, je sais bien qu’il n’allait pas fort et que le médecin ne lui avait rien pu, mais on disait que vous étiez plus savant que les médecins ; eh bien, au lieu de le refaire, vous l’avez laissé se défaire.
— C’était écrit.
— Mais écoutez bien, père Antoine, parce qu’ils prétendent aussi que vous allez arrêter la lune et les étoiles et que le soleil ne reviendra plus ; alors je me suis dit que, si vous avez pouvoir sur les astres, vous en aviez d’autant plus sur les hommes et que vous pouviez aussi bien les faire mourir que les remettre en santé.
Anzévui a dit :
— C’est pas moi. C’est dans le livre. Il tousse. Et de nouveau il baisse la tête, ce qui entraîne sa barbe, qui ruisselle sur sa poitrine comme une mince épaisseur d’eau sur un lit de débris d’ardoise.
— Moi, j’obéis. Je ne fais que lire ce qui est écrit. J’ai vu que ton père avait fait son temps. Il était comme un homme qui s’est accroché à un buisson pour ne pas être emporté par l’eau ; je lui ai dit : « Lâche tout. »
La flamme du feu était sur sa figure et ensuite n’y était plus ; alors il y avait de l’ombre autour de ses yeux comme il y a de l’eau dans les creux d’une pierre. Métrailler n’a plus rien dit ; Anzévui ne disait rien non plus. Puis Anzévui tousse. Et Métrailler alors :
— Ah ! c’est que j’y ai été.
— Où ?
— Sur la montagne, au Grand-Dessus.
— Quoi faire ?
— Voir si le soleil n’y était plus ; et il y était bien encore, mais…
— C’est que ça balance.
Anzévui tousse.
— C’est pas moi, c’est dans le livre.
Il l’a pris sur ses genoux, pendant que la flamme du feu baissait, baissait encore comme si elle allait s’éteindre ; et lui :
— J’y vois plus. Métrailler, mets du bois.
Il y avait du bois de fagot empilé au pied du mur :
— Mets-y de la brindille d’abord, et puis des gros rangs qui tiennent le feu.
On le voit alors tout entier avec les grosses rides qu’il avait sur le front, ses longs cheveux, sa barbe blanche, ses petits yeux qui étaient clairs comme si on venait de les laver dans de l’eau fraîche ; et, s’étant mis à tourner les pages du livre :
— C’est là-dedans… Laisse-les rire, s’ils veulent rire. On va être comme la lune qui n’a qu’un côté qui voit clair. Nous, on sera du mauvais côté.
— Il était rouge, disait Cyprien ; il était comme une tête coupée. Il y avait plein de sang autour. — C’est qu’il va finir. Il y aura balancement. Et, nous autres, on ne le verra plus, parce qu’on va être du côté de la terre où il fera nuit tout le temps.
— C’est quand ?
— Bientôt. Tu vois, c’est là. J’ai fait le compte. Ça fait 37. Il lui montrait la page où des lettres noires étaient sur deux colonnes et il y avait une grande marge dans laquelle beaucoup de signes et des chiffres imprimés à l’encre rouge se voyaient : la lune, le soleil, les signes du zodiaque.
— J’ai compté, recompté et compté à nouveau, puis compté encore une fois : ça fait 37, puis ça fait 4, et puis ça doit faire douze ou treize, ce qui est justement la date où le soleil doit revenir pour nous. Eh bien, il ne reviendra pas. Et, au lieu qu’il fasse plus clair ce jour-là, il fera plus sombre, et plus sombre encore et toujours plus sombre. La modification des axes. C’est que la terre tourne en l’air, disait-il.
Et puis il a été essoufflé.
— Et puis elle ne tournera plus. Elle tourne de deux manières encore pour le moment, elle ne tournera plus que d’une.
— Et puis ?
— Et puis il fera nuit, il fera nuit pour nous. Il faudra allumer les lampes tout le jour. Il fera froid, toujours plus froid. Qu’est-ce qu’on peut avoir aujourd’hui ? trois ou quatre sous zéro. Et au commencement d’avril on a quatre au-dessus d’ordinaire. Eh bien, disait-il, il fera moins dix et puis moins vingt. L’eau sera comme de la pierre, les sapins se fendront en deux, on cassera le fromage à la hache, le pain deviendra dur comme une meule de moulin. C’est alors que Métrailler commença à avoir peur. Il considérait Anzévui qui respirait avec difficulté : Anzévui a ouvert la bouche. Anzévui tousse, tousse encore ; puis, la flamme ayant baissé de nouveau, ses yeux sont devenus comme les yeux d’un mort.
Il avait fini par reprendre son souffle :
— C’est ainsi.
— Eh bien, disait Métrailler, mon pauvre père, alors, il a bien fait de s’en aller ?
— Il a obéi.
— Et nous autres, qu’est-ce qu’il nous faut faire ?
— Il vous faut obéir aussi.
— C’est tout ?
— C’est tout.
Anzévui a ôté le livre de dessus ses genoux parce que c’était un gros livre et que le poids le fatiguait. Il y avait dedans tout le passé, tout le présent, tout l’avenir : ça fait lourd. C’était au mois de février ; c’était même déjà le 25 février. Métrailler avait pris congé d’Anzévui : c’était le temps où, dans les pays plus favorisés, les premières fleurs s’ouvrent et il y en a même, de ces pays, où la vigne pleure déjà. Là-bas, où est le fils Revaz, sur ces murs tournés au midi, peut-être qu’il fait un beau soleil et il y a des grappes jaunes ou violettes qui pendent dans les fentes de la pierre. Il fait bleu au-dessous de vous, il fait bleu en face de vous, il fait bleu au-dessus de vous : il y a trois espèces de bleu. C’est l’eau, la montagne et le ciel. Dans ce premier printemps, pensait-il, quand le ciel enfin s’est fendu en deux ; et il y a dans l’angle d’un mur, bien à l’abri, un petit pêcher de plein vent qui est comme un peu de ouate rose, celle qu’il y a sous les boucles d’oreilles qu’on achète à sa bonne amie ; moi, je n’en ai plus, ça ne fait rien. Mais est-ce que ce sera pour eux là-bas comme pour nous ? est-ce que ça s’éteindra pour eux aussi en une seule fois, tout à coup ? Parce qu’à présent ils sont au moins dans le soleil et s’en réjouissent ; dans la lumière et en pleine lumière ; dans les couleurs, dans toute espèce de couleurs ; nous, c’est noir et gris ; nous, pendant six mois, c’est noir et gris ; pour nous, du milieu d’octobre au milieu d’avril, rien ne change (il levait la tête) : ni en haut, ni en bas, et dans le milieu non plus. Ça baissera, avec une pauvre lumière ; il n’y aura plus de lumière du tout ; il n’y aura plus rien nulle part ; et, regardant les maisons du village, il n’y aura plus eux, pensait-il, il n’y aura plus moi, il n’y aura plus nous. À ce moment, il vit une petite fille qui était agenouillée devant une croix de bois. Cette croix se dressait dans l’angle que forme le sentier qui conduit chez Anzévui avec le chemin du village. Elle était supportée par un soubassement de pierre ; la petite fille l’avait débarrassé de sa neige avec le coin de son tablier ; puis s’était mise à genoux. De plus près, Métrailler avait vu que c’était la petite Lucienne Émonet. Elle avait peut-être huit ans, mais elle portait déjà des jupes longues comme une femme. C’était une vraie petite femme. Elle avait, comme les femmes, un fichu noir sur la tête, un châle noué autour de la taille, des gros souliers à clous comme les femmes de là-haut. Elle ne l’avait pas vu venir ; Métrailler s’était arrêté, il se disait : « Qu’est-ce qu’elle fait là ? » Et il avait attendu qu’elle se fût relevée pour la rejoindre.
— Qu’est-ce que tu fais là ? Tu vas te mouiller.
— Que non ! dit-elle.
Il y avait seulement comme un peu de farine sur son tablier à petits carreaux ; elle l’a brossé de la main :
— Vous voyez, c’est déjà parti.
C’est qu’il faisait froid encore et la neige était aussi sèche que la poussière des routes sur les objets qu’elle recouvrait autour de vous ; seules les mains de Lucienne étaient humides, rouges et couvertes d’engelures, mais les mains des petites filles en ont l’habitude, là-haut. Et Métrailler lui disait encore :
— Je t’ai dérangée ?
— Que non, je ne savais même pas que vous étiez là.
Ils marchaient l’un à côté de l’autre ; tout à coup Métrailler lui a demandé :
— Est-ce qu’il y a quelque chose qui ne va pas ?
— Oh ! oui.
— Qu’est-ce que c’est ?
— C’est ma tante Justine.
— Est-ce qu’elle est malade ?
— Non, pas elle, mais elle a un bébé, et elle est inquiète à cause de lui.
— Pourquoi ?
— Parce qu’il est tout petit et qu’elle dit qu’il va mourir.
— Ah ! dit Métrailler.
— Elle dit que nous allons tous mourir parce qu’il n’y aura plus de soleil. Elle dit que ça n’est pas juste. Et que, si c’est juste pour les vieux et les hommes et les femmes d’âge, ça ne l’est pas pour les petits enfants qui n’ont encore fait de mal à personne.
— Alors, dit Métrailler, tu es venue prier le soleil ?
— Oh ! non, dit-elle.
— C’est dommage, c’est pas le moment ; ça n’est pas le temps qu’il faut pour ça, continuait Métrailler. Il se cache, le soleil ; il ne t’a pas vue, il n’a pas pu t’entendre ; on ne sait même pas où il est aujourd’hui, tellement il y a loin de lui à nous.
— Voyons, disait-elle, c’est pas le soleil.
— Et qui c’est ?
— C’est le bon Dieu.
— Ah !
— Oui, dit-elle, parce que c’est le bon Dieu qui commande au soleil. Il fera bien revenir le soleil, s’il veut, lui ; et il voudra bien, n’est-ce pas ?
Tout à coup, Métrailler s’était senti délivré ; il se sentait léger de corps, il se disait : « À quoi est-ce que je pensais ? j’avais perdu la tête. C’est le mauvais temps qui vous donnait ces idées, c’est Anzévui ; c’est d’être enfermé sans rien faire tout le long du jour. C’est les femmes, parce qu’elles sont portées de nature à croire tout ce qu’on leur raconte ; c’est les vieux, parce qu’ils sont malades… »
— Bien sûr, a dit Isabelle.
Elle éclata de rire en renversant la tête ; le dessous de son menton bougeait comme la gorge du pigeon. Car il la voyait de bas en haut. Il avait continué son chemin ; il passait justement devant chez elle. Elle, elle était sur le perron de sa maison, et lui au-dessous d’elle, étant au milieu du passage. Elle éclatait de rire parce qu’elle lui avait dit : « D’où venez-vous ? » et lui, avait dit : « De chez Anzévui. »
— Bien sûr que non, c’est des histoires de vieilles femmes, mais montez un moment vous mettre au chaud. Je suis seule : c’est mon mari, mon vieux fou de mari…
— Où est-il ?
— Il a été chercher du bois, il fait comme Brigitte ; il me dit : « Elle a raison, c’est une femme prévoyante. » Il est parti avec Jean et la luge pour en chercher.
Métrailler était entré. Il faisait bon. Il y avait un fourneau. C’était un ménage bien monté, et à la nouvelle mode. C’était neuf, c’est une maison neuve. C’était en beau bois de mélèze passé au vernis qui brillait, avec des nœuds comme des yeux, des veines comme sur un bras d’homme. Isabelle avait allumé l’ampoule électrique qui pendait au-dessus de la table dans un abat-jour en papier rose finement plissé :
— Croyez-vous qu’il soit bête tout de même, ce pauvre Augustin, mon pauvre mari. Mais il ne veut rien entendre. Il dit : « On ne sait jamais. »
— Et Jean ?
— Oh ! ça le fait rire, mais il a bon cœur. Et puis, vous comprenez, il est le cadet, et puis, vous comprenez, il n’est pas majeur. Ils ont fait déjà six voyages.
Elle disait :
— Il vous faut toujours boire un verre ; ils ne vont pas tarder à être là.
Elle avait été remplir à la cave un litre en verre blanc qui laissait voir la couleur que le vin avait et c’est une couleur qui se reconnaît vite. Métrailler avait montré le litre du doigt :
— Eh bien, disait-il, le soleil… Est-ce qu’on ne dirait pas qu’il est déjà revenu ? Le vin est beau à regarder, c’est un commencement ; puis voilà, à présent, qu’il regarde Isabelle :
— Et, vous aussi, vous êtes belle à regarder. Et vous nous l’avez conservé, vous aussi, vous avez bien fait.
— Oh ! dit-elle, c’est que je l’aime…
— Vous avez bien fait, voyez-vous, et c’est bon de l’avoir de nouveau devant soi, sans quoi on perdrait l’espérance…
Il la regardait :
— C’est que vous prenez bien le soleil, disait-il, et moi pas. Vous, il vous dore ; moi, il me brûle.
— Eh bien, c’est peut-être qu’il y en a qu’il aime et qu’il y en a qu’il n’aime pas.
— Moi, je reste gris comme un caillou ou bien je deviens rouge comme une écrevisse. Moi, j’ai la peau qui se fendille comme la terre des jardins. Vous, ça vous mûrit, ça vous arrondit ; moi, ça me sèche, ça me creuse. Et pourtant Dieu sait, disait-il, s’il me connaît bien, le soleil, depuis le temps qu’il me voit circuler tout près de lui, là-haut, parmi les rochers, et sur la neige, et sur la glace, et sans ombrelle ; mais peut-être que vous avez raison, peut-être qu’il a ses préférences…
— Ah ! c’est que nous, dit-elle, on est dans les prés ; nous, c’est les foins ; nous, on manie le râteau et la fourche. Nous, on est dans le vert, disait-elle, on est parmi les sauterelles ; il nous regarde par-dessus les sapins. Oh ! il n’est pas aimable avec toutes les filles… Moi, je ne fais semblant de rien ; il me dit : « Ah ! c’est toi ? » je lui dis : « Oui, c’est moi. » Je lui tourne le dos ; alors il vient, il vous chatouille, c’est pour vous dire qu’il est là, les bras, les épaules, le dos…
Elle était assise sur la table ; elle lui parlait par-dessus l’épaule :
— Nous, on ne lui demande rien ; on ne prend que ce qu’il nous donne ; c’est pourquoi il nous veut du bien.
— Et, nous, peut-être qu’il nous veut du mal, disait Métrailler.
Elle montrait ses dents qui brillaient sous la lampe, elle a montré le bout de sa langue avec laquelle elle se mouillait les lèvres, tout en baissant la tête comme une petite fille qui a de la timidité :
— C’est pourquoi vous avez eu peur. Oh ! vous n’êtes pas le seul ; mais vous, vous n’avez plus peur, ou quoi ? On n’a plus peur quand on est avec moi… Santé ! Métrailler… Car elle avait son verre à elle, qu’elle lève ; et pendant ce temps s’appuyait sur la table de l’autre main :
— Car c’est bientôt fini, bientôt on saura à quoi s’en tenir ; et eux aussi, les pauvres.
— Qui est-ce ?
— Eh bien, Denis Revaz, sa femme, Brigitte, Justine Émonet, Morand, Lamon.
Elle dit :
— Et Augustin… Et puis Arlettaz, parce qu’il boit tout.
— Il a de quoi ?
— Bien sûr, il a vendu son dernier champ à Follonnier.
— Ah ! Follonnier, c’est un malin.
— Un tout malin, dit-elle, parce qu’il l’a eu pour la moitié de sa valeur, ce champ, vous comprenez ; et lui, le pauvre, tous les soirs il faut qu’on le rapporte chez lui, parce qu’il dit qu’il faut qu’il se dépêche s’il ne veut pas laisser de l’argent…
— À qui ?
Elle dit :
— Au diable, et qu’il n’a que le temps, et Pralong ne dit pas non.
Puis elle s’était remise à rire :
— Il ne faut pas faire des enfants si on n’est pas capable de les garder. Qu’en pensez-vous, Métrailler ?
Puis, tout à coup :
— Il ne faut pas prendre femme si on ne sait pas…
Puis tout à coup se tait ; et est assise sur la table, sous la lampe à abat-jour rose où elle montre tour à tour sa nuque qui est belle à voir, son chignon plein de reflets bleus, tour à tour le contour pelucheux de sa joue ou dans le coin de sa paupière son œil qui semble frotté d’huile :
— Il l’aimait bien pourtant (elle parlait à présent d’Arlettaz), seulement il ne savait pas bien aimer. Il faut savoir. Et nous autres, les filles, ce n’est peut-être pas de cet amour-là qu’on a besoin ; oui, un amour de cette espèce. Il n’a pas su. Elle était un peu plus âgée que moi, elle avait bien trois ou quatre ans de plus que moi. Quel âge pensez-vous que j’aie, Métrailler ?
Les mains à plat sur la table, sous la lampe, un soir que la nuit commence à venir, bien qu’elle vienne déjà plus tard :
— Je n’ai même pas dix-neuf ans : peut-être que je me suis mariée trop jeune. Augustin, lui, il a vingt-trois ans ; il a quatre ans de plus que moi. Il a juste l’âge de la fille d’Arlettaz. Oh ! je me souviens bien d’elle, elle s’appelait Adrienne ; et on était encore des petites filles et elle une grande fille, mais elle nous disait : « Je m’ennuie. » Et on lui disait : « Pourquoi est-ce que tu t’ennuies ? » – « Parce que c’est trop petit, ici. » Écoutez, Métrailler, vous qui êtes un homme raisonnable, est-ce que vous trouvez que c’est trop petit, ici ? Est-ce que vous trouvez qu’à vingt-trois ans on soit vieux ?…
Mais il s’est fait un bruit devant la maison ; c’était un bruit de pas assourdi qu’accompagnait un sifflement léger : les glissoires de la luge chargée dans la neige. Métrailler a été regarder par la fenêtre ; mais, elle, elle est restée assise sur la table jusqu’à ce qu’ils fussent venus, ayant rentré leur charge de bois dans le bûcher ; et Augustin était maigre et pâle avec des cheveux plats et rares, Jean tout brun, les joues rouges, les yeux vifs, les cheveux frisés. On voyait qu’Augustin était inquiet ; il a dit :
— Qu’est-ce que vous faites là ? C’est ça, vous buvez et, nous, on s’éreinte… Vous êtes au chaud, vous vous reposez ; nous, on est à la fois gelés et en sueur ; on a la chemise qui nous colle au dos et on ne sent plus le bout de ses doigts…
Elle a dit :
— Jean, va chercher deux verres. Elle était restée où elle était ; Augustin, lui, s’est laissé tomber au bout du banc, puis va en avant avec le haut du corps, les coudes remontés, en secouant la tête. Et comme Métrailler lui disait :
— D’où viens-tu comme ça ?
— D’où je viens ? est-ce que ça se demande ? On n’a plus que quinze jours. Va demander à Brigitte où elle en est de sa provision : c’est qu’elle s’y est prise à temps… Elle a su faire. C’est qu’il en faudra du bois, hein ? si on veut tenir le coup.
IX
Ce matin-là, avant dix heures, il était déjà assis devant sa chopine vide. Il tapait avec le cul du verre sur la table ; la grosse Sidonie arrivait. Et la grosse Sidonie allait lui remplir sa chopine, puis inscrivait sur une ardoise le montant de la consommation ; ce qui faisait, le soir venu, un beau total, parce que tout le monde depuis quelque temps buvait sur le compte d’Arlettaz.
Mais c’est lui qui l’avait voulu. Il tirait tout un paquet de billets de sa poche : « Il faut m’en débarrasser ; sans quoi j’en laisserais et à qui serviraient-ils ? À la nuit, à rien du tout, à plus personne. »
C’est que la saison s’avance, c’est que les temps seront bientôt là. Moi, j’attends.
Il était seul. La T.S.F. ne fonctionnait pas. Ce n’était pas encore le moment où la salle à boire se remplit. Lui, est là assis et laisse les choses se faire, sans rien dire, sans bouger, allumant de temps en temps sa pipe, la laissant s’éteindre, puis la rallumant à travers le couvercle de laiton percé de trous, qu’il oubliait de relever ; et ses doigts tremblaient tellement que la flamme se promenait tout autour du fourneau sans jamais réussir à se fixer dessus.
Follonnier est entré.
— Eh bien, comment ça va ?
Follonnier s’assied en face d’Arlettaz. Arlettaz n’a pas répondu. Follonnier est de bonne humeur :
— Tu as de la chance, Arlettaz ; tu as fait une bonne affaire.
— Voleur ! Et, en même temps, Arlettaz tape avec le cul de la bouteille sur la table :
— Encore une, dit-il, et un verre.
C’est comme ça que ça allait. À mesure que les temps s’approchent, on buvait davantage chez Pralong, et à crédit.
— Voleur ! disait Arlettaz.
— On le sait, disait Follonnier.
— Eh bien, je te dis voleur quand même. Un champ qui me venait de ma mère ! Et pas seulement de ma mère, mais du père de ma mère, et puis du père du père… (mais il s’embrouillait) ; le plus beau champ de la paroisse, le plus plat, le mieux exposé, et sans le plus petit caillou, tu sais, tellement il avait été trié motte à motte à la main… Enfin, puisque c’est fini. Parce que c’est fini, ou quoi ?
— Bien sûr que c’est fini.
— Alors il faut boire.
— Est-ce que tu as été au Bouveret, comme tu disais que tu voulais faire ?
— Au Bouveret ?
— Chercher ta fille… Tu ne te souviens pas ? Tu disais que tu avais déjà été partout, sauf de ce côté-là.
— C’est plus la peine… Puisqu’on va se revoir, disait Arlettaz… Parce que, le soleil, dis donc, ce n’est pas seulement pour nous d’ici qu’il va s’en aller, pas seulement pour nous de Saint-Martin d’En Haut, qu’en dis-tu ? mais pour tout le monde ?…
Follonnier hochait la tête.
— Pour ceux de Saint-Martin d’En Bas, aussi, hein ? Et ceux de la vallée aussi ? Et ceux du bord du lac ? Bon. Alors…
— Alors ?
— Alors pour elle aussi… On se reverra quand même, Adrienne et moi. Oh ! dit-il, ce sera bien le moment. Mais alors à quoi bon courir ?
Des garçons étaient entrés, des jeunes, et Pralong lui-même :
— Puisqu’on va se retrouver…
Ils s’étaient mis à boire. Ils regardaient Arlettaz : sa barbe et ses cheveux avaient encore poussé. Et, à mesure qu’ils poussaient, comme dans un encadrement, sa figure au milieu devenait plus petite, plus réduite et était plissée, comme une pomme à la fin de l’hiver. Il portait toujours ses deux vestes l’une sur l’autre, mais les manches de celle de dessus, étant ouvertes sur le côté, pendaient de chaque côté de ses bras, laissant voir celles de dessous. De sorte qu’il semblait avoir mis des manchettes brunes, étant lui-même en habit noir, comme pour des espèces de noces ; mais sans col et peut-être bien sans chemise ou bien avec des lambeaux de chemise, mais il ne savait pas lui-même, parce qu’il ne se déshabillait plus depuis longtemps. Et les hommes le regardaient, mais lui ne regarde personne ; il regarde quelque chose à travers vous, comme si vous étiez en verre, sans vous voir.
— Ça sera bien le moment, disait-il.
Puis il s’est mis à se sourire à lui-même, ou s’il sourit à ce qu’il voit ? il demande :
— Comment est-ce que ce sera ?
— Ça sera beau, dit Follonnier.
Ils étaient tous autour de lui.
— On sera changés ?
— Bien sûr, et pas seulement changés, mais transfigurés… Transfigurés, ça veut dire qu’on n’aura plus la même figure…
— Oh ! dit-il, elle, elle n’aura pas besoin d’en changer.
— C’est toi qui en changeras, tu seras joli à regarder. Hé ! dis donc, Arlettaz, tu seras jeune…
Et un des garçons :
— Vous serez rasé.
Un autre :
— Vous serez tondu.
Un autre :
— Bien habillé.
— Voyons, voyons, disait Follonnier. Hé ! vous autres, allez-vous être sérieux ou quoi ?… Écoute, Arlettaz, tu te rappelles bien ce qui est dit dans les Écritures ? c’est qu’on sera ensemble au ciel une fois, les uns et les autres, pour toujours. Tu as raison, tu la retrouveras…
Mais on voyait qu’Arlettaz était un peu inquiet.
Il a dit :
— Comment est-ce qu’on fera pour se reconnaître ?
— C’est la lumière, dit Follonnier. On a vécu longtemps dans l’obscurité. Et tout à coup il y aura la lumière, une bien plus grande lumière qu’il n’y en a jamais eu ici ; on sera refaits par elle, renouvelés. Et portés par elle les uns vers les autres.
— Et puis il y a les anges, dit Lucien Revaz.
— Bien sûr, disaient les garçons.
— Le soleil, tu comprends, notre soleil à nous, eh bien, ce n’est rien, il a des taches : c’est un commencement de soleil, un essai, une imitation, un faux soleil, rien de plus…
Et, parce qu’ils voyaient bien qu’Arlettaz était déjà dans les vapeurs du vin et qu’il n’y avait plus à se gêner avec lui :
— Quel âge avez-vous ?
— Cinquante-deux.
— Vous en aurez vingt. Et, elle, quel âge est-ce qu’elle a ?
— Elle en aurait eu vingt-trois, le dix mai.
— Elle en aura dix-huit, parce que c’est le bel âge ; vous serez comme des amoureux.
— Taisez-vous, les garçons !
Seulement, Follonnier s’était mis à rire lui-même ; d’ailleurs, il voyait bien que les garçons étaient partis et qu’il n’y aurait plus moyen de les arrêter ; eux, en effet, continuaient :
— C’est qu’on se souvient bien d’elle, nous aussi, c’est qu’on l’a bien connue et ce n’est pas notre faute, à nous, si elle n’est pas restée ici. Qu’est-ce que vous voulez ? père Arlettaz, elle était trop belle, elle était trop belle pour nous. Mais là où on sera bientôt, il n’y aura plus de différences. Tout le monde sera jeune, tout le monde sera heureux. Sur les tableaux…
Ils se poussaient du coude sous la table :
— Vous savez bien, ceux de l’église… Eh bien, oui, elle aura des ailes ; elle sera comme un ange… Elle vous reconnaîtra de loin et d’en haut. Et c’est d’en haut qu’elle viendra…
L’un a dit :
— Rouge et grise comme un hochequeue.
L’autre :
— Verte, rouge et jaune comme un chardonneret.
Un autre encore :
— Noire et blanche comme une pie.
Mais alors ils avaient vu deux grosses larmes qui coulaient lentement sur les joues du père Arlettaz comme la gomme sur le tronc d’un pêcher. Il ne disait plus rien, il ne bougeait pas ; et il y avait ces deux grosses larmes qui avaient de la peine à descendre, tellement sa vieille peau était rugueuse et inégale.
X
Le père Revaz, lui, avait appelé sa femme. Il était assis devant une espèce de bureau qu’il y avait dans leur chambre à coucher et dont le couvercle en se rabattant formait pupitre ; il avait fait asseoir sa femme à côté de lui :
— Écoute, on ne sait pas ce qu’il va arriver, c’est pourquoi il nous faut mettre nos affaires en ordre. Tu vas d’abord écrire à Julien de revenir.
C’était celui de leurs deux fils qui travaillait dans le vignoble.
— Écris-lui qu’il s’arrange pour avoir un congé de quelques jours. Oui, dit-il, j’aimerais qu’il soit là, si jamais ça tourne mal.
Le père Revaz avait mauvaise mine, bien que son genou fût guéri. Il était gris de teint, trop gros : les joues molles et salies de barbe.
— Ah ! reprenait-il, a-t-on pourtant travaillé, ma pauvre femme ! S’est-on pourtant levé d’assez bonne heure le matin, l’été, et assez couché tard, dis donc, ce qui faisait bien quinze heures de temps ; et a-t-on assez couru les chemins, dis donc, combien de fois dans l’année d’ici aux mayens et d’ici aux vignes d’en bas. Et, justement, c’est au moment où on aurait pu commencer à profiter de son travail… Dommage !
Elle le considérait avec étonnement, elle-même grosse et pâle, ne l’ayant jamais entendu parler si longtemps ; mais il avait rabattu le couvercle du secrétaire :
— Enfin, c’est entendu que tu écris à Julien tout de suite. Et il y a Alphonsine (c’était leur fille), mais elle est mariée et il faut la laisser avec son mari… On sera les quatre, on sera ensemble et pour le reste tout est en ordre… J’ai partagé l’argent en trois. Il a ouvert un tiroir, il en a tiré trois paquets ficelés sur chacun desquels il avait écrit le nom d’un des enfants.
— J’ai fait à chacun sa part… Il n’y aura pas besoin que la justice s’en mêle… Quant à la maison et aux terres, tout est noté là-dedans.
Il a sorti du tiroir une enveloppe jaune où on lisait : « Dernières dispositions ».
— C’est pour que tu saches ce que tu auras à faire, si c’est moi toutefois qui m’en vais le premier.
— Mais, puisque, disait-elle, on s’en ira tous ensemble ou bien…
Elle hésitait :
— Ou bien personne ne s’en ira… Ça n’est pas comme si tu étais malade… Voyons, Denis, est-ce que tu y crois ?
— On ne sait jamais. Tu as fait des provisions ?
— Oh ! dit-elle, oui. On a du beurre pour trois mois et du fromage pour six mois… Et j’ai fait faire du pain pour huit. On a trois jambons, trente paires de saucisses, vingt-cinq saucissons. Dix-huit kilos de sucre…
Elle réfléchissait :
— Un bon sac de polenta, et il y a du foin de quoi nourrir les bêtes jusqu’au mois de juillet…
— Ça va bien, disait-il, parce qu’on ne pourra plus circuler.
— Circuler ?
— On ne pourra plus sortir de chez soi.
— Pourquoi ?
— Parce qu’il fera nuit et qu’il fera trop froid.
— Qui est-ce qui t’a dit ça ?
— C’est Anzévui… Parce que jusqu’à présent il y avait la nuit, mais il y avait le jour ; jusqu’à présent il pouvait faire sombre, mais ensuite il faisait clair ; et il n’y aura plus que la nuit et puis la nuit et puis la nuit, et il fera d’abord huit degrés au-dessous, puis quinze, puis vingt degrés… Tu as assez de bois ?
— Voyons, dit-elle, tu sais bien ; on ne sait plus où le mettre. Il y en a des piles contre tous les murs de la maison…
— Savoir si on pourra aller les prendre…
— Il y en a plein le bûcher, plein la remise.
— Il te faudra en faire un tas dans la cuisine ; c’est plus prudent… Et puis encore prépare-nous des habits chauds, tout ce que tu pourras nous trouver en fait d’habits et on les rajoutera à mesure les uns par-dessus les autres.
Il a réfléchi encore ; puis a dit :
— Je crois que c’est tout.
Il n’était même pas deux heures ; ils avaient déjà allumé la lampe, pourtant la chambre donnait au midi. Et ils sont restés là l’un à côté de l’autre sans plus rien dire, pendant que la mère Revaz regardait, sur le couvercle rabattu où les veines, par une disposition du bois, étaient comme une gerbe d’épis, trembler les grosses mains molles et trop pâles. Pourquoi est-ce qu’elles avaient tellement pâli ? À ce moment, on était entré dans la cuisine. Le premier mouvement de Revaz avait été de refermer le secrétaire ; puis il avait pensé : « C’est sûrement Lucien. »
Il avait appelé :
— Lucien !
Et lui, avait ouvert la porte et regardait avec étonnement son père et sa mère assis sous la lampe devant le bureau.
— J’ai mis en ordre mes affaires, disait le père Revaz ; c’est pour le cas où… enfin tu sais bien…
Lucien disait :
— Non, je ne sais pas.
— Eh bien, ça ne fait rien… J’ai fait vos parts. Il y a trois paquets. Il y a le tien, il y a celui de ton frère, il y a celui de ta sœur. Et j’ai déjà montré où je les avais mis à ta mère. Mais peut-être que ta mère… oui, disait-il, il faut toujours compter avec les empêchements. Et si ta mère… Eh bien, toi, tu sauras… Là, tu vois… Il lui a montré les paquets. Puis il a dit : « Voilà le tien… Il y a votre nom à chacun dessus… »
Il a refermé le tiroir.
— Et pour le moment qu’est-ce que tu fais ?
— J’étais en train de réparer la herse.
— C’est pas pressant, a dit Revaz… Tu ferais mieux d’aller faire du bois…
Mais lui, n’avait pensé qu’à une chose et c’était : « On aura de l’argent, le père est bien plus riche que je ne croyais. Il ne m’avait jamais parlé de ce qu’il pouvait bien avoir, mais cette fois j’ai vu l’enveloppe… Il faut vite que j’aille le dire à Gabrielle. » Il avait empoigné sa hache ; puis, l’ayant cachée au pied d’un arbre dans le bois qui borde la route, avait couru à Saint-Martin d’En Bas. Non loin du village, il avait rencontré un gamin à qui il avait donné dix centimes :
— Tu sais où habite Gabrielle Dussex ?… Eh bien, va lui dire que je l’attends, mais tu ne le diras à personne qu’à elle. Si tu fais bien la commission, il y aura encore dix centimes pour toi. Le gamin était parti en courant. Et cependant Lucien se répétait : « C’était un gros paquet tout de même. Qu’est-ce qu’il pouvait bien y avoir dedans ? Des billets ? Mais alors on sera riches !… »
Il avait été s’asseoir devant un fenil sur un tas de poutres. D’où il était, on domine Saint-Martin d’En Bas. D’où il était, on voit le village qui est dans son creux au-dessous de vous, semblable, en cette saison, à un fond effondré de glacier, c’est-à-dire plein de crevasses. « Ça va bien, disait-il. Je vais demander à mon père de me faire une avance ; il ne pourra pas me la refuser. Seulement, elle, est-ce qu’elle va venir ? elle doit être fâchée depuis que je lui ai dit qu’on ne pourrait plus se voir comme on voulait ?... » Mais il a vu qu’elle venait quand même. Il voyait qu’il y a des moments dans la vie où tout change d’aspect par un retournement des choses. Elle était apparue là-bas et s’en venait marquée en sombre sur le chemin lui-même marqué en sombre, à cause des patins des luges et du frottement des souliers. Par moment, elle tournait la tête vers le village ; puis elle continuait à s’avancer quand même, ce qui a fait qu’il s’est mis debout et lève son chapeau en l’air. « Tu comprends, disait-il par avance, c’est que tout ça, c’est du passé… Viens vite ! Hé ! Gabrielle. » Il l’appelait à haute voix maintenant : « Hé ! viens vite qu’on t’explique… » Elle, on voyait qu’elle était fine et douce, un peu timide, un peu moqueuse, mince et grande. Elle s’était arrêtée, elle a souri sous son fichu. Et lui : « Tu es venue quand même, tu n’as pas eu peur qu’on te voie ? » — « Oh ! disait-elle, pourquoi pas ? Est-ce que je fais quelque chose de défendu ? » — « J’avais à te parler, oh ! disait-il, les nouvelles sont bonnes, mais où est-ce qu’on pourrait se mettre pour causer tranquillement ? »
Elle avait dit :
— On n’a qu’à entrer dans le fenil ; il est à nous.
Elle avait été prendre la clé qui était cachée sous des poutres ; ils avaient laissé la porte ouverte, ils se sont assis dans le foin.
— Tu comprends, c’est que mon père est tourmenté par ces histoires qu’on raconte. Tu es au courant ? non. Ça ne fait rien. Mais enfin, lui, ne voulait pas entendre parler, pour le moment, de ce mariage… Eh bien, tu sais, tout va changer.
— Quand ?
— Bientôt, dans une semaine ou deux, vers le douze ou le treize, parce que le père a eu peur, mais alors il va bien voir qu’il avait eu tort d’avoir peur. Et puis c’est qu’il a de l’argent.
Elle avait dénoué les pointes de son fichu qu’elle avait rejetées en arrière sur ses épaules ; on voyait qu’elle était blonde avec des cheveux fins et doux noués en chignon sur la nuque. Elle écoutait sans trop comprendre.
Et lui :
— Il faut que je te dise tout… Eh bien, j’y ai cru, moi aussi, pendant un temps.
— À quoi ?
Le foin derrière eux était plein de pétillements ; est-ce que c’est les sauterelles qui sont restées prises dans sa masse ou les longs fétus élastiques qui ont été pliés en deux et se détendent brusquement ?
— Est-ce que tu connais le père Anzévui ?
— Bien sûr, on va chez lui pour les remèdes.
— Eh bien, c’est un savant, il lit toute la journée dans des gros livres. Et une fois il a dit à mon père… Oh ! il avait fait ses calculs, il les avait faits et refaits. Et mon père l’a cru. Et toi ?
— Et toi ?
— Moi pas, mais mon père me disait : « Il vous faut attendre. » Et moi j’ai fini par me dire aussi : « Il nous faut attendre. » C’est que, moi aussi, j’ai eu peur. J’étais en fille…
Elle a ouvert les yeux tout grands :
— J’étais en fille, j’avais emprunté la jupe et le caraco de Sidonie, celle qui est chez Pralong, tu sais. On était une bande de garçons. On s’était dit qu’on allait faire une farce à Anzévui. Ils m’avaient dit : « C’est toi qui feras la fille… » J’ai fait la fille, oui, avec de la farine et puis une allumette pour les sourcils. Tu es fâchée ?… Voyons, Gabrielle, laisse-moi te raconter… Parce qu’on arrive, eux s’étaient cachés, et c’est moi qui cogne à la vitre. Eh bien, il était assis devant son feu. C’était minuit. Je disais : « C’est moi, monsieur Anzévui », tu comprends, avec une toute petite voix de fille. Je disais : « Monsieur Anzévui, ouvrez-moi ; j’ai besoin de vous. » Je cogne de nouveau à la vitre. Et, lui, jusqu’alors avait été assis devant son feu, me tournant le dos, et il était tout noir devant son feu, mais le voilà qui se lève. Il avait changé de couleur, il était tout blanc devant moi. C’était sa barbe. Mais alors, moi, j’ai eu peur, parce qu’il était comme un nuage…
— Et qu’est-ce que tu as fait ?
— Je me suis sauvé…
Il disait :
— Tu comprends, ça dérange… J’ai pensé : « Ça n’est pas un homme, c’est plus qu’un homme » ; j’étais dérangé.
— Et à présent ?
— Ah ! justement, c’est ce que j’étais venu te dire. Moi, je n’y crois plus, à ces histoires, mais mon père y croit toujours. Alors il a mis ses affaires en ordre ; il a fait trois paquets ; tu comprends, on est trois : il y a mon frère, ma sœur, moi. Et tout à l’heure il m’a appelé, il m’a dit : « Voilà le tien. » Eh bien, je l’ai vu ; il est gros. Je ne sais pas ce qu’il y a dedans, ça doit être des billets ; et bien sûr que je ne sais pas s’ils sont de mille ou de cinquante, mais enfin il y en a, il y en a beaucoup. On va pouvoir se marier.
Elle souriait ; elle a dit :
— Mais, toi, pourquoi est-ce que tu as changé ?
— Parce qu’ils se sont moqués de moi.
— Qui ça ?
— Les garçons, Métrailler, Tissières.
— Et puis ?
— Eh bien, c’est aussi l’argent, cette après-midi. Ça m’a fait plaisir, ça encourage. C’est pas possible que ça aille mal quand on sait qu’on en aura. Tu ne trouves pas ?
— Oh ! dit-elle, moi, c’est pas tant l’argent que toi, depuis le temps qu’on ne t’avait pas vu.
— J’osais pas, j’étais triste.
— C’est oublié, puisque tu es là.
Mais lui, qui suivait son idée :
— Moi, n’est-ce pas ? je savais bien qu’on avait une maison à nous, des champs, des prés, de la vigne ; je ne pouvais pas ne pas le savoir puisqu’on les cultive, mais de l’argent… Eh bien, on en aura aussi, de l’argent. On va pouvoir faire les annonces.
— Attendons.
— Pourquoi attendre ? Enfin oui, si tu veux, jusqu’au treize, puisque c’est le treize… Mais, dis donc, ne trouves-tu pas que c’est quand même une drôle d’histoire ?… Oui, disait-il, le temps qu’il a fait cet hiver. Et bien sûr qu’on ne voit pas le soleil chez nous pendant six mois et chez vous pas beaucoup plus, mais ce n’est rien : l’affaire est qu’il n’a pas fait beau une seule fois depuis octobre, il n’a pas fait clair une seule fois, il n’y a pas eu un seul jour sans brouillard ; alors les vieux, tu comprends, les femmes, les malades… Et ce grand fou avec ses livres…
— Oh ! dit-elle, c’est peut-être que ce soleil-là n’est pas seul à compter. Il n’y en a pas qu’un, tu sais.
— Et l’autre, où est-il ?
Elle a souri en penchant la tête ; elle a porté sa main sur sa poitrine un peu à gauche.
XI
Isabelle avait fait venir Jeanne Emery, la couturière ; c’était le vendredi. Elles avaient été s’installer dans la chambre d’en haut. Jeanne Emery avait apporté sa machine à coudre. Un bon feu brûlait dans le poêle de pierre allumé dès le matin. Isabelle avait posé un carton sur la table qui avait été poussée jusque contre les fenêtres à cause du mauvais jour ; et, l’ayant ouvert :
— Est-ce qu’il y en a assez, est-ce que tu pourras faire ?
— Ma foi !
C’était une pièce d’alpaga bleu toute pleine à ses cassures de jolis reflets argent.
— J’avais demandé à Augustin de me laisser écrire à Anthamatten pour lui redemander de l’étoffe ; eh bien, représente-toi, il n’a pas voulu. C’est la première fois.
— Qu’est-ce qu’il a ?
Elle se touche le front ; puis pose le doigt sur ses lèvres.
— Il ne faut pas en parler : c’est des bêtises. Qu’est-ce que tu veux ? il ne pense plus qu’à son bois. Il est encore parti pour la forêt, ce matin, avec Jean…
— Eh bien, dit Jeanne Emery, on va toujours prendre les mesures. On va voir ce qu’il faut d’étoffe pour la jupe et on se rendra bien compte ensuite de ce qu’il en restera pour le caraco.
— Oh ! disait Isabelle, c’est drôle, c’est la première fois qu’Augustin me refuse quelque chose. Et pourtant, je sais y faire. Je lui ai dit : « C’est pour le printemps. C’est le printemps qui va venir, Augustin. » Il a haussé les épaules. Il a mauvaise mine : ils sont comme ça cinq ou six à avoir mauvaise mine dans le village, tu sais pourquoi. Et, moi, j’avais beau lui dire : « Ne trouves-tu pas pourtant que c’est à nous de commencer, à nous, les femmes, oui, à nous de nous faire belles ? ça encouragera le beau temps. » Il m’a dit : « Tais-toi ! tu ne sais pas ce que tu dis. ». Et je lui disais : « Voyons, Augustin, viens ici. » Je lui disais : « Est-ce que c’est encore non ? » Je lui ai donné, pour commencer, un baiser sur le bout du nez en attendant qu’il dise oui et que ce soit le tour du bon ; mais, le bon, il n’est pas venu… Tant pis !
Jeanne Emery avait pris son centimètre. Isabelle a ôté son corsage. Il s’était mis alors à faire clair dans la chambre comme si le soleil était déjà revenu. Il a semblé qu’on avait avancé de deux bons mois dans la saison.
— Oh ! disait Jeanne Emery, ce n’est pas seulement la figure, dis… Ce n’est pas seulement la figure que tu as dorée. Comment fais-tu ?
— Je fais rien, disait Isabelle.
— 87.
C’était la hauteur de la jupe.
— Tu la veux courte, hein ?
— Bien sûr… Quand c’est court, c’est plus commode pour aller danser aux mayens…
Jeanne Emery inscrivait les chiffres sur un carnet. 69. C’était le tour de taille.
— Et puis tu l’as fine, tu sais.
Mais Isabelle a soupiré :
— Qu’est-ce que tu veux ? c’est pas ma faute. C’est qu’il est paresseux, disait-elle, et pas adroit. Voilà déjà huit mois, hein ? qu’est-ce qu’il faut faire ? Oui, huit mois qu’on est mariés. Moi qui disais à Augustin : « Il faut que les enfants viennent en été, il faut qu’ils viennent quand le temps est beau, si on veut qu’ils profitent… » Et voilà, il ne viendra pas, l’enfant, s’il vient, avant l’hiver prochain ; et il ne viendra peut-être jamais. Jeanne Emery, je te dis : « Fais-la courte. »
Elles étaient bonnes amies, bien que Jeanne fût un peu plus âgée qu’Isabelle, et entre amies on se dit tout.
— Fais-moi une jupe de fille, et on pourra recommencer à aller danser aux mayens…
— Avec qui ?
— Avec qui voudra. Tu viendras, Jeanne ?
— Attends, disait Jeanne, il faut que je mesure la pièce à présent.
— Il y en a trois mètres cinquante.
— Attends, un, deux, trois ; pas tout à fait. Et il va falloir compter deux mètres cinquante pour la jupe… Il ne me restera même pas un mètre…
Elle venait avec sa chevillière en toile cirée, et Isabelle : « Bigre ! ça fait froid » ; la lui a posée sur la peau depuis la nuque jusqu’à l’épaule, et depuis l’épaule au poignet :
— C’est que tu es ronde ! Je n’aurai pas de quoi faire le col.
— Eh bien, n’en fais point.
— Qu’est-ce qu’on dira ?
— J’ai des fichus, personne n’y verra rien… Oh ! disait-elle, j’ai toute espèce de choses ; c’est quand on était fiancés, quand il me faisait encore des cadeaux, c’est quand on allait à la foire ensemble…
Elle est descendue l’escalier ; elle remonte avec une petite boîte toute couverte de coquillages, les gros collés sur le couvercle, les plus petits sur le côté ; qu’elle portait dans les deux mains ; avec un fermoir doré et une serrure :
— Et, ça aussi, ça vient du temps où on était fiancés.
Il y avait dans la boîte, pliés en quatre, des mouchoirs de soie, une broche en or, des boucles d’oreilles, un collier de corail, des épingles à cheveux, des peignes en cuivre.
— Tu vois, il y a de quoi faire, parce que c’était le beau temps, mais il reviendra, le beau temps ; on le fera bien revenir s’il ne veut pas revenir tout seul… Écoute, Jeanne, coupe toujours la jupe ; pour le reste, on s’arrangera. Quand est-ce que je pourrai essayer ?
— Dimanche après-midi, veux-tu ?
— Chez toi ?
— Chez moi, si tu veux.
— J’aime mieux, disait Isabelle ; j’aime autant qu’il ne sache rien.
Elle a essayé ses fichus devant la glace ; elle faisait soleil dans la glace. Elle faisait dans la glace une belle couleur qui était renvoyée sur elle et autour d’elle : c’était celle de l’abricot, c’était celle du muscat tout à la fin de la saison. Elle mettait autour de son cou ces carrés de soie qu’elle pliait en diagonale ; ils avaient des franges, elles étaient frisées, et entre les franges on voyait sa peau.
Et Jeanne Emery disait :
— Comment fais-tu avec tes cheveux pour qu’ils brillent tellement ?
— Je les lave avec de la soude.
— Et ensuite comment fais-tu ?
— Je les sèche devant le feu.
Moi, je plante un clou, c’est le dernier. « Et puis, pensait Brigitte, je ne bougerai plus. »
Elle avait encore été changer l’huile de sa lampe ; elle en avait mouché la mèche, elle était revenue s’asseoir ; et elle était là qui se disait : « Je serai prête quand le moment sera venu, mais comment est-ce que ce sera ? » Il continuait à faire sombre sur le village ; nulle part, ni en dehors de la maison, ni en dedans, il n’y avait le moindre bruit ; elle avait joint ses mains dans le creux de sa jupe, elle penchait la tête, faisant silence en elle-même : « Là où il y a le 13 un feu sur la montagne, il n’y aura plus rien du tout. Dans trois jours. Je ne bouge pas. Il faisait vert là-haut, il faisait jaune, il faisait rose, dans le temps ; et c’était tout à coup comme quand on jette une brassée de bois dans le feu : eh bien, il fera gris, et puis le gris deviendra plus sombre, et toujours un peu plus sombre. Je ne bouge pas. J’apprends. »
J’aurai allumé mon feu, j’ai une bouteille pleine d’huile : et, voilà, je me tiendrai bien tranquille jusqu’à ce qu’il fasse nuit ; mais il ne fera pas tout à fait nuit pour moi, ni tout de suite, parce que j’aurai ma lampe allumée et elle durera bien autant que moi. »
Anzévui a dit qu’il fera froid et toujours plus froid, mais j’aurai mon feu ; il durera bien aussi longtemps que j’aurai la force de tendre le bras. » Aussi longtemps que mon cœur battra, aussi longtemps que mon vieux sang aura gardé assez de chaleur sous ma vieille peau ; – ensuite que Votre volonté soit faite, à Vous qui décidez de tout, parce que, Vous voyez, je ne me défends pas, je ne proteste pas, je ne me débats pas, je ne discute pas ; et la flamme de la lampe sera là pour le dire quand Vous viendrez, entrant doucement dans les maisons l’une après l’autre et puis ce sera la mienne. »
Elle avait fermé les yeux, elle les rouvre ; c’était l’heure de descendre à la messe. Elle s’est enveloppée dans son châle, elle s’est noué autour de la tête un fichu de laine noire ; elle a été prendre son livre de messe, et, en même temps, ouvrant un tiroir, quatre petits objets durs et ronds, empaquetés chacun dans un morceau de journal, et qu’elle a mis dans sa poche. Elle ne marchait pas vite, c’est pourquoi elle est partie un peu d’avance ; et ainsi elle s’est trouvée être seule sur le chemin. Il était ouvert cette fois et bien battu, parce qu’il n’avait pas neigé depuis longtemps. Et, même quand la neige ne fond pas, à mesure qu’on avance dans la saison, elle se tasse et toujours davantage, diminuant sans cesse d’épaisseur ; de sorte qu’on circulait sans peine, et, à cause de la salissure que les pieds à la longue apportent où ils frottent, il n’y avait même plus besoin de mettre des pions de bas sur ses souliers, comme font les vieilles femmes pour s’empêcher de glisser. Ainsi la messe avait eu lieu, ce dimanche-là, comme tous les autres dimanches ; comme tous les autres dimanches, ceux de Saint-Martin d’En Haut y avaient assisté ; il ne s’est rien passé du tout ; même les hommes de ce Saint-Martin-là étaient restés un moment à causer devant l’église ; et il n’y a eu que Brigitte, parce qu’elle avait toujours les quatre petits paquets dans sa poche, qui s’est hâtée, à travers le village, jusqu’à une maison où habitait une sœur qu’elle avait.
— Eh ! disait sa sœur, qu’est-ce qui t’amène ?
— Je suis venue vous dire bonjour.
— Il y a bien longtemps qu’on ne t’avait pas vue. Reste à dîner avec nous.
— Je ne peux pas.
— Pourquoi est-ce que tu ne peux pas ?
— J’ai un ménage à faire.
— Bah ! dit sa sœur, une vieille fille comme toi.
— C’est pas le mien… C’est celui d’Anzévui.
— Le vieux aux herbes ?
— Oui.
— Comment va-t-il ?
— Il ne va pas bien… Mais, dit-elle, où sont les enfants ?
— Ils ne sont pas rentrés.
— Ah ! dit Brigitte.
— Que si, en voilà toujours deux.
C’étaient deux grandes filles qui étaient entrées à ce moment. Brigitte a pris deux des petits paquets dans sa poche :
— Je vous avais apporté, dit-elle, un petit… un petit souvenir. Il y en a un pour chacun.
Tout le monde était bien étonné, parce que Brigitte était pauvre. Des souvenirs ? qu’est-ce que ça pouvait bien vouloir dire ?
— Va chercher tes frères. Ils doivent être au café. Dis-leur que leur tante Brigitte est là… C’est ce que la mère avait dit à la plus grande de ses deux filles qui est sortie et est revenue, un instant après, avec deux garçons d’une vingtaine d’années.
Et Brigitte leur avait tendu à chacun son petit paquet. Ils disaient : « On peut voir ? »
C’était une pièce de cinq francs.
Ils disaient : « Oh ! merci bien… »
Elle disait : « C’est un souvenir. »
Mais eux riaient : « Ça ne pouvait pas mieux tomber. Il y a justement réunion de la Société de Tir, cette après-midi. Et on ne voulait pas y aller… »
— Ils ont fait leur service militaire tous les deux, disait leur mère ; ils sont tous les deux fusiliers…
— On ne voulait pas y aller parce qu’il faut boire et que ça coûte… Mais on va avoir de quoi faire… Merci bien.
XII
Il faut dire que la saison a été, jusqu’à la fin, de telle sorte qu’elle semblait donner raison à ceux qui avaient cru Anzévui. Il disait : « C’est que le soleil est malade. Il n’a plus assez de vertu pour dissiper le brouillard. »
Il disait : « Il baisse tous les jours un peu plus, il est diminué tous les jours un peu davantage, il se refroidit, il se rétrécit ; mais n’en dites rien à personne pour ne pas effrayer le monde avant le temps. »
C’est pourquoi Brigitte n’avait rien dit. Et lui, toussait sous ses plantes, mais ceux qui étaient au courant hochaient la tête : « On ne peut pas lui donner tort. »
Car, même au gros de l’hiver, même dans ces villages où le soleil ne se montre pas de tout le jour, rien n’est plus beau à voir, d’ordinaire, que la pureté du ciel et l’éclat de la neige. Même ici où on ne voit pas le soleil pendant six mois, on le sent qui est là, derrière les montagnes, et envoie en délégation ses couleurs, qui sont le rose pâle, le jaune clair, le roux, dont un pinceau minutieux revêt autour de vous les pentes. La neige sur les toits est comme du linge qu’on vient de passer au bleu ; elle est sur le côté des toits comme des piles de draps de lit pliés en quatre dont on voit les épaisseurs, lesquelles débordent ; et la masse dépassante, de temps en temps, se rompt et tombe, avec un bruit d’écrasement, comme un fruit mûr. La neige est à la pointe des pieux comme des bonnets en laine d’agneau. L’air est à la fois immobile et animé d’un mouvement secret ; il ne se respire pas, il se boit. Il est plus transparent que le cristal, si loin que porte le regard, de sorte qu’au lieu de ternir les choses ou de les brouiller, il les rend nettes, il les rapproche, comme des verres de lunette. Et il y a un moment où le soleil, tout en restant caché pour vous, éclaire brusquement les montagnes qui sont plus au fond de la vallée, toute une grande chaîne en demi-cercle qui est là : alors c’est comme un tas de copeaux où on viendrait de mettre l’allumette. Voilà ces grandes vues sur des lieues de montagnes et, pendant qu’on est soi-même dans l’ombre, de toutes parts elles flamboient ; des centaines de sommets alignés dans le ciel, de toutes les formes, de toutes les couleurs ; les triangulaires, les carrés, ceux à plusieurs pans, les arrondis, ceux qui ne sont qu’un redressement de l’arête, ceux qui dégagés à leur base se dressent dans l’isolement, comme des colonnes, comme des tours, comme des troncs d’arbres ; les pointus, les usés, les émoussés, les pas pointus ; ceux qui sont comme un tas de blé mûr, ceux qui sont transparents comme de l’air durci, comme des superpositions de blocs d’air ; ceux qui sont comme un glaçon dont un enfant a sucé la pointe ; – tandis qu’à leur pied les grandes pentes juxtaposent des bandes d’ombre et de lumière, rompues un peu plus bas par le pointillé des forêts. Tout s’entend jusqu’au fond de l’espace, tout se voit jusqu’au fond du ciel : même la légère fumée, comme celle d’un petit train, que soulève sur une crête le passage d’un skieur. Et, une fois que la nuit est venue et que tout s’est éteint, autant il y avait d’étincelles sur la terre blanche, autant il y a maintenant de scintillations dans le ciel noir.
Cet hiver-là, la neige restait grise, le ciel bas, tout était triste ; même, ces derniers jours, on eût dit que le peu de lumière qu’il y avait s’affaiblissait encore, particulièrement le dimanche après-midi où Julien Revaz était arrivé.
— Qu’est-ce qui se passe ? disait-il, c’est mon père qui m’a appelé.
— Des sottises, disait Follonnier… Mais enfin tant mieux pour toi ; ça va te faire des vacances.
On disait à Revaz :
— Et là-bas, quel temps fait-il ?
C’était plus tard, dans la soirée, chez Pralong ; malgré l’allongement des journées, il avait fallu, dès les quatre heures, allumer les lampes. Et les hommes avaient fait le chemin de chez eux chez Pralong, les inquiets et les pas inquiets, les mains dans les poches. Ils n’avaient pas quitté leurs bonnets faits avec des peaux de bête. Ils n’avaient pas quitté leurs vêtements d’hiver, c’est-à-dire qu’ils portaient comme en décembre, sous leur veste, de gros gilets à manches en laine non dégraissée. Car il continue à geler ; il gèle non seulement la nuit, mais tout le long du jour.
Ils avaient allumé leurs pipes, leurs cigares.
Les nouvelles de la guerre n’étaient pas meilleures. La T.S.F. les leur avait communiquées vers les sept heures. Il y avait eu ensuite un concert d’accordéons. Là-dessus, Julien Revaz était entré. Ils avaient appelé Sidonie :
— Dis donc, Sidonie, si tu les faisais taire ?
Elle vous supprime la musique rien qu’en tournant un bouton ; et, s’ils ne se voyaient plus très bien les uns les autres dans la fumée, du moins à présent pouvaient-ils s’entendre ; de sorte qu’ils disaient :
— Hé ! Julien, où es-tu ? Viens te mettre ici. Comment ça va-t-il par là-bas ?
— Pas mal.
— Et le temps ?
— Eh bien quoi ? Il fait beau, il fait mauvais, c’est de saison. Aujourd’hui, on a le soleil ; le jour d’après, le ciel fait la grimace.
— C’est pas comme ici.
— Eh ! dit Julien.
— Oui, c’est drôle. On n’a jamais autant brûlé d’électricité que cet hiver. Et ton père ?…
— Ben ! qu’est-ce que vous voulez ? c’est lui qui m’a dit de revenir. J’ai demandé congé. J’ai dû raconter là-bas qu’il était malade… Et puis quoi ? dit-il, c’est que c’est vrai, il a mauvaise mine, ma mère aussi… Ben, croyez-vous ?…
— Des sottises ! disait Follonnier… Si tu nous racontais plutôt ce que vous faites au bord du lac.
— C’est comme toujours ; on remonte la terre, on taille la vigne…
— Eh bien, on n’a encore rien pu faire par ici…
— On porte le fumier. Il fait des jours où c’est déjà le printemps ; on se dit : « On y est ! » on ôte son gilet, il y en a même qui ôtent leur chemise, et il pleut le lendemain ; mais ça n’empêche pas qu’on est déjà bien avancé et que ça chauffe déjà fort quand le lac au tournant d’un mur vous vient contre avec son soleil.
— C’est qu’ils en ont deux, disait Follonnier, et nous point.
Il se mit à rire.
— C’est pas juste ! Ils en ont trop, et nous autres, pas assez… Comment veux-tu, nous autres, qu’on remonte la terre ? il nous faudrait gratter la neige comme des poules. Comment veux-tu qu’on porte le fumier ? les tas glisseraient sur la neige et descendraient chez le voisin, et le voisin chez son voisin. Est-ce que ça ferait le compte ? Qu’en penses-tu, Arlettaz ?
Car Arlettaz était là comme toujours et Arlettaz était assis dans un coin devant cinq ou six litres vides : et Arlettaz a dit : « Voleur ! » et c’est tout. Alors Follonnier a ri de nouveau ; il disait à Julien Revaz :
— Tu vois comment on est, nous autres. Pas commodes, pas tant polis… C’est qu’on vit trop haut et trop à l’ombre, nous autres, parce qu’il y a trop de montagnes et qu’elles sont trop près de nous ; ça nous donne mauvaise mine, on est comme des pommes de terre qui sont restées trop longtemps en cave ; ça nous donne aussi l’humeur triste : pas à moi, dit-il, mais regardez… Toi aussi, Julien, je vois bien, quand même tu viens de là-bas.
— Il y a déjà des fleurs, disait-il, là-bas, il y a déjà des oiseaux qui chantent : et c’est de voir que rien ne bouge encore par ici et il y en a qui disent que rien ne va plus jamais bouger.
— Ah ! voilà, mais santé ! Julien. Encore quelques jours de patience et puis tu verras, tout ira bien. Hé ! Arlettaz…
— Voleur ! dit Arlettaz.
— C’est tout ce que tu sais nous dire ?
— Voleur !
Mais on voyait qu’Arlettaz ne se tenait même plus assis. On commence par ne pas pouvoir se tenir debout : lui, il avait beau être bien tassé sur son banc et bien calé sur ses deux coudes : on le voyait qui glissait de côté ; ses yeux se fermaient, ses yeux se rouvraient. Qu’est-ce qu’il va falloir en faire, hein ? Holà, Arlettaz !
Il a essayé de tourner la tête vers vous ; elle ne lui obéissait plus.
Voilà comment nous sommes, ce dimanche soir, à quatorze cents mètres, par temps bouché, assis ensemble une quinzaine chez Pralong, où c’est à peine si les lampes électriques arrivent encore à éclairer dans la fumée ; on dirait des jaunes d’œufs qui ont coulé. Ils regardaient tous à présent vers Arlettaz. Tout à coup, un de ses bras a quitté l’appui de la table ; et sa tête est venue donner sur le rebord du plateau de bois peint en brun.
— Eh !
Il ne cherche même pas à se relever, son chapeau est tombé par terre. Sa barbe trempe dans le vin répandu, parce qu’il a renversé son verre ; son bras pend le long de son corps comme une branche cassée. On est venu, on l’a redressé, on l’a remis d’aplomb sur ses deux coudes, on lui parle, il ne paraît pas vous entendre.
— Hé ! Sidonie, dit Follonnier, combien est-ce qu’il te doit ?
— Il y a trois litres ce matin, quatre cette après-midi et puis ce soir…
Elle compte les litres qui sont sur la table :
— Cinq et quatre et trois, douze…
— Douze à un franc cinquante, dix-huit francs. Eh bien, on va te payer. Et puis, vous autres, vous allez venir me donner un coup de main.
Il fouille dans la poche du pantalon d’Arlettaz. Il dit : « Mon pauvre Arlettaz, je te vole encore une fois, vois-tu, mais il le faut bien. »
Il a retiré sa main pleine de petite monnaie, de billets pliés, de pièces d’argent : « Tiens, tu es encore riche. » Puis : « Vous voyez, vous autres ? Cinq, dix, douze, quatorze », alignant à mesure sur la table les écus, les pièces, les piécettes… « Dix-sept francs cinquante, dix-huit francs ; ça fait le compte. Et, vous voyez, je remets ce qui reste où je l’ai pris ; si jamais il m’accuse encore, vous me servirez de témoins. »
Il riait. La soirée finissait mieux qu’elle n’avait commencé. Il y avait de la distraction. Ils ont dit : « Maintenant il s’agit de le porter chez lui, sans quoi il va rouler sur le plancher. » Ils s’y sont mis à cinq ou six ; les autres s’amusaient de les voir faire. Ils avaient tapé sur l’épaule d’Arlettaz ; ils lui avaient dit : « Arlettaz, il te faut venir, c’est l’heure, Pralong ferme… » Ce n’était pas vrai : « Tu viens, Arlettaz ? » disaient-ils. Mais il n’entendait même pas, étant enfermé en lui-même, le front appuyé sur le bras, si bien qu’on ne voyait plus que le mauvais côté de sa tête continuée en arrière des oreilles par la barbe ; alors voilà que Follonnier l’a empoigné par les cheveux : « Allons ! tu entends ? » disait Follonnier, et il lui a relevé la tête, mais sitôt qu’on la lâchait, elle retombait.
— Eh ! Lamon, prends-le par les pieds.
Les autres s’étaient mis debout pour ne rien perdre du spectacle : ils faisaient cercle autour de Follonnier :
— Eh ! Revaz, donne-nous, toi aussi, un coup de main. Occupez-vous du bas, moi je me veille le haut… C’est ça, tirez-le de côté. Attention au banc. Ça y est.
Il disait :
— Voyons, Arlettaz, sois gentil. Tu seras tout de même mieux dans ton lit…
Et puis, s’étant penché à l’oreille d’Arlettaz :
— Et puis tu sais, si tu te laisses faire, ta fille… Oui, elle reviendra.
Arlettaz s’était tout à coup redressé :
— Adrienne ?
— Tu ne voudrais pourtant pas qu’elle te voie en pareil état ?
— Où est-ce qu’elle est ?
— Viens toujours.
— Voleur ! a dit Arlettaz.
Il s’est laissé retomber sur la table ; mais Follonnier et le patron l’avaient empoigné par les épaules. On leur a ouvert la porte. La fumée cherchait à sortir et ne pouvait pas sortir, parce qu’en même temps le brouillard cherchait à entrer. Il y a eu lutte et rivalité entre le brouillard et la fumée, ce qui faisait une espèce de voûte au-dessus d’eux qui se tenaient penchés ; puis quelqu’un a dit, tellement il faisait sombre : « Il faudrait une lanterne. » On avait été chercher une lanterne. Heureusement. Sans lanterne on n’aurait même pas vu le chemin. Arlettaz gémissait. La lanterne allait devant, puis venaient ceux qui tenaient Arlettaz par les pieds, puis ceux qui le tenaient par les épaules, et Arlettaz pendait entre eux de sorte que le milieu de son corps traînait par terre où c’est gelé, où c’est un mélange de glace et de terre ; mais on ne voyait rien, tandis que par moment il essayait de se débattre, puis il y renonçait, puis plaignait ; et eux disaient : « On va y être » ; avançant derrière le rond pâle que faisait le falot sur le sol. Les lumières étaient éteintes dans les maisons qu’on ne voyait pas. Follonnier disait : « Ça va ? » Ils disaient : « Ça va » ; puis il y a eu un moment où ça n’est plus allé : ils ont déposé Arlettaz par terre. Et il est resté là sans bouger, comme un mort. Ils riaient ; la lanterne est repartie ; ils disaient : « Heureusement que le mort est léger. »
— On arrive, disait Follonnier.
La lanterne a pris à droite : « Va devant voir si c’est ouvert. »
Il n’y a plus eu de lanterne, mais une voix est venue, qui disait : « Oui, c’est ouvert. »
— Alors éclaire-nous, on ne sait plus où on met les pieds.
Parce qu’ils butaient contre des pierres, puis ils ont vu qu’il y avait, en travers du chemin, deux vieilles marches mal dégagées d’une croûte de terre et de glace qui en rendait la tranche glissante ; alors ils avaient essayé de remettre Arlettaz sur ses jambes, mais n’y avaient pas réussi.
Ils ont passé difficilement la porte de la cuisine, et, d’ordinaire, on ne porte pas les morts chez eux, on les en sort ; eux, ils portaient chez lui le mort.
À peine s’ils ont pu traverser la pièce tellement elle était encombrée. Il leur a fallu écarter du pied toute espèce d’objets qui traînaient par terre avant de parvenir à ce qui avait été un lit et qu’on reconnaissait pour être un lit aux montants de bois, entre lesquels il y avait un amas de chiffons sales qui étaient des lambeaux de draps et des débris de couverture.
Il était environ dix heures ; elle, elle s’étonnait qu’Augustin, son mari, ne fût pas encore de retour. Il l’avait quittée après le souper pour aller dire bonsoir à ses parents ; c’était la maison d’à côté. Eux, on leur avait construit une petite maison neuve rien que pour eux, quand ils s’étaient mariés : ainsi les vieux, comme il convient, sont parmi les vieilles choses ; eux, sont les jeunes, c’est pourquoi on les met parmi les choses neuves. Elle se demandait : « Qu’est-ce qu’il fait ? » Elle s’ennuyait vite quand elle était seule. À quoi ça servirait-il d’être belle, comme on est, s’il n’y avait pas des cœurs pour en être troublés, et des voix pour le dire au monde ? Elle avait passé une partie de l’après-midi avec Jeanne Emery, elle avait rencontré des gens en rentrant chez elle, elle avait ri comme toujours et bavardé ; à présent, plus personne. Et, quand l’aiguille du réveille-matin, qui était placé au-dessus du fourneau sur un rayon orné d’une dentelle de papier rose, eut dépassé le chiffre X, elle n’y avait plus tenu, elle s’était levée.
Elle les avait trouvés, les trois, qui étaient assis dans la cuisine de l’ancienne maison, Augustin, son père et sa mère.
Ils ne disaient rien, tous les trois.
Eux, le vieux et la vieille, ils étaient usés. Eux, il était dans la nature qu’ils fussent déshabitués de parler, parce que le sang se refroidit et puis qu’à force d’avoir dit, on finit par n’avoir plus rien à dire. Il y avait un journal sur la table, mais ni le père ni la mère Antide ne le lisait ; et c’est encore dans la nature, bien sûr, parce qu’ils étaient l’un et l’autre fatigués, mais Augustin ? Il ne parlait pas, il ne lisait pas, lui non plus ; ils étaient là tous les trois à se taire ; et, comme elle avait poussé la porte, ils ont tourné, tous les trois à la fois vers elle trois mêmes figures ravagées, de sorte qu’Augustin semblait aussi vieux que ses parents.
— Eh bien ?…
Ils ne répondaient pas ; ils étaient comme Arlettaz tout à l’heure.
— Savez-vous quelle heure il est ?
— Ma foi… a dit le père Antide.
Et la mère Antide, elle, a levé une de ses mains qui étaient posées l’une sur l’autre devant elle ; elle la laisse retomber comme pour dire : « Qu’est-ce que ça peut faire ? Est-ce qu’on s’occupe encore du temps quand on sait que le temps est une chose qui va finir ? » Isabelle avait pris Augustin par le bras, elle lui a dit : « Est-ce que tu viens ? »
— Et Jean, où est-il ? disait-elle.
— Oh ! dit la mère Antide, il y a longtemps qu’il est allé se coucher. Il est insoucieux, lui, il est jeune. Nous autres…
Isabelle n’avait pas eu l’air d’entendre. Et Augustin s’est laissé faire, il l’a suivie ; il tendait la main dans la nuit, demandant : « Eh ! où est-ce que tu es ? » Mais, elle, elle a ouvert la porte de leur petite maison à eux, faisant ainsi avancer jusqu’à lui la lumière de la lampe comme un tapis qu’on déroulerait sur les marches du perron. Il y avait maintenant autour d’eux sur les murs leurs parents qui les regardaient ; et le sergent d’artillerie croise les bras sur sa poitrine de façon à mettre en valeur les galons qu’il a sur les manches. Le lit était si haut perché qu’il fallait s’aider d’une chaise pour y atteindre. Le lit avait un beau couvre-pieds de dentelle à fond grenat. C’est un lit à la vieille mode avec une garniture à la nouvelle mode ; c’est qu’on est jeunes, n’est-ce pas ?
— Augustin…
Elle s’était couchée à côté de lui, elle avait éteint la lampe ; et il n’y avait plus rien eu à voir, ni à entendre, nulle part, dans le monde vide et silencieux. Ils en avaient été retirés, ils avaient été transportés dans un autre monde qui n’était qu’à eux. Elle avait fermé les portes, toutes les portes ; j’ai tout fermé, Augustin, disait-elle ; et on est chez nous à présent, on est chez nous, rien que les deux. Est-ce qu’elle lui parle avec des mots véritables ou si c’est en dedans qu’elle lui parle, parce qu’il y a beaucoup de façons de parler ? Mais il faut essayer encore et une dernière fois essayer : alors elle lui parle avec son pied qui va chercher le sien, avec sa main impatiente, avec son corps gourmand de lui ; il ne semble pas comprendre.
Il s’est tourné du côté du mur ; elle l’appelle à haute voix :
— Augustin ! Hé ! Augustin… Ah ! dit-elle, tu ne dormais pas ?… Eh bien, écoute, il y a une chose que je voulais te demander : « Est-ce que tu viendrais avec moi ? »
Il ne s’est même pas retourné.
— Où ça ?
— Là-haut, sur les crêtes.
Il ne disait de nouveau plus rien. Et elle :
— Oh ! Augustin, est-ce que tu es muet ? ou bien est-ce que tu ne m’entends pas ? C’est comme si je te parlais du haut d’une montagne et, toi, tu serais dans le bas. Comme si je t’appelais d’un côté de la vallée et, toi, tu serais de l’autre côté. Est-ce qu’on est si loin l’un de l’autre en même temps qu’on est si près ? Augustin, tu ne réponds rien : est-ce que tu viendras avec moi ?
— Quand ça ?
Elle a fait le compte ; elle a dit :
— Ça doit être le 13, mercredi prochain.
Il a demandé :
— Quoi faire ?
— Aller dire bonjour au soleil, Augustin. Parce qu’il va revenir quand même.
Mais il a grogné quelque chose, et puis s’écarte d’elle, gagnant, dans la largeur du lit, toujours plus du côté du mur.
XIII
Alors Jean était occupé à la remise le lendemain matin quand Isabelle est arrivée. Il était assis sur le gros plot de bois où est enfoncée la petite enclume qui sert à battre les faux ; il était en train de réparer une pelle, ce qui a fait qu’il avait dû lever la tête, recevant le jour de face, bien que ce fût un pauvre jour.
Elle a dit :
— Je suis vite venue parce qu’Augustin est allé au village. Heureusement que tu es là.
Il a posé la pelle en travers de ses genoux :
— Comment ça va ?
— Et toi ?
— Ça va bien, merci.
Il lui a fait le salut militaire en portant la main à ses cheveux frisés ; ses dents ont été belles blanches dans le bas de sa figure qui avait la couleur du bois dont sont faits les façades des chalets. Il était assis, elle était debout.
Elle a repris :
— Tu as bien dormi ?
— Oh ! moi, je dors toujours bien, tu sais.
— Eh bien, moi, je n’ai pas dormi, dit-elle.
Et puis regarde par la porte ouverte vers le chemin qui mène au village si Augustin n’allait pas se montrer peut-être, mais on ne voyait personne ; d’ailleurs, elle le verrait venir de loin.
— Il te faut prendre ton cornet, Jean, le cornet de quand tu gardais les chèvres, et puis tu souffleras dedans.
— Pourquoi faire ?
— Écoute, lui dit-elle, je ne t’ai pas encore expliqué ; c’est mercredi prochain. Tu sais bien ce qu’ils disent. Eh bien, nous, on ira, veux-tu ? Juste au moment où ils disent que le soleil ne se montrera plus jamais, nous on monte dans la montagne pour l’aider à sortir. Parce qu’il sortira, tu sais.
— Et Augustin ?
— Il ne veut pas venir. Et toi ?
— Moi je veux bien.
— Alors tu iras vite prévenir Métrailler parce qu’il connaît mieux les passages que nous. Demande à Métrailler de prendre son fusil. Moi, je dirai à Jeanne Emery de venir, on sera cinq ou six, on ne dira rien à personne, on partira de bon matin. Et, toi, tu souffleras dans ton cornet, comme quand tu gardais les chèvres…
Elle regardait toujours de temps en temps vers le chemin ; lui, riait assis sur son plot ; ils sont là, les deux, qui se parlent, avec des figures heureuses, pendant qu’elle jouait sur sa poitrine avec les pointes de son fichu.
— Tu étais petit, je me souviens, et moi pas beaucoup plus grande que toi. Tu te souviens ? Quand tu partais avec tes chèvres de bonne heure le matin ; nous, on regardait de derrière les vitres. Nous autres, on regardait pieds nus et en chemise ; et il y avait la grande blanche qui partait toujours en avant, il y avait la petite noire qui ne voulait jamais suivre, il y avait la mère Émonet qui était toujours en retard ; alors tu te mettais en colère et tu soufflais de toutes tes forces dans ton cornet.
— Je me souviens ; c’est pas si vieux.
— Eh bien, tu vas recommencer. Frotte-le avec de la poudre blanche pour qu’il soit bien brillant quand le soleil reviendra. C’est un instrument de cuivre avec une embouchure de corne noire ; lui, riait.
— Une bonne idée, disait Jean ; ça nous fera une promenade. Et puis ça marquera mieux la différence, disait-il. Parce qu’il y a ceux qui vivent dans les chambres et il y a ceux qui vivent en plein air. Nous, on est ceux qui vivent en plein air.
— Je vais m’entendre avec Jeanne Emery. On se donnera rendez-vous chez elle. Il faudra seulement qu’on se garde le secret les uns aux autres, ceux qui viendront. Toi, Métrailler, Tissières, Jeanne Emery, moi, et puis on verra… Métrailler avec son fusil, toi avec ton cornet. Et on le fera sortir d’où il est, le soleil, même s’il ne veut pas.
— Moi, je pense bien qu’il voudra.
— Parce qu’ici, au village, tu te rappelles, il ne se montre guère que vers les dix heures ; nous on l’aura avant huit heures et on le leur annoncera.
— C’est entendu.
Jean se lève. Il s’approche d’Isabelle :
— Seulement, Isabelle, puisqu’on s’entend bien entre nous, est-ce que tu me donnes quelque chose ?
Elle a dit :
— Quoi ?
— Oh ! dit-il, veux-tu ? sur le front.
Elle le prend par les deux oreilles. Et vite jette encore un regard du côté du chemin : et puis là où c’est doux, étroit, là où l’os est juste sous la peau, de sorte qu’elle est bien tendue ; au-dessous de l’endroit où sur une même ligne les cheveux sont plantés dru, comme au bord d’un champ de blé les tiges mêlées par le vent :
— Oh ! bien sûr, disait-elle, et c’est juste, puisque, lui, il ne veut pas.
Alors il a fait encore une journée triste, puis il a fait une seconde journée triste. C’était vers les dix heures du soir. Les lumières en s’éteignant aux fenêtres retranchaient les maisons du monde, et faisaient d’elles de la nuit dans la nuit. Les maisons avaient renoncé, l’une après l’autre, à être. Il n’y avait plus eu dans toute cette mort qu’une faible lueur qui indiquât la place du village et marquât encore qu’il était en vie ; c’était la lampe de Brigitte qui continuait à briller, mais à peine ; et est-ce qu’elle ne va pas s’éteindre et qu’est-ce qu’il restera de nous si elle s’éteint ?
Denis Revaz s’était couché, mais n’avait pas pu s’endormir.
Il était peut-être onze heures quand il s’est dit : « Est-ce qu’on m’appelle ou bien si je rêve ?… »
Mais on l’appelait de nouveau ; alors il a poussé sa femme du coude :
— Dis donc, Euphrosine, tu as entendu ?
Leurs deux garçons devaient dormir depuis longtemps ; mais, elle, il a bien vu qu’elle avait dû rester éveillée, bien qu’elle fût sans mouvement à ses côtés ; l’un et l’autre là sans rien dire, tous deux pensant sans doute aux mêmes choses ; parce qu’elle avait répondu tout bas :
— Qu’est-ce que c’est ?
— Denis !
Il n’a pas pu douter cette fois qu’on ne l’appelât ; la voix venait de devant la maison ; elle était à la fois faible et impérieuse, elle n’était qu’un murmure et en même temps comme un cri ; et il s’est assis sur le lit. Il a dit à sa femme : « Toi, tu restes là ! » puis est sorti du lit sans allumer la lampe, passe son pantalon, sa veste, ne faisant aucun bruit, à cause de ses garçons ; et on continuait d’appeler tout bas pendant ce temps : « Hé ! Denis ! hé ! vous entendez, Denis ? » puis il y avait un silence, puis la voix reprenait, et maintenant il lui semblait la reconnaître… Et c’était bien qui il pensait, parce qu’ayant ouvert la porte, il avait reconnu Brigitte.
— Denis, il vous faut vite venir, représentez-vous ; ah ! mon Dieu !
Il dit : « Quoi ? »
— Venez vite, son feu s’est éteint.
— Le feu de qui ?
Brigitte a dit :
— Anzévui…
— Eh bien ?
— Eh bien, dit-elle, il ne l’aurait pas laissé éteindre si… Je le connais, moi. À neuf heures, ça bougeait encore dans ses vitres. Et moi, je me suis endormie. Mais j’ai été réveillée en sursaut un moment après, comme s’il y avait quelqu’un qui me disait qu’il s’était passé quelque chose ; et là-haut ça ne bougeait plus… Denis, il vous faut venir.
— Je veux bien, mais il faudrait être deux ou trois.
— Appelez vos garçons. Il secoua la tête :
— Non, disait-il, pas eux. Mais vous ? Est-ce que vous ne pourriez pas aller chercher quelqu’un pendant que je me prépare ?
Elle était revenue avec Follonnier et Métrailler ; ainsi ils ont été les quatre. De la maison de Revaz on ne pouvait pas voir celle d’Anzévui. Il fallait être arrivé au tournant du chemin pour qu’elle se montrât enfin ; et, ce soir-là, elle ne s’est pas montrée. La lueur qui en marquait la place, et qui était un peu comme quand le garde-voie élève et abaisse son drapeau déteint, avait été roulée et emportée. La neige elle-même était sans couleur ; elle faisait seulement dans le bas de la nuit une vague lueur comme celle qui passe au-dessous d’un rideau qui traîne. C’est cette dernière nuit, ils viennent, ils étaient les quatre, ils étaient finalement arrivés devant la porte d’Anzévui, ils entrent ; et ils avaient été jusqu’alors dans la nuit, mais ils se sont trouvés dans une autre plus grande nuit.
— Charrette ! dit Métrailler, est-ce que j’ai des allumettes ?
— J’en ai, dit Follonnier.
Ils se tenaient sur le pas de la porte. Là, Follonnier frotte une allumette soufrée, puis tend le bras vers l’intérieur de la pièce. Seulement la petite flamme bleue n’avait pas éclairé et la flamme plus vive qui est venue ensuite pas assez :
— Oh ! disait Brigitte, c’est qu’il faudrait pouvoir aller chercher une bougie. Elle doit être sur le manteau de la cheminée, parce qu’il s’éclairait avec son feu et seulement avec son feu.
— J’y vais, dit Follonnier.
Il frotte encore une allumette, puis s’arrête. Le silence qui remplissait la pièce était comme quelque chose qui vous empêchait d’avancer. Brigitte avait fini par aller rejoindre Follonnier. L’allumette s’était éteinte ; ils se cognent à la table, puis voient la table, et Brigitte tout bas a dit : « C’est là. » Elle tenait Follonnier par le pan de sa veste : puis, la bougie ayant été allumée, ils ont été vus tous les deux.
— Qu’est-ce que je vous disais ?
Follonnier, élevant la bougie, s’était tourné vers les deux autres qui étaient restés sur le pas de la porte et qui s’approchent : Brigitte était là, les mains jointes, tournée vers le fauteuil qui se distinguait maintenant.
Elle s’est signée trois fois de suite.
Et, dans le fauteuil, il y avait le père Anzévui, parce qu’il était mort comme quand on s’endort, comme la lampe qui s’éteint faute d’huile, comme la fontaine qui cesse de couler par manque d’eau, comme se tait le son de la cloche quand le battant n’est plus en mouvement. Ses mains s’étaient seulement ouvertes ; le livre avait glissé de ses genoux ; sa tête avait penché de côté ; on ne voyait plus sa figure, mais seulement ses cheveux et sa barbe qui faisaient une tache blanche comme celle qu’il y a dans le haut des montagnes où l’hiver dure tout l’été.
— Bien quoi ?
C’était Follonnier. Il ne pouvait pas rester longtemps sans rien dire.
— Bien quoi ? il était vieux, il avait fait son temps, qu’est-ce que vous voulez ? il ne faisait besoin à personne. Il faut nous y mettre, disait Follonnier, pendant qu’il est chaud. Il a posé la bougie sur la table.
— C’est pas lui seulement, c’est nous, disait Brigitte, c’est nous autres… Oh ! allez doucement, disait-elle, ayant vu Follonnier et Métrailler qui s’approchaient du corps, se préparant à l’emporter ; et le père Revaz, lui, n’avait pas bougé de sa place, mais on voyait sa mâchoire trembler ; allez doucement, s’il vous plaît ; et où est-ce que vous voulez le mettre ?
— Il a bien un lit ? a dit Follonnier.
— Oh ! disait-elle, il n’est pas fait : il n’y couchait plus ces derniers temps ; il avait trop de peine à respirer. Attendez que j’aille faire de l’ordre.
À présent elle s’affairait ; et elle disait : « Éclairez-moi », s’étant dirigée vers l’angle de la pièce où il y avait, en effet, un vieux lit de sapin fait d’un simple cadre de bois avec une paillasse et des couvertures. Le traversin était sans housse, la paillasse sans draps. Mais elle a lissé la paillasse du mieux qu’elle a pu de la main, elle a mis le traversin où il fallait ; et eux, alors, avaient apporté Anzévui, c’est-à-dire Cyprien et Follonnier.
— Il ne pèse pas plus lourd qu’Arlettaz, disait Follonnier, et il se laisse encore mieux faire ; il n’est pas non plus beaucoup mieux logé que lui…
Pendant qu’ils couchaient Anzévui sur sa paillasse ; et Brigitte lui a joint les mains, et on lui a fermé la bouche en lui nouant un mouchoir autour de la tête ; puis Brigitte : « Il faut que j’aille chercher l’eau bénite et mon chapelet » ; alors Revaz lui avait dit :
— Je vais avec vous.
Il n’était pas revenu.
Brigitte, elle, à son retour avait tout disposé autour du mort comme c’est l’habitude jusqu’au moment où ils nous quitteront pour toujours ; elle avait allumé les bougies, mis une nappe propre sur le coin de la table ; elle s’était assise à côté du lit. Elle hochait la tête :
— C’est bien ce qu’il m’avait annoncé, parce qu’il m’avait dit : « Je passerai en même temps que lui. »
— Bah !
— C’est signe qu’il a vu clair, c’est signe qu’il ne s’est pas trompé.
— Il a confondu, disait Follonnier. Il s’est pris pour le soleil.
— Oh ! taisez-vous, disait Brigitte.
À ce moment, Métrailler s’était levé de dessus sa chaise :
— Ah ! tu nous quittes ? disait Follonnier.
— Oui, il faut que j’aille ; je vous enverrai quelqu’un.
— Moi, je reste encore un moment.
— Moi, je vais rester tout le temps, dit Brigitte. Seulement, Cyprien, disait-elle, regardez en passant si ma lampe brûle bien toujours.
Elle, c’est dès cinq heures, cette même nuit, qu’elle s’est réveillée, car, même par temps couvert, il commence à faire clair de bonne heure en avril. Elle bouge un genou, elle bouge l’autre. Elle les bouge juste assez pour qu’Augustin finisse par lui dire : « Qu’est-ce que tu fais ? » mais sans trop se réveiller. « Je sais pas, j’ai soif, je vais boire un verre d’eau à la cuisine. » Elle se glisse hors du lit. Elle n’avait pas allumé la lampe. Ses pieds sont légers et prudents. Elle est sortie de la maison. Elle a été ensuite dans la neige et dans la nuit, mais le chemin n’était pas long, si bien qu’elle a vu bientôt briller les fenêtres de la chambre de Jeanne Emery, qui étaient déjà éclairées. Et, de dessous les fenêtres de Jeanne Emery, elle n’a eu qu’à dire : « Jeanne, c’est moi. »
— Quelle heure est-il ? ils vont venir, disait Isabelle.
— Oh ! dit Jeanne, on a le temps.
— Tu es prête ?
— Je suis prête.
— Et mon costume ?
— Le voilà.
Sur le lit étaient étalés l’un à côté de l’autre la jupe et le corsage d’Isabelle : « Seulement, disait Jeanne Emery, j’ai peur que tu n’aies pas assez chaud, parce que c’est léger. »
— Oh ! disait Isabelle, j’ai mon châle.
Puis s’est mise devant le miroir, puis Jeanne a approché au bout de son fil l’ampoule électrique qu’elle a accrochée à un clou :
— C’est que j’ai manqué d’étoffe, disait Jeanne.
— Ça ne fait rien, j’ai mes colliers.
Elle levait les bras en riant devant le miroir. Son rire était comme de l’eau qui coule, ses dents comme les petites pierres blanches qu’on voit bouger au fond de l’eau.
— Ça me serre !
— Attends, disait Jeanne Emery.
Jeanne Emery tirait des deux mains sur le caraco :
— Il n’est pas en place et puis tu es ronde. Oh ! disait-elle, on va te voir par devant jusqu’au bas du cou.
— Ça ne fait rien, c’est le printemps. Où est-ce que tu as mis mon collier ? et où as-tu mis mes boucles d’oreilles ?
Le collier a été comme une entaille rouge à son cou brun, il y a eu comme deux gouttes de sang qui ont perlé à ses oreilles. Puis, inclinant le miroir, elle s’y est regardée des pieds à la tête ; elle avait les pieds petits dans ses gros souliers à clous. Elle se regarde encore ; elle a le mollet rond sous ses épais bas de laine, la taille fine, la nuque pleine.
— Dis donc, Jeanne, tu crois que ça va ?
Et Jeanne Emery :
— Je crois que ça va.
Alors Isabelle a pris son châle et se l’est noué autour de la poitrine ; a attaché sous son menton un fichu noir à petits bouquets de toutes couleurs :
— Ça y est !
Au même moment on a entendu la voix de Jean sous les fenêtres :
— Êtes-vous là ?
Isabelle lui a dit :
— As-tu ton cornet ?
Il l’a tiré de dessous sa veste.
Ensuite Métrailler et Tissières étaient parus ; Isabelle a dit à Métrailler :
— Et vous, avez-vous votre fusil ?
Mais on avait déjà vu le canon qui dépassait par-dessus son épaule.
— Et des cartouches, Métrailler ?
Il a fouillé dans sa poche : il en avait plein la main ; c’étaient des cartouches à balles comme celles dont on se sert pour aller chasser le chamois.
— J’en ai, vous voyez, et plus qu’il n’en faut. Parce qu’il faudra tirer combien de fois ?…
— Treize fois de suite.
— Pourquoi treize ?
— Parce que c’est le treize du mois.
À ce moment, ils avaient eu une surprise, car il n’y a pas eu que Lucien Revaz, le cadet, qui s’est présenté, mais aussi Julien qu’on n’attendait pas :
— Tiens, vous venez ?
— Tiens, tu viens, toi aussi ?
— Oui, disait Julien, parce que je suis pressé, moi aussi, de le voir et je m’en ennuie.
- Et cependant Métrailler avait dit :
— Vous savez qu’Anzévui est mort.
— Eh bien, voilà, ça y est, c’est fini ! disait Isabelle, tout commence ou tout recommence. Allez devant, Métrailler, c’est vous qui nous montrerez le chemin, et puis toi, Jean, tu vas ensuite.
Elle avait ouvert la porte et Métrailler :
— Oui, seulement il y en a d’autres qui prétendent que c’est la fin pour tout le monde du moment, qu’Anzévui est mort.
Mais Isabelle avait fait entendre son rire, et il a été de nouveau comme le chant du merle avant le temps.
Ils se sont tus d’abord parce qu’ils avaient à longer une partie de la rue qui traverse le village. Ils marchaient deux par deux, Métrailler en tête ; Jean était à côté d’Isabelle et elle lui avait pris la main. Du côté du levant, dans le bout du village, la lampe de Brigitte éclairait doucement derrière les carreaux. Et ils ont vu ensuite qu’il y avait, cette nuit-là, une autre fenêtre éclairée et beaucoup plus qu’à l’ordinaire, d’une lumière moins incertaine, et moins variable, et plus fixe : c’étaient les bougies qui brûlaient sur le coin de la table dans la cuisine d’Anzévui.
Ils avaient donc passé en silence près de la maison d’Anzévui ; ils avaient commencé à monter. La neige était gelée, parce qu’il n’avait pas cessé de geler la nuit. Mais, le jour, elle avait commencé à fondre d’en dessous, de sorte que son épaisseur était déjà diminuée. Métrailler marchait en tête, et la piste qu’il ouvrait était reprise par Tissières, puis par les autres, et élargie ; pendant qu’au-dessous d’eux le village continuait à dormir sous beaucoup de petits toits à peine aperçus, à peine dessinés sur leurs bords par un trait bleu. Aucun changement n’était encore visible autour d’eux, ni à leurs pieds ; il a fallu qu’ils se fussent élevés davantage pour que la neige prît enfin une apparence de couleur. Était-ce bien, d’ailleurs, une couleur ? On vit quelque chose de pâle naître peu à peu au-dessous de soi, sans dessin, ni contours, mais une vague clarté s’en dégageait quand même : c’est d’en bas que naissait le jour, et eux ils ont été portés par lui dans l’air encore occupé par la nuit. Est-ce qu’il faut que tu souffles dans ton cornet, Jean ? Oh ! pas encore. Car il y avait au-dessus d’eux la crête dont ils n’étaient pas loin, mais qu’ils avaient à atteindre d’abord, parce qu’on domine de là les deux versants, on est au point de rencontre des deux pentes de la montagne ; on peut se pencher d’un côté, on peut se pencher de l’autre, ayant un pays tout entier, puis un autre pays tout entier au-dessous de soi.
Et alors est-ce que tu vas pouvoir souffler dans ton cornet ?
Ils étaient les sept, ils sont arrivés sur l’arête. La neige en avait été balayée par les vents. C’est qu’ici ils ne sont contenus par rien, qu’ils soufflent du nord ou du sud. Eux, se sont trouvés faire face à ce dos où les blocs, posés à la suite l’un de l’autre, ont eu soudain une couleur et une forme ; ils sont devenus gris et on voit qu’ils sont gris ; ils ne sont pas seulement gris, mais veinés et on voit leurs veines, et tachés et on voit leurs taches. Dans les vides qu’ils laissaient entre eux un peu de neige était restée, on voyait la neige ; ailleurs on voyait la terre et il y avait dessus un peu de gazon jauni. Du jaune, du blanc, du gris, du brun. C’est alors qu’Isabelle avait tendu le bras :
— Regardez là-bas ; qu’est-ce que j’ai dit ?
Ils s’étaient arrêtés. On la voyait maintenant, elle ; elle aussi, elle les voyait. On voyait la couleur de leurs visages, on voyait la couleur de leurs vêtements : les guêtres de Métrailler, les jambières de Tissières, la moustache de Julien Revaz ; et, elle, ses joues brunes qui étaient dans leur milieu comme la pêche quand elle mûrit :
— Ça va être le beau temps. Souffle dans ton cornet, Jean, qu’ils nous entendent du village. Souffle comme à la caserne. Dis-leur : « Debout, les vieux, c’est le moment. »
Jean a soufflé dans son cornet. Alors on a vu le village renaître peu à peu à lui-même. De là-haut, ils l’ont vu ressusciter à la lumière, ayant baissé la tête en même temps que Jean tournait vers lui l’embouchure de son instrument. L’air avait été nettoyé entre eux et lui, l’air était devenu tout à fait transparent ; et là au fond, les toits s’apercevaient parfaitement, étroitement serrés l’un contre l’autre, faisant des carrés un peu bleus et qui penchaient dans des sens différents. Le cornet de Jean les désignait : et, au-dessus du bleu des toits, un autre bleu plus pâle s’était mis alors à bouger, ayant un mouvement comme celui des vagues que le vent doucement balance sur le lac par les beaux jours. Ils venaient, là en bas, d’allumer le feu dans les cuisines. Les femmes étaient devant leur fourneau ou bien penchées sur le foyer ; elles ont dit : « Qu’est-ce qu’on entend ? »
Elles lèvent la tête, elles se disent : « Qu’est-ce qu’on entend ? mais c’est le cornet du berger des chèvres » ; puis, se tournant vers la fenêtre : « Tiens ! il va faire beau aujourd’hui. »
« Oh ! mon petit, qu’est-ce qu’il y a ? » Justine Émonet avait pris son enfant contre elle, l’ayant soulevé droit en l’air ; elle avait appliqué sa tête contre sa tête et, joue à joue, elle lui parlait ; mais, lui, continuant d’ouvrir une grande bouche sans dents dans une figure toute rouge et où les yeux étaient disparus dans les plis de la peau que les cris faisaient remonter, tout à coup il perdait le souffle, et il y avait un long silence, d’où il ne sortait plus que par une espèce de déchirement.
— Oh ! mon petit, mon petit, qu’est-ce qu’il y a ? Où as-tu mal ? est-ce que vraiment tout est fini ?
Mais alors le grand jour est entré par la fenêtre ; elle s’en approche, elle se met dedans ; puis tourne l’enfant en pleine lumière :
— Oh ! se disait-elle, il n’a plus d’yeux tant il pleure, mais il est rouge, il est beau rouge. Il ne serait pas si rouge s’il n’était pas en bonne santé. Est-ce que ce serait peut-être seulement qu’il a faim ?
Elle s’est assise près de la fenêtre, elle a ouvert son caraco. Et, tout à coup, les cris se taisent. Elle a pris le bout de son sein entre ses doigts, elle se penche en avant ; la petite tête à fin duvet d’oiseau s’est alors tournée de côté. Et il s’est fait un petit bruit, à cause de quelque chose qui va de moi à lui, à cause d’une circulation. De sorte qu’elle ne bougeait plus ; elle levait seulement les yeux, non pas la tête ; et un sourire était sur sa figure penchée comme une seconde lumière, cependant qu’elle regardait par les petits carreaux la neige qui devenait rose, comme si les œillets de son jardin fleurissaient tous en même temps.
Jean Antide, là-haut, souffle dans son cornet ; voilà la mère Revaz qui appelle son mari : « Denis, Denis, viens voir, tu t’es trompé… Le temps s’éclaire… Sûrement qu’on va voir le soleil aujourd’hui » ; et Jean Antide, là-haut : « Ça y est », et il remet le cornet sous sa veste, parce qu’Isabelle lui a dit :
— Ça suffit pour le moment.
Puis a dit à Métrailler : « Il nous faut suivre la crête jusqu’en Sézymes ; on peut ? dites-donc, Métrailler. »
— Bien sûr qu’on peut, puisqu’il fait beau.
Ils ont marché sur ce dos de pierre qui était ensuite un dos de terre ; ils marchent, tantôt sur le roc où les clous grincent comme les dents contre un os, tantôt sur une épaisseur d’herbe pareille sous les pieds à un tapis de feutre. Ils sont parvenus ensuite à un élargissement où poussaient quelques mélèzes déjetés qui avaient l’air de fumées grises poussées de côté par le vent ; mais à travers ces fumées tout à coup qu’est-ce qu’on voit là-bas, sur notre gauche ?
— Jean, souffle dans ton cornet.
Il a soufflé dans son cornet et Métrailler continuait à tendre la main à Isabelle ; aux places difficiles, Métrailler qui était plus haut qu’elle la tirait par devant, Jean la poussait par derrière :
— Eh ! Jean, tu vois, souffle de nouveau.
Le cornet s’est mis à briller.
Et elle disait :
— J’ai trop chaud.
Ils s’étaient arrêtés de nouveau sur une pointe ; on commençait à voir la terre dans toute son étendue, le ciel au-dessus d’eux commençait à se dévoiler ; elle disait : « J’ai trop chaud » ; elle a ôté son fichu de tête.
Brune et rose, on voyait son cou, on voyait ses boucles d’oreilles, on voyait ses cheveux où un peu de neige qui avait fondu faisait des gouttelettes et elles ont été comme quand la rosée, à la pointe de l’herbe, brille dans le jour.
— Ah ! dit-elle ; mais on va y être, ou quoi ? et sa poitrine se gonflait sous son châle.
— On y est presque, disait Métrailler ; il n’y a plus qu’une dernière tirée. On sera juste là-haut au bon moment ; eh ! la dorée…
Regardant Isabelle :
— Et, vous deux, les dorés, disait-il en regardant Jean : et il y a nous autres, les brûlés, n’est-ce pas, Tissières ? Eh bien, c’est nous qu’on tire ; vous, vous n’avez qu’à vous laisser tirer.
Les nuages, à l’horizon, se rassemblaient en flocons comme fait le lait quand il caille ; les flocons étaient gris, ils sont devenus roses, ils se sont disposés en lignes régulières et tremblées comme celles que fait l’eau dans le sable au bord de la mer. Et c’est à gauche que ça a commencé. Une première pointe y a paru, comme une bougie avec sa flamme. Eux, ils étaient encore dans l’ombre, mais là-bas, du côté du levant, tous ces feux l’un après l’autre s’étaient maintenant allumés. Et pas seulement les imaginés, pas seulement ceux qu’on s’invente à soi-même, pas seulement ceux qu’on se représente en fermant les yeux, comme avant ; – mais les réels, les véritables, ceux qui se voient, qui pourraient se toucher, qui sont là, qui vous tirent le regard dehors, qui vous arrachent à vous-même. Les vapeurs se roulaient en boules qui étaient posées les unes à côté des autres comme des ballons prêts à partir, sur quelque étage plat de la montagne ; et tous ces globes et ballons, l’un après l’autre, ont été lâchés, découvrant derrière eux mille pointes qui s’aperçoivent, avec leurs robes éclatantes, agenouillées dans le matin.
— Souffle, Jean : ou bien si tu n’as plus de souffle…
Il souffle encore ; il n’y avait plus devant eux qu’un dernier escarpement qu’ils surmontent ; alors, au-dessus des montagnes, le ciel s’est doré tout à coup, devenu pareil avec ses rayons à un grand éventail qui s’ouvre. Isabelle a dit à Métrailler :
— Préparez-vous !
— Oh ! ça n’y est pas encore tout à fait.
Alors elle a dit :
— J’ai trop chaud.
C’est que l’air était de plus en plus tiède, c’était aussi le mouvement qu’on s’est donné.
— Tu vois, disait Lucien Revaz à son frère, si tu as bien fait de venir !
Tandis qu’elle, elle ôte son châle, et on a vu le collier rouge dans le bas de son cou nu.
— Oh ! disait Jeanne Emery, tu vois bien, ton caraco, il est trop court !
— Tant pis, et puis à Jean : « Et toi, trouves-tu ? » et rit et a fait bouger sous l’étoffe mince ses belles épaules.
— Il vient ?
— Pas tout à fait encore.
— Dommage, a-t-elle dit, dommage qu’on ne puisse pas descendre ensuite à notre mayen. Il est juste là-dessous.
— Je sais bien, disait Métrailler, mais il y a trop de neige et elle va se mettre à fondre.
— Dommage ! on pourrait y danser. Jean, est-ce que tu as ta musique à bouche ? Eh bien, garde-la dans ta poche, et on ira y faire les foins ensemble ; ce sera bientôt, disait-elle ; le temps va vite, qu’en dis-tu, Jean ? Puis :
— Métrailler, vous êtes prêt ?
Elle était en avant de nous, elle nous tournait le dos ; on voyait ses tresses pendre sur sa nuque comme une grappe de raisins noirs. Et le duvet qui était sur ses joues s’est illuminé tout à coup, en même temps que la ligne de son cou et le contour de ses épaules ont été marqués par un trait de feu.
Métrailler lève son fusil en l’air.
Un, deux, trois, quatre, voilà qu’ils comptaient les coups au village. Ils disaient : « Où est-ce qu’on tire ? » Ils ont compté jusqu’à treize coups. Et ni Brigitte, ni une autre vieille, qui veillaient Anzévui, n’avaient encore bougé ; mais alors on a entendu une mouche qui s’était réveillée se mettre à bourdonner quelque part dans la pièce.
— Eh ! a dit la vieille, dites donc, hein ? il semble bien qu’il se soit trompé…
Brigitte n’a rien répondu, mais elle s’était levée ; elle avait été prendre un linge, elle l’a étendu sur la figure du mort.
►◄
1 – Petit canal (parfois en bois) courant à flanc de coteaux destiné à assurer l’irrigation des villages ou des prairies pour faire pousser le fourrage nécessaire à l’élevage. Certains de ces ouvrages sont étonnants et franchissent des parois à pic ou s’accrochent à elles. Aujourd’hui de très nombreux bisses ont disparu. (BNR.)
2 – Le Valais est francophone, en aval du Rhône, jusqu’au lac Léman et germanophone à partir de Sierre – et donc Brigue – en remontant vers les sources du Rhône. (BNR.)
◄►
Ce livre numérique a été édité par la bibliothèque numérique romande https://ebooks-bnr.com/ en février 2018. — Élaboration : Ont participé à l’élaboration de ce livre numérique : pour les ELG : Jean-Marc, MichelB, Coolmicro ; pour la BNR : Sylvie, Françoise. — Sources : Ce livre numérique est réalisé à partir de la numérisation du Groupe des ebooks libres et gratuits que nous avons corrigée et adaptée en fonction de notre édition de référence, Œuvres complètes 18 Le Garçon savoyard Si le soleil ne revenait pas, Lausanne, Mermod. 1941. La photo de première page, Le cirque de Creux de Champ le matin, a été prise par Laura Barr-Wells le 14.02.2012. — Dispositions : Ce livre numérique – basé sur un texte libre de droit – est à votre disposition. Vous pouvez l’utiliser librement, sans le modifier, mais vous ne pouvez en utiliser la partie d’édition spécifique (notes de la BNR, présentation éditeur, photos et maquettes, etc.) à des fins commerciales et professionnelles sans l’autorisation de la Bibliothèque numérique romande. Merci d’en indiquer la source en cas de reproduction. Tout lien vers notre site est bienvenu… – 192 – — Qualité : Nous sommes des bénévoles, passionnés de littérature. Nous faisons de notre mieux mais cette édition peut toutefois être entachée d’erreurs et l’intégrité parfaite du texte par rapport à l’original n’est pas garantie. Nos moyens sont limités et votre aide nous est indispensable ! Aidez-nous à réaliser ces livres et à les faire connaître… — Autres sites de livres numériques : Plusieurs sites partagent un catalogue commun qui répertorie un ensemble d’ebooks et en donne le lien d’accès. Vous pouvez consulter ce catalogue à l’adresse : www.noslivres.net.