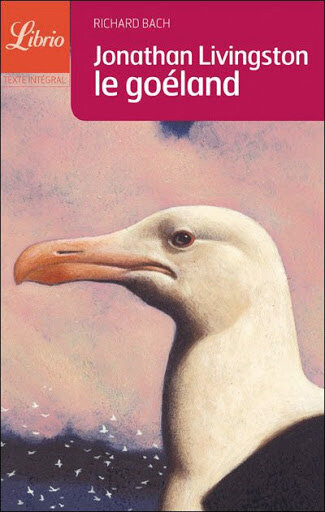La maison Tellier, Guy de Maupassant (texte intégral)

Bains à la Grenouillère, Claude Monet
Remerciements à :
https://beq.ebooksgratuits.com/vents/Maupassant.htm
Édition de référence : Paris, Paul Ollendorff, Éditeur, 1891.
◄►
À Ivan Tourgueneff
Hommage d’une affection profonde et d’une grande admiration
Guy de Maupassant
GUY DE MAUPASSANT
La maison Tellier
I
On allait là, chaque soir, vers onze heures, comme au café, simplement.
Ils s’y retrouvaient à six ou huit, toujours les mêmes, non pas des noceurs, mais des hommes honorables, des commerçants, des jeunes gens de la ville ; et l’on prenait sa chartreuse en lutinant quelque peu les filles, ou bien on causait sérieusement avec Madame, que tout le monde respectait.
Puis on rentrait se coucher avant minuit. Les jeunes gens quelquefois restaient.
La maison était familiale, toute petite, peinte en jaune, à l’encoignure d’une rue derrière l’église Saint-Étienne ; et, par les fenêtres, on apercevait le bassin plein de navires qu’on déchargeait, le grand marais salant appelé « la Retenue » et, derrière, la côte de la Vierge avec sa vieille chapelle toute grise.
Madame, issue d’une bonne famille de paysans du département de l’Eure, avait accepté cette profession absolument comme elle serait devenue modiste ou lingère. Le préjugé du déshonneur attaché à la prostitution, si violent et si vivace dans les villes, n’existe pas dans la campagne normande. Le paysan dit : – « C’est un bon métier » ; – et il envoie son enfant tenir un harem de filles comme il l’enverrait diriger un pensionnat de demoiselles.
Cette maison, du reste, était venue par héritage d’un vieil oncle qui la possédait. Monsieur et Madame, autrefois aubergistes près d’Yvetot, avaient immédiatement liquidé, jugeant l’affaire de Fécamp plus avantageuse pour eux ; et ils étaient arrivés un beau matin prendre la direction de l’entreprise qui périclitait en l’absence des patrons.
C’étaient de braves gens qui se firent aimer tout de suite par leur personnel et des voisins.
Monsieur mourut d’un coup de sang deux ans plus tard. Sa nouvelle profession l’entretenant dans la mollesse et l’immobilité, il était devenu très gros, et sa santé l’avait étouffé.
Madame, depuis son veuvage, était vainement désirée par tous les habitués de l’établissement ; mais on la disait absolument sage, et les pensionnaires elles-mêmes n’étaient parvenues à rien découvrir.
Elle était grande, charnue, avenante. Son teint, pâli dans l’obscurité de ce logis toujours clos, luisait comme sous un vernis gras. Une mince garniture de cheveux follets, faux et frisés, entourait son front, et lui donnait un aspect juvénile qui jurait avec la maturité de ses formes. Invariablement gaie et la figure ouverte, elle plaisantait volontiers, avec une nuance de retenue que ses occupations nouvelles n’avaient pas encore pu lui faire perdre. Les gros mots la choquaient toujours un peu ; et quand un garçon mal élevé appelait de son nom propre l’établissement qu’elle dirigeait, elle se fâchait, révoltée. Enfin elle avait l’âme délicate, et, bien que traitant ses femmes en amies, elle répétait volontiers qu’elles « n’étaient point du même panier ».
Parfois, durant la semaine, elle partait en voiture de louage avec une fraction de sa troupe ; et l’on allait folâtrer sur l’herbe au bord de la petite rivière qui coule dans les fonds de Valmont. C’étaient alors des parties de pensionnaires échappées, des courses folles, des jeux enfantins, toute une joie de recluses grisées par le grand air. On mangeait de la charcuterie sur le gazon en buvant du cidre, et l’on rentrait à la nuit tombante avec une fatigue délicieuse, un attendrissement doux ; et dans la voiture on embrassait Madame comme une mère très bonne, pleine de mansuétude et de complaisance.
La maison avait deux entrées. À l’encoignure, une sorte de café borgne s’ouvrait, le soir, aux gens du peuple et aux matelots. Deux des personnes chargées du commerce spécial du lieu étaient particulièrement destinées aux besoins de cette partie de la clientèle. Elles servaient, avec l’aide du garçon, nommé Frédéric, un petit blond imberbe et fort comme un bœuf, les chopines de vin et les canettes sur les tables de marbre branlantes, et, les bras jetés au cou des buveurs, assises en travers de leurs jambes, elles poussaient à la consommation.
Les trois autres dames (elles n’étaient que cinq) formaient une sorte d’aristocratie, et demeuraient réservées à la compagnie du premier, à moins pourtant qu’on n’eût besoin d’elles en bas et que le premier fût vide.
Le salon de Jupiter, où se réunissaient les bourgeois de l’endroit, était tapissé de papier bleu et agrémenté d’un grand dessin représentant Léda étendue sous un cygne. On parvenait dans ce lieu au moyen d’un escalier tournant terminé par une porte étroite, humble d’apparence, donnant sur la rue, et au-dessus de laquelle brillait toute la nuit, derrière un treillage, une petite lanterne comme celles qu’on allume encore en certaines villes aux pieds des madones encastrées dans les murs.
Le bâtiment, humide et vieux, sentait légèrement le moisi. Par moments, un souffle d’eau de Cologne passait dans les couloirs, ou bien une porte entrouverte en bas faisait éclater dans toute la demeure, comme une explosion de tonnerre, les cris populaciers des hommes attablés au rez-de-chaussée, et mettait sur la figure des messieurs du premier une moue inquiète et dégoûtée. Madame, familière avec les clients ses amis, ne quittait point le salon, et s’intéressait aux rumeurs de la ville qui lui parvenaient par eux. Sa conversation grave faisait diversion aux propos sans suite des trois femmes ; elle était comme un repos dans le badinage polisson des particuliers ventrus qui se livraient chaque soir à cette débauche honnête et médiocre de boire un verre de liqueur en compagnie de filles publiques.
Les trois dames du premier s’appelaient Fernande, Raphaële et Rosa la Rosse.
Le personnel étant restreint, on avait tâché que chacune d’elles fût comme un échantillon, un résumé de type féminin, afin que tout consommateur pût trouver là, à peu près du moins, la réalisation de son idéal.
Fernande représentait la belle blonde, très grande, presque obèse, molle, fille des champs dont les taches de rousseur se refusaient à disparaître, et dont la chevelure filasse, écourtée, claire et sans couleur, pareille à du chanvre peigné, lui couvrait insuffisamment le crâne.
Raphaële, une Marseillaise, roulure des ports de mer, jouait le rôle indispensable de la belle Juive, maigre, avec des pommettes saillantes plâtrées de rouge. Ses cheveux noirs, lustrés à la moelle de bœuf, formaient des crochets sur ses tempes. Ses yeux eussent paru beaux si le droit n’avait pas été marqué d’une raie. Son nez arqué tombait sur une mâchoire accentuée où deux dents neuves, en haut, faisaient tache à côté de celles du bas qui avaient pris en vieillissant une teinte foncée comme les bois anciens.
Rosa la Rosse, une petite boule de chair tout en ventre avec des jambes minuscules, chantait du matin au soir, d’une voix éraillée, des couplets alternativement grivois ou sentimentaux, racontait des histoires interminables et insignifiantes, ne cessait de parler que pour manger et de manger que pour parler, remuait toujours, souple comme un écureuil malgré sa graisse et l’exiguïté de ses pattes ; et son rire, une cascade de cris aigus, éclatait sans cesse, de-ci, de-là, dans une chambre, au grenier, dans le café, partout, à propos de rien.
Les deux femmes du rez-de-chaussée, Louise, surnommée Cocote, et Flora, dite Balançoire parce qu’elle boitait un peu, l’une toujours en Liberté avec une ceinture tricolore, l’autre en Espagnole de fantaisie avec des sequins de cuivre qui dansaient dans ses cheveux carotte à chacun de ses pas inégaux, avaient l’air de filles de cuisine habillées pour un carnaval. Pareilles à toutes les femmes du peuple, ni plus laides, ni plus belles, vraies servantes d’auberge, on les désignait dans le port sous le sobriquet des deux Pompes.
Une paix jalouse, mais rarement troublée, régnait entre ces cinq femmes, grâce à la sagesse conciliante de Madame et à son intarissable bonne humeur.
L’établissement, unique dans la petite ville, était assidûment fréquenté. Madame avait su lui donner une tenue si comme il faut ; elle se montrait si aimable, si prévenante envers tout le monde ; son bon cœur était si connu, qu’une sorte de considération l’entourait. Les habitués faisaient des frais pour elle, triomphaient quand elle leur témoignait une amitié plus marquée ; et lorsqu’ils se rencontraient dans le jour pour leurs affaires, ils se disaient : « À ce soir, où vous savez », comme on se dit : « Au café, n’est-ce pas ? après dîner. »
Enfin la maison Tellier était une ressource, et rarement quelqu’un manquait au rendez-vous quotidien.
Or, un soir, vers la fin du mois de mai, le premier arrivé, M. Poulin, marchand de bois et ancien maire, trouva la porte close. La petite lanterne, derrière son treillage, ne brillait point ; aucun bruit ne sortait du logis, qui semblait mort. Il frappa, doucement d’abord, avec plus de force ensuite ; personne ne répondit. Alors il remonta la rue à petits pas, et, comme il arrivait sur la place du Marché, il rencontra M. Duvert, l’armateur, qui se rendait au même endroit. Ils y retournèrent ensemble sans plus de succès. Mais un grand bruit éclata soudain tout près d’eux, et, ayant tourné la maison, ils aperçurent un rassemblement de matelots anglais et français qui heurtaient à coups de poings les volets fermés du café.
Les deux bourgeois aussitôt s’enfuirent pour n’être pas compromis, mais un léger « pss’t » les arrêta : c’était M. Tournevau, le saleur de poisson, qui, les ayant reconnus, les hélait. Ils lui dirent la chose, dont il fut d’autant plus affecté que lui, marié, père de famille et fort surveillé, ne venait là que le samedi, « securitatis causa », disait-il, faisant allusion à une mesure de police sanitaire dont le docteur Borde, son ami, lui avait révélé les périodiques retours. C’était justement son soir et il allait se trouver ainsi privé pour toute la semaine.
Les trois hommes firent un grand crochet jusqu’au quai, trouvèrent en route le jeune M. Philippe, fils du banquier, un habitué, et M. Pimpesse, le percepteur. Tous ensemble revinrent alors par la rue « aux Juifs » pour essayer une dernière tentative. Mais les matelots exaspérés faisaient le siège de la maison, jetaient des pierres, hurlaient ; et les cinq clients du premier étage, rebroussant chemin le plus vite possible, se mirent à errer par les rues.
Ils rencontrèrent encore M. Dupuis, l’agent d’assurances, puis M. Vasse, le juge au tribunal de commerce ; et une longue promenade commença qui les conduisit à la jetée d’abord. Ils s’assirent en ligne sur le parapet de granit et regardèrent moutonner les flots. L’écume, sur la crête des vagues, faisait dans l’ombre des blancheurs lumineuses, éteintes presque aussitôt qu’apparues, et le bruit monotone de la mer brisant contre les rochers se prolongeait dans la nuit tout le long de la falaise. Lorsque les tristes promeneurs furent restés là quelque temps, M. Tournevau déclara : – « Ça n’est pas gai. – Non certes », reprit M. Pimpesse ; et ils repartirent à petits pas.
Après avoir longé la rue que domine la côte et qu’on appelle : « Sous-le-Bois », ils revinrent par le pont de planches sur la Retenue, passèrent près du chemin de fer et débouchèrent de nouveau place du Marché, où une querelle commença tout à coup entre le percepteur, M. Pimpesse, et le saleur, M. Tournevau, à propos d’un champignon comestible que l’un d’eux affirmait avoir trouvé dans les environs.
Les esprits étant aigris par l’ennui, on en serait peut-être venu aux voies de fait si les autres ne s’étaient interposés. M. Pimpesse, furieux, se retira ; et aussitôt une nouvelle altercation s’éleva entre l’ancien maire, M. Poulin, et l’agent d’assurances, M. Dupuis, au sujet des appointements du percepteur et des bénéfices qu’il pouvait se créer. Les propos injurieux pleuvaient des deux côtés, quand une tempête de cris formidables se déchaîna, et la troupe des matelots, fatigués d’attendre en vain devant une maison fermée, déboucha sur la place. Ils se tenaient par le bras, deux par deux, formant une longue procession, et ils vociféraient furieusement. Le groupe des bourgeois se dissimula sous une porte, et la horde hurlante disparut dans la direction de l’abbaye. Longtemps encore on entendit la clameur diminuant comme un orage qui s’éloigne ; et le silence se rétablit.
M. Poulin et M. Dupuis, enragés l’un contre l’autre, partirent, chacun de son côté, sans se saluer. Les quatre autres se remirent en marche, et redescendirent instinctivement vers l’établissement Tellier. Il était toujours clos, muet, impénétrable. Un ivrogne, tranquille et obstiné, tapait des petits coups dans la devanture du café, puis s’arrêtait pour appeler à mi-voix le garçon Frédéric. Voyant qu’on ne lui répondait point, il prit le parti de s’asseoir sur la marche de la porte, et d’attendre les événements.
Les bourgeois allaient se retirer quand la bande tumultueuse des hommes du port reparut au bout de la rue. Les matelots français braillaient la Marseillaise, les anglais le Rule Britania. Il y eut un ruement général contre les murs, puis le flot de brutes reprit son cours vers le quai, où une bataille éclata entre les marins des deux nations. Dans la rixe, un Anglais eut le bras cassé, et un Français le nez fendu.
L’ivrogne, qui était resté devant la porte, pleurait maintenant comme pleurent les pochards ou les enfants contrariés.
Les bourgeois, enfin, se dispersèrent.
Peu à peu le calme revint sur la cité troublée. De place en place, encore par instants, un bruit de voix s’élevait, puis s’éteignait dans le lointain.
Seul, un homme errait toujours, M. Tournevau, le saleur, désolé d’attendre au prochain samedi ; et il espérait on ne sait quel hasard, ne comprenant pas, s’exaspérant que la police laissât fermer ainsi un établissement d’utilité publique qu’elle surveille et tient sous sa garde.
Il y retourna, flairant les murs, cherchant la raison ; et il s’aperçut que sur l’auvent une pancarte était collée. Il alluma bien vite une allumette-bougie, et lut ces mots tracés d’une grande écriture inégale : « Fermé pour cause de première communion. »
Alors il s’éloigna, comprenant bien que c’était fini. L’ivrogne maintenant dormait, étendu tout de son long en travers de la porte inhospitalière.
Et le lendemain, tous les habitués, l’un après l’autre, trouvèrent moyen de passer dans la rue avec des papiers sous le bras pour se donner une contenance ; et d’un coup d’œil furtif, chacun lisait l’avertissement mystérieux : « Fermé pour cause de première communion. »
II
C’est que Madame avait un frère établi menuisier en leur pays natal, Virville, dans l’Eure. Du temps que Madame était encore aubergiste à Yvetot, elle avait tenu sur les fonts baptismaux la fille de ce frère qu’elle nomma Constance, Constance Rivet ; étant elle-même une Rivet par son père. Le menuisier, qui savait sa sœur en bonne position, ne la perdait pas de vue, bien qu’ils ne se rencontrassent pas souvent, retenus tous les deux par leurs occupations et habitant du reste loin l’un de l’autre. Mais comme la fillette allait avoir douze ans, et faisait, cette année-là, sa première communion, il saisit cette occasion d’un rapprochement, et il écrivit à sa sœur qu’il comptait sur elle pour la cérémonie. Les vieux parents étaient morts, elle ne pouvait refuser à sa filleule ; elle accepta. Son frère, qui s’appelait Joseph, espérait qu’à force de prévenances il arriverait peut-être à obtenir qu’on fît un testament en faveur de la petite, Madame étant sans enfants.
La profession de sa sœur ne gênait nullement ses scrupules, et, du reste, personne dans le pays ne savait rien. On disait seulement en parlant d’elle : « Madame Tellier est une bourgeoise de Fécamp », ce qui laissait supposer qu’elle pouvait vivre de ses rentes. De Fécamp à Virville on comptait au moins vingt lieues ; et vingt lieues de terre pour des paysans sont plus difficiles à franchir que l’Océan pour un civilisé. Les gens de Virville n’avaient jamais dépassé Rouen ; rien n’attirait ceux de Fécamp dans un petit village de cinq cents feux, perdu au milieu des plaines et faisant partie d’un autre département. Enfin on ne savait rien.
Mais, l’époque de la communion approchant, Madame éprouva un grand embarras. Elle n’avait point de sous-maîtresse, et ne se souciait nullement de laisser sa maison, même pendant un jour. Toutes les rivalités entre les dames d’en haut et celles d’en bas éclateraient infailliblement ; puis Frédéric se griserait sans doute, et quand il était gris, il assommait les gens pour un oui ou pour un non. Enfin elle se décida à emmener tout son monde, sauf le garçon à qui elle donna sa liberté jusqu’au surlendemain.
Le frère consulté ne fit aucune opposition, et se chargea de loger la compagnie entière pour une nuit. Donc, le samedi matin, le train express de huit heures emportait Madame et ses compagnes dans un wagon de seconde classe.
Jusqu’à Beuzeville elles furent seules et jacassèrent comme des pies. Mais à cette gare un couple monta. L’homme, vieux paysan, vêtu d’une blouse bleue, avec un col plissé, des manches larges serrées aux poignets et ornées d’une petite broderie blanche, couvert d’un antique chapeau de forme haute dont le poil roussi semblait hérissé, tenait d’une main un immense parapluie vert, et de l’autre un vaste panier qui laissait passer les têtes effarées de trois canards. La femme, raide en sa toilette rustique, avait une physionomie de poule avec un nez pointu comme un bec. Elle s’assit en face de son homme et demeura sans bouger, saisie de se trouver au milieu d’une si belle société.
Et c’était, en effet, dans le wagon, un éblouissement de couleurs éclatantes. Madame, tout en bleu, en soie bleue des pieds à la tête, portait là-dessus un châle de faux cachemire français, rouge, aveuglant, fulgurant. Fernande soufflait dans une robe écossaise dont le corsage, lacé à toute force par ses compagnes, soulevait sa croulante poitrine en un double dôme toujours agité qui semblait liquide sous l’étoffe.
Raphaële, avec une coiffure emplumée simulant un nid plein d’oiseaux, portait une toilette lilas, pailletée d’or, quelque chose d’oriental qui seyait à sa physionomie de Juive. Rosa la Rosse, en jupe rose à larges volants, avait l’air d’une enfant trop grasse, d’une naine obèse ; et les deux Pompes semblaient s’être taillé des accoutrements étranges au milieu de vieux rideaux de fenêtre, ces vieux rideaux à ramages datant de la Restauration.
Sitôt qu’elles ne furent plus seules dans le compartiment, ces dames prirent une contenance grave, et se mirent à parler de choses relevées pour donner une bonne opinion d’elles. Mais à Bolbec apparut un monsieur à favoris blonds, avec des bagues et une chaîne en or, qui mit dans le filet sur sa tête plusieurs paquets enveloppés de toile cirée. Il avait un air farceur et bon enfant. Il salua, sourit et demanda avec aisance : « Ces dames changent de garnison ? » Cette question jeta dans le groupe une confusion embarrassée. Madame enfin reprit contenance, et elle répondit sèchement, pour venger l’honneur du corps : « Vous pourriez bien être poli ! » Il s’excusa : « Pardon, je voulais dire de monastère. » Madame, ne trouvant rien à répliquer, ou jugeant peut-être la rectification suffisante, fit un salut digne en pinçant les lèvres.
Alors le monsieur, qui se trouvait assis entre Rosa la Rosse et le vieux paysan, se mit à cligner de l’œil aux trois canards dont les têtes sortaient du grand panier ; puis, quand il sentit qu’il captivait déjà son public, il commença à chatouiller ces animaux sous le bec, en leur tenant des discours drôles pour dérider la société : « Nous avons quitté notre petite ma-mare ! couen ! couen ! couen ! – pour faire connaissance avec la petite broche, – couen ! couen ! couen ! » Les malheureuses bêtes tournaient le cou afin d’éviter les caresses, faisaient des efforts affreux pour sortir de leur prison d’osier ; puis soudain toutes trois ensemble poussèrent un lamentable cri de détresse : – Couen ! couen ! couen ! couen ! – Alors ce fut une explosion de rires parmi les femmes. Elles se penchaient, elles se poussaient pour voir : on s’intéressait follement aux canards ; et le monsieur redoublait de grâce, d’esprit et d’agaceries.
Rosa s’en mêla, et, se penchant par-dessus les jambes de son voisin, elle embrassa les trois bêtes sur le nez. Aussitôt chaque femme voulut les baiser à son tour ; et le monsieur asseyait ces dames sur ses genoux, les faisait sauter, les pinçait ; tout à coup il les tutoya.
Les deux paysans, plus affolés encore que leurs volailles, roulaient des yeux de possédés sans oser faire un mouvement, et leurs vieilles figures plissées n’avaient pas un sourire, pas un tressaillement.
Alors le monsieur, qui était commis voyageur, offrit par farce des bretelles à ces dames, et, s’emparant d’un de ses paquets, il l’ouvrit. C’était une ruse, le paquet contenait des jarretières. Il y en avait en soie bleue, en soie rose, en soie violette, en soie mauve, en soie ponceau, avec des boucles de métal formées par deux amours enlacés et dorés. Les filles poussèrent des cris de joie, puis examinèrent les échantillons, reprises par la gravité naturelle à toute femme qui tripote un objet de toilette. Elles se consultaient de l’œil ou d’un mot chuchoté, se répondaient de même, et Madame maniait avec envie une paire de jarretières orangées, plus larges, plus imposantes que les autres : de vraies jarretières de patronne.
Le monsieur attendait, nourrissant une idée :
« Allons, mes petites chattes, dit-il, il faut les essayer. » Ce fut une tempête d’exclamations ; et elles serraient leurs jupes entre leurs jambes comme si elles eussent craint des violences. Lui, tranquille, attendait son heure. Il déclara : « Vous ne voulez pas, je remballe. » Puis finalement : « J’offrirai une paire, au choix, à celles qui feront l’essai. » Mais elles ne voulaient pas, très dignes, la taille redressée. Les deux Pompes cependant semblaient si malheureuses qu’il leur renouvela la proposition. Flora Balançoire surtout, torturée de désir, hésitait visiblement. Il la pressa : « Vas-y, ma fille, un peu de courage ; tiens, la paire lilas, elle ira bien avec ta toilette. » Alors elle se décida, et relevant sa robe, montra une forte jambe de vachère, mal serrée en un bas grossier. Le monsieur, se baissant, accrocha la jarretière sous le genou d’abord, puis au-dessus ; et il chatouillait doucement la fille pour lui faire pousser des petits cris avec de brusques tressaillements. Quand il eut fini, il donna la paire lilas et demanda : « À qui le tour ? » Toutes ensemble s’écrièrent : « À moi ! à moi ! » Il commença par Rosa la Rosse, qui découvrit une chose informe, toute ronde, sans cheville, un vrai « boudin de jambe », comme disait Raphaële. Fernande fut complimentée par le commis voyageur qu’enthousiasmèrent ses puissantes colonnes. Les maigres tibias de la belle Juive eurent moins de succès. Louise Cocote, par plaisanterie, coiffa le Monsieur de sa jupe ; et Madame fut obligée d’intervenir pour arrêter cette farce inconvenante. Enfin Madame elle-même tendit sa jambe, une belle jambe normande, grasse et musclée ; et le voyageur, surpris et ravi, ôta galamment son chapeau pour saluer ce maître mollet en vrai chevalier français.
Les deux paysans, figés dans l’ahurissement, regardaient de côté, d’un seul œil ; et ils ressemblaient si absolument à des poulets que l’homme aux favoris blonds, en se relevant, leur fit dans le nez « Co-co-ri-co ». Ce qui déchaîna de nouveau un ouragan de gaieté.
Les vieux descendirent à Motteville, avec leur panier, leurs canards et leur parapluie ; et l’on entendit la femme dire à son homme en s’éloignant : « C’est des traînées qui s’en vont encore à ce satané Paris. »
Le plaisant commis Porteballe descendit lui-même à Rouen, après s’être montré si grossier que Madame se vit obligée de le remettre vertement à sa place. Elle ajouta, comme morale : « Ça nous apprendra à causer au premier venu. »
À Oissel, elles changèrent de train, et trouvèrent à une gare suivante M. Joseph Rivet qui les attendait avec une grande charrette pleine de chaises et attelée d’un cheval blanc.
Le menuisier embrassa poliment toutes ces dames et les aida à monter dans sa carriole. Trois s’assirent sur trois chaises au fond ; Raphaële, Madame et son frère, sur les trois chaises de devant, et Rosa, n’ayant point de siège, se plaça tant bien que mal sur les genoux de la grande Fernande ; puis l’équipage se mit en route. Mais, aussitôt, le trot saccadé du bidet secoua si terriblement la voiture que les chaises commencèrent à danser, jetant les voyageuses en l’air, à droite, à gauche, avec des mouvements de pantins, des grimaces effarées, des cris d’effroi, coupés soudain par une secousse plus forte. Elles se cramponnaient aux côtés du véhicule ; les chapeaux tombaient dans le dos, sur le nez ou vers l’épaule ; et le cheval blanc allait toujours, allongeant la tête, et la queue droite, une petite queue de rat sans poil dont il se battait les fesses de temps en temps. Joseph Rivet, un pied tendu sur le brancard, l’autre jambe repliée sous lui, les coudes très élevés, tenait les rênes, et de sa gorge s’échappait à tout instant une sorte de gloussement qui, faisant dresser les oreilles au bidet, accélérait son allure.
Des deux côtés de la route la campagne verte se déroulait. Les colzas en fleur mettaient de place en place une grande nappe jaune ondulante d’où s’élevait une saine et puissante odeur, une odeur pénétrante et douce, portée très loin par le vent. Dans les seigles déjà grands des bluets montraient leurs petites têtes azurées que les femmes voulaient cueillir, mais M. Rivet refusa d’arrêter. Puis parfois, un champ tout entier semblait arrosé de sang tant les coquelicots l’avaient envahi. Et au milieu de ces plaines colorées ainsi par les fleurs de la terre, la carriole, qui paraissait porter elle-même un bouquet de fleurs aux teintes plus ardentes, passait au trot du cheval blanc, disparaissait derrière les grands arbres d’une ferme, pour reparaître au bout du feuillage et promener de nouveau à travers les récoltes jaunes et vertes, piquées de rouge ou de bleu, cette éclatante charretée de femmes qui fuyait sous le soleil.
Une heure sonnait quand on arriva devant la porte du menuisier.
Elles étaient brisées de fatigue et pâles de faim, n’ayant rien pris depuis le départ. Mme Rivet se précipita, les fit descendre l’une après l’autre, les embrassant aussitôt qu’elles touchaient terre ; et elle ne se lassait point de bécoter sa belle-sœur, qu’elle désirait accaparer. On mangea dans l’atelier débarrassé des établis pour le dîner du lendemain.
Une bonne omelette que suivit une andouille grillée, arrosée de bon cidre piquant, rendit la gaieté à tout le monde. Rivet, pour trinquer, avait pris un verre, et sa femme servait, faisait la cuisine, apportait les plats, les enlevait, murmurant à l’oreille de chacun : – « En avez-vous à votre désir ? » – Des tas de planches dressées contre les murs et des empilements de copeaux balayés dans les coins répandaient un parfum de bois varlopé, une odeur de menuiserie, ce souffle résineux qui pénètre au fond des poumons.
On réclama la petite, mais elle était à l’église, ne devant rentrer que le soir.
La compagnie alors sortit pour faire un tour dans le pays.
C’était un tout petit village que traversait une grande route. Une dizaine de maisons rangées le long de cette voie unique abritaient les commerçants de l’endroit, le boucher, l’épicier, le menuisier, le cafetier, le savetier et le boulanger. L’église, au bout de cette sorte de rue, était entourée d’un étroit cimetière ; et quatre tilleuls démesurés, plantés devant son portail, l’ombrageaient tout entière. Elle était bâtie en silex taillé, sans style aucun, et coiffée d’un clocher d’ardoises. Après elle la campagne recommençait, coupée çà et là de bouquets d’arbres cachant les fermes.
Rivet, par cérémonie, et bien qu’en vêtements d’ouvrier, avait pris le bras de sa sœur qu’il promenait avec majesté. Sa femme, tout émue par la robe à filets d’or de Raphaële, s’était placée entre elle et Fernande. La boulotte Rosa trottait derrière avec Louise Cocote et Flora Balançoire, qui boitillait, exténuée.
Les habitants venaient aux portes, les enfants arrêtaient leurs jeux, un rideau soulevé laissait entrevoir une tête coiffée d’un bonnet d’indienne ; une vieille à béquille et presque aveugle se signa comme devant une procession ; et chacun suivait longtemps du regard toutes les belles dames de la ville qui étaient venues de si loin pour la première communion de la petite à Joseph Rivet. Une immense considération rejaillissait sur le menuisier.
En passant devant l’église, elles entendirent des chants d’enfants : un cantique crié vers le ciel par des petites voix aiguës ; mais Madame empêcha qu’on entrât, pour ne point troubler ces chérubins.
Après un tour dans la campagne, et l’énumération des principales propriétés, du rendement de la terre et de la production du bétail, Joseph Rivet ramena son troupeau de femmes et l’installa dans son logis.
La place étant fort restreinte, on les avait réparties deux par deux dans les pièces. Rivet, pour cette fois, dormirait dans l’atelier, sur les copeaux ; sa femme partagerait son lit avec sa belle-sœur, et, dans la chambre à côté, Fernande et Raphaële reposeraient ensemble. Louise et Flora se trouvaient installées dans la cuisine sur un matelas jeté par terre et Rosa occupait seule un petit cabinet noir au-dessus de l’escalier, contre l’entrée d’une soupente étroite où coucherait, cette nuit-là, la communiante.
Lorsque rentra la petite fille, ce fut sur elle une pluie de baisers ; toutes les femmes la voulaient caresser, avec ce besoin d’expansion tendre, cette habitude professionnelle de chatteries, qui, dans le wagon, les avait fait toutes embrasser les canards. Chacune l’assit sur ses genoux, mania ses fins cheveux blonds, la serra dans ses bras en des élans d’affection véhémente et spontanée.
L’enfant bien sage, toute pénétrée de piété, comme fermée par l’absolution, se laissait faire, patiente et recueillie.
La journée ayant été pénible pour tout le monde, on se coucha bien vite après dîner. Ce silence illimité des champs qui semble presque religieux enveloppait le petit village, un silence tranquille, pénétrant, et large jusqu’aux astres. Les filles, accoutumées aux soirées tumultueuses du logis public, se sentaient émues par ce muet repos de la campagne endormie. Elles avaient des frissons sur la peau, non de froid, mais des frissons de solitude venus du cœur inquiet et troublé.
Sitôt qu’elles furent en leur lit, deux par deux, elles s’étreignirent comme pour se défendre contre cet envahissement du calme et profond sommeil de la terre. Mais Rosa la Rosse, seule en son cabinet noir, et peu habituée à dormir les bras vides, se sentit saisie par une émotion vague et pénible. Elle se retournait sur sa couche, ne pouvant obtenir le sommeil, quand elle entendit, derrière la cloison de bois contre sa tête, de faibles sanglots comme ceux d’un enfant qui pleure. Effrayée, elle appela faiblement, et une petite voix entrecoupée lui répondit. C’était la fillette qui, couchant toujours dans la chambre de sa mère, avait peur en sa soupente étroite.
Rosa, ravie, se leva, et doucement, pour ne réveiller personne, alla chercher l’enfant. Elle l’amena dans son lit bien chaud, la pressa contre sa poitrine en l’embrassant, la dorlota, l’enveloppa de sa tendresse aux manifestations exagérées, puis, calmée elle-même, s’endormit. Et jusqu’au jour la communiante reposa son front sur le sein nu de la prostituée.
Dès cinq heures, à l’Angélus, la petite cloche de l’église sonnant à toute volée réveilla ces dames qui dormaient ordinairement leur matinée entière, seul repos des fatigues nocturnes. Les paysans dans le village étaient déjà debout. Les femmes du pays allaient affairées de porte en porte, causant vivement, apportant avec précaution de courtes robes de mousseline empesées comme du carton, ou des cierges démesurés, avec un nœud de soie frangée d’or au milieu, et des découpures de cire indiquant la place de la main. Le soleil déjà haut rayonnait dans un ciel tout bleu qui gardait vers l’horizon une teinte un peu rosée, comme une trace affaiblie de l’aurore. Des familles de poules se promenaient devant leurs maisons ; et, de place en place, un coq noir au cou luisant levait sa tête coiffée de pourpre, battait des ailes, et jetait au vent son chant de cuivre que répétaient les autres coqs.
Des carrioles arrivaient des communes voisines, déchargeant au seuil des portes les hautes Normandes en robes sombres, au fichu croisé sur la poitrine et retenu par un bijou d’argent séculaire. Les hommes avaient passé la blouse bleue sur la redingote neuve ou sur le vieil habit de drap vert dont les deux basques passaient.
Quand les chevaux furent à l’écurie, il y eut ainsi tout le long de la grande route une double ligne de guimbardes rustiques, charrettes, cabriolets, tilburys, chars à bancs, voitures de toute forme et de tout âge, penchées sur le nez ou bien cul par terre et les brancards au ciel.
La maison du menuisier était pleine d’une activité de ruche. Ces dames, en caraco et en jupon, les cheveux répandus sur le dos, des cheveux maigres et courts qu’on aurait dits ternis et rongés par l’usage, s’occupaient à habiller l’enfant.
La petite, debout sur une table, ne remuait pas, tandis que Mme Tellier dirigeait les mouvements de son bataillon volant. On la débarbouilla, on la peigna, on la coiffa, on la vêtit, et, à l’aide d’une multitude d’épingles, on disposa les plis de la robe, on pinça la taille trop large, on organisa l’élégance de la toilette. Puis quand ce fut terminé, on fit asseoir la patiente en lui recommandant de ne plus bouger ; et la troupe agitée des femmes courut se parer à son tour. La petite église recommençait à sonner. Son tintement frêle de cloche pauvre montait se perdre à travers le ciel, comme une voix trop faible, vite noyée dans l’immensité bleue.
Les communiants sortaient des portes, allaient vers le bâtiment communal qui contenait les deux écoles et la mairie, et situé tout au bout du pays, tandis que la « maison de Dieu » occupait l’autre bout.
Les parents, en tenue de fête, avec une physionomie gauche et ces mouvements inhabiles des corps toujours courbés sur le travail, suivaient leurs mioches. Les petites filles disparaissaient dans un nuage de tulle neigeux semblable à de la crème fouettée, tandis que les petits hommes, pareils à des embryons de garçons de café, la tête encollée de pommade, marchaient les jambes écartées, pour ne point tacher leur culotte noire. C’était une gloire pour une famille quand un grand nombre de parents, venus de loin, entouraient l’enfant : aussi le triomphe du menuisier fut-il complet. Le régiment Tellier, patronne en tête, suivait Constance ; et le père donnant le bras à sa sœur, la mère marchant à côté de Raphaële, Fernande avec Rosa, et les deux Pompes ensemble, la troupe se déployait majestueusement comme un état-major en grand uniforme. L’effet dans le village fut foudroyant.
À l’école, les filles se rangèrent sous la cornette de la bonne sœur, les garçons sous le chapeau de l’instituteur, un bel homme qui représentait ; et l’on partit en attaquant un cantique.
Les enfants mâles en tête allongeaient leurs deux files entre les deux rangées de voitures dételées, les filles suivaient dans le même ordre ; et tous les habitants ayant cédé le pas aux dames de la ville par considération, elles arrivaient immédiatement après les petites, prolongeant encore la double ligne de la procession, trois à gauche et trois à droite, avec leurs toilettes éclatantes comme un bouquet de feu d’artifice.
Leur entrée dans l’église affola la population. On se pressait, on se retournait, on se poussait pour les voir. Et les dévotes parlaient presque haut, stupéfaites par le spectacle de ces dames plus chamarrées que les chasubles des chantres. Le maire offrit son banc, le premier banc à droite auprès du chœur, et Mme Tellier y prit place avec sa belle-sœur, Fernande et Raphaële. Rosa la Rosse et les deux Pompes occupèrent le second banc en compagnie du menuisier.
Le chœur de l’église était plein d’enfants à genoux, filles d’un côté, garçons de l’autre, et les longs cierges qu’ils tenaient en main semblaient des lances inclinées en tous sens.
Devant le lutrin, trois hommes debout chantaient d’une voix pleine. Ils prolongeaient indéfiniment les syllabes du latin sonore, éternisant les Amen avec des a-a indéfinis que le serpent soutenait de sa note monotone poussée sans fin, mugie par l’instrument de cuivre à large gueule. La voix pointue d’un enfant donnait la réplique, et, de temps en temps, un prêtre assis dans une stalle et coiffé d’une barrette carrée se levait, bredouillant quelque chose et s’asseyait de nouveau, tandis que les trois chantres repartaient, l’œil fixé sur le gros livre de plain-chant ouvert devant eux et porté par les ailes déployées d’un aigle de bois monté sur pivot.
Puis un silence se fit. Toute l’assistance, d’un seul mouvement, se mit à genoux, et l’officiant parut, vieux, vénérable, avec des cheveux blancs, incliné sur le calice qu’il portait de sa main gauche. Devant lui marchaient les deux servants en robe rouge, et derrière, apparut une foule de chantres à gros souliers qui s’alignèrent des deux côtés du chœur.
Une petite clochette tinta au milieu du grand silence. L’office divin commençait. Le prêtre circulait lentement devant le tabernacle d’or, faisait des génuflexions, psalmodiait de sa voix cassée, chevrotante de vieillesse, les prières préparatoires. Aussitôt qu’il s’était tu, tous les chantres et le serpent éclataient d’un seul coup, et des hommes aussi chantaient dans l’église, d’une voix moins forte, plus humble, comme doivent chanter les assistants.
Soudain le Kyrie Eleison jaillit vers le ciel, poussé par toutes les poitrines et tous les cœurs. Des grains de poussière et des fragments de bois vermoulu tombèrent même de la voûte ancienne secouée par cette explosion de cris. Le soleil qui frappait sur les ardoises du toit faisait une fournaise de la petite église ; et une grande émotion, une attente anxieuse, les approches de l’ineffable mystère, étreignaient le cœur des enfants, serraient la gorge de leurs mères.
Le prêtre, qui s’était assis quelque temps, remonta vers l’autel, et, tête nue, couvert de ses cheveux d’argent, avec des gestes tremblants, il approchait de l’acte surnaturel.
Il se tourna vers les fidèles, et, les mains tendues vers eux, prononça : « Orate, fratres », « priez, mes frères. » Ils priaient tous. Le vieux curé balbutiait maintenant tout bas les paroles mystérieuses et suprêmes ; la clochette tintait coup sur coup ; la foule prosternée appelait Dieu ; les enfants défaillaient d’une anxiété démesurée.
C’est alors que Rosa, le front dans ses mains, se rappela tout à coup sa mère, l’église de son village, sa première communion. Elle se crut revenue à ce jour-là, quand elle était si petite, toute noyée en sa robe blanche, et elle se mit à pleurer. Elle pleura doucement d’abord : les larmes lentes sortaient de ses paupières, puis, avec ses souvenirs, son émotion grandit, et, le cou gonflé, la poitrine battante, elle sanglota. Elle avait tiré son mouchoir, s’essuyait les yeux, se tamponnait le nez et la bouche pour ne point crier : ce fut en vain ; une espèce de râle sortit de sa gorge, et deux autres soupirs profonds, déchirants, lui répondirent ; car ses deux voisines, abattues près d’elle, Louise et Flora, étreintes des mêmes souvenances lointaines gémissaient aussi avec des torrents de larmes.
Mais comme les larmes sont contagieuses, Madame, à son tour, sentit bientôt ses paupières humides, et, se tournant vers sa belle-sœur, elle vit que tout son banc pleurait aussi.
Le prêtre engendrait le corps de Dieu. Les enfants n’avaient plus de pensée, jetés sur les dalles par une espèce de peur dévote ; et, dans l’église, de place en place, une femme, une mère, une sœur, saisie par l’étrange sympathie des émotions poignantes, bouleversée aussi par ces belles dames à genoux que secouaient des frissons et des hoquets, trempait son mouchoir d’indienne à carreaux et, de la main gauche, pressait violemment son cœur bondissant.
Comme la flammèche qui jette le feu à travers un champ mûr, les larmes de Rosa et de ses compagnes gagnèrent en un instant toute la foule.
Hommes, femmes, vieillards, jeunes gars en blouse neuve, tous bientôt sanglotèrent, et sur leur tête semblait planer quelque chose de surhumain, une âme épandue, le souffle prodigieux d’un être invisible et tout-puissant.
Alors, dans le chœur de l’église, un petit coup sec retentit : la bonne sœur, en frappant sur son livre, donnait le signal de la communion ; et les enfants, grelottant d’une fièvre divine, s’approchèrent de la table sainte.
Toute une file s’agenouillait. Le vieux curé, tenant en main le ciboire d’argent doré, passait devant eux, leur offrant, entre deux doigts, l’hostie sacrée, le corps du Christ, la rédemption du monde. Ils ouvraient la bouche avec des spasmes, des grimaces nerveuses, les yeux fermés, la face toute pâle ; et la longue nappe étendue sous leurs mentons frémissait comme de l’eau qui coule. Soudain dans l’église une sorte de folie courut, une rumeur de foule en délire, une tempête de sanglots avec des cris étouffés. Cela passa comme ces coups de vent qui courbent les forêts ; et le prêtre restait debout, immobile, une hostie à la main, paralysé par l’émotion, se disant : « C’est Dieu, c’est Dieu qui est parmi nous, qui manifeste sa présence, qui descend à ma voix sur son peuple agenouillé. » Et il balbutiait des prières affolées, sans trouver les mots, des prières de l’âme, dans un élan furieux vers le ciel.
Il acheva de donner la communion avec une telle surexcitation de foi que ses jambes défaillaient sous lui, et quand lui-même eut bu le sang de son Seigneur, il s’abîma dans un acte de remerciement éperdu.
Derrière lui le peuple peu à peu se calmait. Les chantres, relevés dans la dignité du surplis blanc, repartaient d’une voix moins sûre, encore mouillée ; et le serpent aussi semblait enroué comme si l’instrument lui-même eût pleuré.
Alors, le prêtre, levant les mains, leur fit signe de se taire, et passant entre les deux haies de communiants perdus en des extases de bonheur, il s’approcha jusqu’à la grille du chœur.
L’assemblée s’était assise au milieu d’un bruit de chaises, et tout le monde à présent se mouchait avec force. Dès qu’on aperçut le curé, on fit silence, et il commença à parler d’un ton très bas, hésitant, voilé. – « Mes chers frères, mes chères sœurs, mes enfants, je vous remercie du fond du cœur ; vous venez de me donner la plus grande joie de ma vie. J’ai senti Dieu qui descendait sur nous à mon appel. Il est venu, il était là, présent, qui emplissait vos âmes, faisait déborder vos yeux. Je suis le plus vieux prêtre du diocèse, j’en suis aussi, aujourd’hui, le plus heureux. Un miracle s’est fait parmi nous, un vrai, un grand, un sublime miracle. Pendant que Jésus-Christ pénétrait pour la première fois dans le corps de ces petits, le Saint-Esprit, l’oiseau céleste, le souffle de Dieu, s’est abattu sur vous, s’est emparé de vous, vous a saisis, courbés comme des roseaux sous la brise. »
Puis, d’une voix plus claire, se tournant vers les deux bancs où se trouvaient les invitées du menuisier : « Merci surtout à vous, mes chères sœurs, qui êtes venues de si loin, et dont la présence parmi nous, dont la foi visible, dont la piété si vive ont été pour tous un salutaire exemple. Vous êtes l’édification de ma paroisse ; votre émotion a échauffé les cœurs ; sans vous, peut-être, ce grand jour n’aurait pas eu ce caractère vraiment divin. Il suffit parfois d’une seule brebis d’élite pour décider le Seigneur à descendre sur le troupeau. » La voix lui manquait. Il ajouta : « C’est la grâce que je vous souhaite. Ainsi soit-il. » Et il remonta vers l’autel pour terminer l’office.
Maintenant on avait hâte de partir. Les enfants eux-mêmes s’agitaient, las d’une si longue tension d’esprit. Ils avaient faim, d’ailleurs, et les parents peu à peu s’en allaient, sans attendre le dernier évangile, pour terminer les apprêts du repas.
Ce fut une cohue à la sortie, une cohue bruyante, un charivari de voix criardes où chantait l’accent normand. La population formait deux haies, et lorsque parurent les enfants, chaque famille se précipita sur le sien.
Constance se trouva saisie, entourée, embrassée par toute la maisonnée de femmes. Rosa surtout ne se lassait pas de l’étreindre. Enfin elle lui prit une main, Mme Tellier s’empara de l’autre ; Raphaële et Fernande relevèrent sa longue jupe de mousseline pour qu’elle ne traînât point dans la poussière ; Louise et Flora fermaient la marche avec Mme Rivet ; et l’enfant, recueillie, toute pénétrée par le Dieu qu’elle portait en elle, se mit en route au milieu de cette escorte d’honneur.
Le festin était servi dans l’atelier sur de longues planches portées par des traverses.
La porte ouverte, donnant sur la rue, laissait entrer toute la joie du village. On se régalait partout. Par chaque fenêtre on apercevait des tablées de monde endimanché, et des cris sortaient des maisons en goguette. Les paysans, en bras de chemise, buvaient du cidre pur à plein verre, et au milieu de chaque compagnie on apercevait deux enfants, ici deux filles, là deux garçons, dînant dans l’une des deux familles.
Quelquefois, sous la lourde chaleur de midi, un char à bancs traversait le pays au trot sautillant d’un vieux bidet, et l’homme en blouse qui conduisait jetait un regard d’envie sur toute cette ripaille étalée.
Dans la demeure du menuisier, la gaieté gardait un certain air de réserve, un reste de l’émotion du matin. Rivet seul était en train et buvait outre mesure. Mme Tellier regardait l’heure à tout moment, car pour ne point chômer deux jours de suite on devait reprendre le train de 3 h 55 qui les mettrait à Fécamp vers le soir.
Le menuisier faisait tous ses efforts pour détourner l’attention et garder son monde jusqu’au lendemain ; mais Madame ne se laissait point distraire ; et elle ne plaisantait jamais quand il s’agissait des affaires.
Aussitôt que le café fut pris, elle ordonna à ses pensionnaires de se préparer bien vite ; puis, se tournant vers son frère : – « Toi, tu vas atteler tout de suite » ; et elle-même alla terminer ses derniers préparatifs.
Quand elle redescendit, sa belle-sœur l’attendait pour lui parler de la petite ; et une longue conversation eut lieu où rien ne fut résolu. La paysanne finassait, faussement attendrie, et Mme Tellier, qui tenait l’enfant sur ses genoux, ne s’engageait à rien, promettait vaguement : on s’occuperait d’elle, on avait du temps, on se reverrait d’ailleurs.
Cependant la voiture n’arrivait point, et les femmes ne descendaient pas. On entendait même en haut de grands rires, des bousculades, des poussées de cris, des battements de mains. Alors, tandis que l’épouse du menuisier se rendait à l’écurie pour voir si l’équipage était prêt, Madame, à la fin, monta.
Rivet, très pochard et à moitié dévêtu, essayait, mais en vain, de violenter Rosa qui défaillait de rire. Les deux Pompes le retenaient par les bras, et tentaient de le calmer, choquées de cette scène après la cérémonie du matin ; mais Raphaële et Fernande l’excitaient, tordues de gaieté, se tenant les côtes ; et elles jetaient des cris aigus à chacun des efforts inutiles de l’ivrogne. L’homme furieux, la face rouge, tout débraillé, secouant en des efforts violents les deux femmes cramponnées à lui, tirait de toutes ses forces sur la jupe de Rosa en bredouillant : – « Salope, tu ne veux pas ? » – Mais Madame, indignée, s’élança, saisit son frère par les épaules, et le jeta dehors si violemment qu’il alla frapper contre le mur.
Une minute plus tard, on l’entendait dans la cour qui se pompait de l’eau sur la tête ; et quand il repartit dans sa carriole, il était déjà tout apaisé.
On se remit en route comme la veille, et le petit cheval blanc repartit de son allure vive et dansante.
Sous le soleil ardent, la joie assoupie pendant le repas se dégageait. Les filles s’amusaient maintenant des cahots de la guimbarde, poussaient même les chaises des voisines, éclataient de rire à tout instant, mises en train d’ailleurs par les vaines tentatives de Rivet.
Une lumière folle emplissait les champs, une lumière miroitant aux yeux ; et les roues soulevaient deux sillons de poussière qui voltigeaient longtemps derrière la voiture sur la grand-route.
Tout à coup Fernande, qui aimait la musique, supplia Rosa de chanter ; et celle-ci entama gaillardement le Gros Curé de Meudon. Mais Madame tout de suite la fit taire, trouvant cette chanson peu convenable en ce jour. Elle ajouta : – « Chante-nous plutôt quelque chose de Béranger. » – Alors Rosa, après avoir hésité quelques secondes, fixa son choix, et de sa voix usée commença la Grand-mère :
Ma grand’mère, un soir à sa fête,
De vin pur ayant bu deux doigts,
Nous disait, en branlant la tête :
Que d’amoureux j’eus autrefois !
Combien je regrette
Mon bras si dodu,
Ma jambe bien faite,
Et le temps perdu !
Et le chœur des filles, que Madame elle-même conduisait, reprit :
Combien je regrette
Mon bras si dodu,
Ma jambe bien faite,
Et le temps perdu !
– Ça, c’est tapé ! déclara Rivet, allumé par la cadence ; et Rosa aussitôt continua :
Quoi, maman, vous n’étiez pas sage !
– Non, vraiment ! et de mes appas,
Seule, à quinze ans, j’appris l’usage,
Car, la nuit, je ne dormais pas.
Tous ensemble hurlèrent le refrain ; et Rivet tapait du pied sur son brancard, battait la mesure avec les rênes sur le dos du bidet blanc qui, comme s’il eût été lui-même enlevé par l’entrain du rythme, prit le galop, un galop de tempête, précipitant ces dames en tas les unes sur les autres dans le fond de la voiture.
Elles se relevèrent en riant comme des folles.
Et la chanson continua, braillée à tue-tête à travers la campagne, sous le ciel brûlant, au milieu des récoltes mûrissantes, au train enragé du petit cheval qui s’emballait maintenant à tous les retours du refrain, et piquait chaque fois ses cent mètres de galop, à la grande joie des voyageurs. De place en place, quelque casseur de cailloux se redressait, et regardait à travers son loup de fil de fer cette carriole enragée et hurlante emportée dans la poussière.
Quand on descendit devant la gare, le menuisier s’attendrit : – « C’est dommage que vous partiez, on aurait bien rigolé. »
Madame lui répondit censément : – « Toute chose a son temps, on ne peut pas s’amuser toujours. » – Alors une idée illumina l’esprit de Rivet : – « Tiens, dit-il, j’irai vous voir à Fécamp le mois prochain. » – Et il regarda Rosa d’un air rusé, avec un œil brillant et polisson. – « Allons, conclut Madame, il faut être sage ; tu viendras si tu veux, mais tu ne feras point de bêtises. »
Il ne répondit pas, et comme on entendait siffler le train, il se mit immédiatement à embrasser tout le monde. Quand ce fut au tour de Rosa, il s’acharna à trouver sa bouche que celle-ci, riant derrière ses lèvres fermées, lui dérobait chaque fois par un rapide mouvement de côté. Il la tenait en ses bras ; mais il n’en pouvait venir à bout, gêné par son grand fouet qu’il avait gardé à sa main et que, dans ses efforts, il agitait désespérément derrière le dos de la fille.
– Les voyageurs pour Rouen, en voiture, cria l’employé. Elles montèrent.
Un mince coup de sifflet partit, répété tout de suite par le sifflement puissant de la machine qui cracha bruyamment son premier jet de vapeur pendant que les roues commençaient à tourner un peu avec un effort visible.
Rivet, quittant l’intérieur de la gare, courut à la barrière pour voir encore une fois Rosa ; et comme le wagon plein de cette marchandise humaine passait devant lui, il se mit à faire claquer son fouet en sautant et chantant de toutes ses forces :
Combien je regrette
Mon bras si dodu,
Ma jambe bien faite,
Et le temps perdu !
Puis il regarda s’éloigner un mouchoir blanc qu’on agitait.
III
Elles dormirent jusqu’à l’arrivée, du sommeil paisible des consciences satisfaites ; et quand elles rentrèrent au logis, rafraîchies, reposées pour la besogne de chaque soir, Madame ne put s’empêcher de dire : – « C’est égal, il m’ennuyait déjà de la maison. »
On soupa vite, puis, quand on eut repris le costume de combat, on attendit les clients habituels ; et la petite lanterne allumée, la petite lanterne de madone, indiquait aux passants que dans la bergerie le troupeau était revenu.
En un clin d’œil la nouvelle se répandit, on ne sait comment, on ne sait par qui, M. Philippe, le fils du banquier, poussa même la complaisance jusqu’à prévenir par un exprès M. Tournevau, emprisonné dans sa famille.
Le saleur avait justement chaque dimanche plusieurs cousins à dîner, et l’on prenait le café quand un homme se présenta avec une lettre à la main. M. Tournevau, très ému, rompit l’enveloppe et devint pâle : il n’y avait que ces mots tracés au crayon : « Chargement de morues retrouvé ; navire entré au port ; bonne affaire pour vous. Venez vite. »
Il fouilla dans ses poches, donna vingt centimes au porteur, et rougissant soudain jusqu’aux oreilles : « Il faut, dit-il, que je sorte. » Et il tendit à sa femme le billet laconique et mystérieux. Il sonna, puis, lorsque parut la bonne : – « Mon pardessus vite, vite, et mon chapeau. » – À peine dans la rue, il se mit à courir en sifflant un air, et le chemin lui parut deux fois plus long tant son impatience était vive.
L’établissement Tellier avait un air de fête. Au rez-de-chaussée les voix tapageuses des hommes du port faisaient un assourdissant vacarme. Louise et Flora ne savaient à qui répondre, buvaient avec l’un, buvaient avec l’autre, méritaient mieux que jamais leur sobriquet des « deux Pompes ». On les appelait partout à la fois ; elles ne pouvaient déjà suffire à la besogne, et la nuit pour elles s’annonçait laborieuse.
Le cénacle du premier fut au complet dès neuf heures. M. Vasse, le juge au tribunal de commerce, le soupirant attitré mais platonique de Madame, causait tout bas avec elle dans un coin ; et ils souriaient tous les deux comme si une entente était près de se faire. M. Poulin, l’ancien maire, tenait Rosa à cheval sur ses jambes ; et elle, nez à nez avec lui, promenait ses mains courtes dans les favoris blancs du bonhomme. Un bout de cuisse nue passait sous la jupe de soie jaune relevée, coupant le drap noir du pantalon, et les bas rouges étaient serrés par une jarretière bleue, cadeau du commis voyageur. La grande Fernande, étendue sur le sopha, avait les deux pieds sur le ventre de M. Pimpesse, le percepteur, et le torse sur le gilet du jeune M. Philippe dont elle accrochait le cou de sa main droite, tandis que de la gauche, elle tenait une cigarette.
Raphaële semblait en pourparlers avec M. Dupuis, l’agent d’assurances, et elle termina l’entretien par ces mots : – « Oui, mon chéri, ce soir, je veux bien. » – Puis, faisant seule un tour de valse rapide à travers le salon : – « Ce soir, tout ce qu’on voudra », cria-t-elle.
La porte s’ouvrit brusquement et M. Tournevau parut. Des cris d’enthousiasme éclatèrent : – « Vive Tournevau ! » – Et Raphaële, qui pivotait toujours, alla tomber sur son cœur. Il la saisit d’un enlacement formidable, et sans dire un mot, l’enlevant de terre comme une plume, il traversa le salon, gagna la porte du fond, et disparut dans l’escalier des chambres avec son fardeau vivant, au milieu des applaudissements.
Rosa, qui allumait l’ancien maire, l’embrassant coup sur coup et tirant sur ses deux favoris en même temps pour maintenir droite sa tête, profita de l’exemple : – « Allons, fais comme lui », dit-elle. Alors le bonhomme se leva, et rajustant son gilet, suivit la fille en fouillant dans la poche où dormait son argent.
Fernande et Madame restèrent seules avec les quatre hommes, et M. Philippe s’écria : – « Je paie du champagne : Mme Tellier, envoyez chercher trois bouteilles. »
– Alors Fernande l’étreignant lui demanda dans l’oreille : – « Fais-nous danser, dis, tu veux ? » – Il se leva, et, s’asseyant devant l’épinette séculaire, endormie en un coin, fit sortir une valse, une valse enrouée, larmoyante, du ventre geignant de la machine. La grande fille enlaça le percepteur, Madame s’abandonna aux bras de M. Vasse ; et les deux couples tournèrent en échangeant des baisers. M. Vasse, qui avait jadis dansé dans le monde, faisait des grâces, et Madame le regardait d’un œil captivé, de cet œil qui répond « oui », un « oui » plus discret et plus délicieux qu’une parole !
Frédéric apporta le champagne. Le premier bouchon partit, et M. Philippe exécuta l’invitation d’un quadrille. Les quatre danseurs le marchèrent à la façon mondaine, convenablement, dignement, avec des manières, des inclinations et des saluts.
Après quoi l’on se mit à boire. Alors M. Tournevau reparut, satisfait, soulagé, radieux. Il s’écria : – « Je ne sais pas ce qu’a Raphaële, mais elle est parfaite ce soir. » – Puis, comme on lui tendait un verre, il le vida d’un trait en murmurant : – « Bigre, rien que ça de luxe ! »
Sur-le-champ, M. Philippe entama une polka vive, et M. Tournevau s’élança avec la belle Juive qu’il tenait en l’air, sans laisser ses pieds toucher terre. M. Pimpesse et M. Vasse étaient repartis d’un nouvel élan. De temps en temps un des couples s’arrêtait près de la cheminée pour lamper une flûte de vin mousseux ; et cette danse menaçait de s’éterniser, quand Rosa entrouvrit la porte avec un bougeoir à la main. Elle était en cheveux, en savates, en chemise, tout animée, toute rouge : – « Je veux danser », cria-t-elle. Raphaële demanda : – « Et ton vieux ? » Rosa s’esclaffa : – « Lui ? il dort déjà, il dort tout de suite. » Elle saisit M. Dupuis resté sans emploi sur le divan, et la polka recommença.
Mais les bouteilles étaient vides : – « J’en paie une », déclara M. Tournevau. – « Moi aussi », annonça M. Vasse. – « Moi de même », conclut M. Dupuis. Alors tout le monde applaudit. Cela s’organisait, devenait un vrai bal. De temps en temps même, Louise et Flora montaient bien vite, faisaient rapidement un tour de valse, pendant que leurs clients, en bas, s’impatientaient ; puis elles retournaient en courant à leur café, avec le cœur gonflé de regrets.
À minuit on dansait encore. Parfois une des filles disparaissait, et quand on la cherchait pour faire un vis-à-vis, on s’apercevait tout à coup qu’un des hommes aussi manquait.
– D’où venez-vous donc ? demanda plaisamment M. Philippe, juste au moment où M. Pimpesse rentrait avec Fernande. – « De voir dormir M. Poulin », répondit le percepteur. Le mot eut un succès énorme ; et tous, à tour de rôle, montaient voir dormir M. Poulin avec l’une ou l’autre des demoiselles, qui se montrèrent, cette nuit-là, d’une complaisance inconcevable. Madame fermait les yeux ; et elle avait dans les coins de longs apartés avec M. Vasse comme pour régler les derniers détails d’une affaire entendue déjà.
Enfin, à une heure, les deux hommes mariés, M. Tournevau et M. Pimpesse, déclarèrent qu’ils se retiraient, et voulurent régler leur compte. On ne compta que le champagne, et, encore, à six francs la bouteille au lieu de dix francs, prix ordinaire. Et comme ils s’étonnaient de cette générosité, Madame, radieuse, leur répondit :
– Ça n’est pas tous les jours fête.
FIN