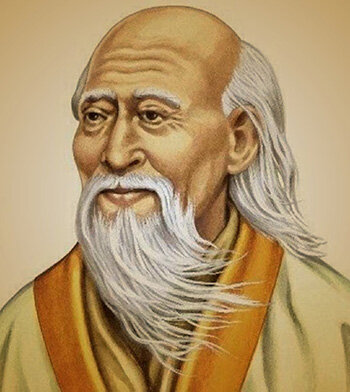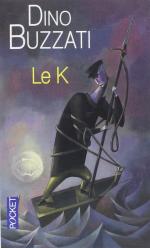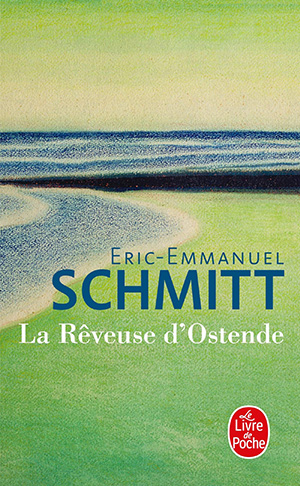MOLIÈRE
LES FEMMES SAVANTES
Comédie
ACTEURS
CHRYSALE, bon Bourgeois.
PHILAMINTE, femme de Chrysale.
ARMANDE, HENRIETTE, filles de Chrysale et de Philaminte.
ARISTE, frère de Chrysale.
BÉLISE, sœur de Chrysale.
CLITANDRE, amant d'Henriette.
TRISSOTIN, bel esprit.
VADIUS, savant.
MARTINE, servante de cuisine.
L'ÉPINE, laquais de Trissotin.
JULIEN, valet de Vadius.
LE NOTAIRE.
La scène est à Paris.
ACTE I, SCÈNE PREMIÈRE
Images : mise en scène Macha Makeïev

ARMANDE, HENRIETTE.
ARMANDE
Quoi, le beau nom de fille est un titre, ma sœur,
Dont vous voulez quitter la charmante douceur?
Et de vous marier vous osez faire fête?
Ce vulgaire dessein vous peut monter en tête?
HENRIETTE
Oui, ma sœur.
ARMANDE
Ah ce «oui» se peut-il supporter?
Et sans un mal de cœur saurait-on l'écouter?
HENRIETTE
Qu'a donc le mariage en soi qui vous oblige,
Ma sœur…
ARMANDE
Ah mon Dieu, fi.
HENRIETTE
Comment?
ARMANDE
Ah fi, vous dis-je.
Ne concevez-vous point ce que, dès qu'on l'entend,
Un tel mot à l'esprit offre de dégoûtant?
De quelle étrange image on est par lui blessée?
Sur quelle sale vue il traîne la pensée?
N'en frissonnez-vous point? et pouvez-vous, ma sœur,
Aux suites de ce mot résoudre votre cœur?
HENRIETTE
Les suites de ce mot, quand je les envisage,
Me font voir un mari, des enfants, un ménage;
Et je ne vois rien là, si j'en puis raisonner,
Qui blesse la pensée, et fasse frissonner.
ARMANDE
De tels attachements, ô Ciel! sont pour vous plaire?
HENRIETTE
Et qu'est-ce qu'à mon âge on a de mieux à faire,
Que d'attacher à soi, par le titre d'époux,
Un homme qui vous aime, et soit aimé de vous;
Et de cette union de tendresse suivie,
Se faire les douceurs d'une innocente vie?
Ce nœud bien assorti n'a-t-il pas des appas?
ARMANDE
Mon Dieu, que votre esprit est d'un étage bas!
Que vous jouez au monde un petit personnage,
De vous claquemurer aux choses du ménage,
Et de n'entrevoir point de plaisirs plus touchants,
Qu'un idole d'époux, et des marmots d'enfants!
Laissez aux gens grossiers, aux personnes vulgaires,
Les bas amusements de ces sortes d'affaires.
À de plus hauts objets élevez vos désirs,
Songez à prendre un goût des plus nobles plaisirs,
Et traitant de mépris les sens et la matière,
À l'esprit comme nous donnez-vous toute entière:
Vous avez notre mère en exemple à vos yeux,
Que du nom de savante on honore en tous lieux,
Tâchez ainsi que moi de vous montrer sa fille,
Aspirez aux clartés qui sont dans la famille,
Et vous rendez sensible aux charmantes douceurs
Que l'amour de l'étude épanche dans les cœurs:
Loin d'être aux lois d'un homme en esclave asservie;
Mariez-vous, ma sœur, à la philosophie,
Qui nous monte au-dessus de tout le genre humain,
Et donne à la raison l'empire souverain,
Soumettant à ses lois la partie animale
Dont l'appétit grossier aux bêtes nous ravale.
Ce sont là les beaux feux, les doux attachements,
Qui doivent de la vie occuper les moments;
Et les soins où je vois tant de femmes sensibles,
Me paraissent aux yeux des pauvretés horribles.
HENRIETTE
Le Ciel, dont nous voyons que l'ordre est tout-puissant,
Pour différents emplois nous fabrique en naissant;
Et tout esprit n'est pas composé d'une étoffe
Qui se trouve taillée à faire un philosophe.
Si le vôtre est né propre aux élévations
Où montent des savants les spéculations,
Le mien est fait, ma sœur, pour aller terre à terre,
Et dans les petits soins son faible se resserre.
Ne troublons point du Ciel les justes règlements,
Et de nos deux instincts suivons les mouvements;
Habitez par l'essor d'un grand et beau génie,
Les hautes régions de la philosophie,
Tandis que mon esprit se tenant ici-bas,
Goûtera de l'hymen les terrestres appas.
Ainsi dans nos desseins l'une à l'autre contraire,
Nous saurons toutes deux imiter notre mère;
Vous, du côté de l'âme et des nobles désirs,
Moi, du côté des sens et des grossiers plaisirs;
Vous, aux productions d'esprit et de lumière,
Moi, dans celles, ma sœur, qui sont de la matière.
ARMANDE
Quand sur une personne on prétend se régler,
C'est par les beaux côtés qu'il lui faut ressembler;
Et ce n'est point du tout la prendre pour modèle,
Ma sœur, que de tousser et de cracher comme elle.
HENRIETTE
Mais vous ne seriez pas ce dont vous vous vantez,
Si ma mère n'eût eu que de ces beaux côtés;
Et bien vous prend, ma sœur, que son noble génie
N'ait pas vaqué toujours à la philosophie.
De grâce souffrez-moi par un peu de bonté
Des bassesses à qui vous devez la clarté;
Et ne supprimez point, voulant qu'on vous seconde,
Quelque petit savant qui veut venir au monde.
ARMANDE
Je vois que votre esprit ne peut être guéri
Du fol entêtement de vous faire un mari:
Mais sachons, s'il vous plaît, qui vous songez à prendre?
Votre visée au moins n'est pas mise à Clitandre.
HENRIETTE
Et par quelle raison n'y serait-elle pas?
Manque-t-il de mérite? est-ce un choix qui soit bas?
ARMANDE
Non, mais c'est un dessein qui serait malhonnête,
Que de vouloir d'un autre enlever la conquête;
Et ce n'est pas un fait dans le monde ignoré,
Que Clitandre ait pour moi hautement soupiré.
HENRIETTE
Oui, mais tous ces soupirs chez vous sont choses vaines,
Et vous ne tombez point aux bassesses humaines;
Votre esprit à l'hymen renonce pour toujours,
Et la philosophie a toutes vos amours:
Ainsi n'ayant au cœur nul dessein pour Clitandre,
Que vous importe-t-il qu'on y puisse prétendre?
ARMANDE
Cet empire que tient la raison sur les sens,
Ne fait pas renoncer aux douceurs des encens;
Et l'on peut pour époux refuser un mérite
Que pour adorateur on veut bien à sa suite.
HENRIETTE
Je n'ai pas empêché qu'à vos perfections
Il n'ait continué ses adorations;
Et je n'ai fait que prendre, au refus de votre âme,
Ce qu'est venu m'offrir l'hommage de sa flamme.
ARMANDE
Mais à l'offre des vœux d'un amant dépité,
Trouvez-vous, je vous prie, entière sûreté?
Croyez-vous pour vos yeux sa passion bien forte,
Et qu'en son cœur pour moi toute flamme soit morte?
HENRIETTE
Il me le dit, ma sœur, et pour moi je le croi.
ARMANDE
Ne soyez pas, ma sœur, d'une si bonne foi,
Et croyez, quand il dit qu'il me quitte et vous aime,
Qu'il n'y songe pas bien, et se trompe lui-même.
HENRIETTE
Je ne sais; mais enfin, si c'est votre plaisir,
Il nous est bien aisé de nous en éclaircir.
Je l'aperçois qui vient, et sur cette matière
Il pourra nous donner une pleine lumière.

SCÈNE II
CLITANDRE, ARMANDE, HENRIETTE.
HENRIETTE
Pour me tirer d'un doute où me jette ma sœur,
Entre elle et moi, Clitandre, expliquez votre cœur,
Découvrez-en le fond, et nous daignez apprendre
Qui de nous à vos vœux est en droit de prétendre.
ARMANDE
Non, non, je ne veux point à votre passion
Imposer la rigueur d'une explication;
Je ménage les gens, et sais comme embarrasse
Le contraignant effort de ces aveux en face.
CLITANDRE
Non, Madame, mon cœur qui dissimule peu,
Ne sent nulle contrainte à faire un libre aveu;
Dans aucun embarras un tel pas ne me jette,
Et j'avouerai tout haut d'une âme franche et nette,
Que les tendres liens où je suis arrêté,
Mon amour et mes vœux, sont tout de ce côté.
Qu'à nulle émotion cet aveu ne vous porte;
Vous avez bien voulu les choses de la sorte,
Vos attraits m'avaient pris, et mes tendres soupirs
Vous ont assez prouvé l'ardeur de mes désirs:
Mon cœur vous consacrait une flamme immortelle,
Mais vos yeux n'ont pas cru leur conquête assez belle;
J'ai souffert sous leur joug cent mépris différents,
Ils régnaient sur mon âme en superbes tyrans,
Et je me suis cherché, lassé de tant de peines,
Des vainqueurs plus humains, et de moins rudes chaînes:
Je les ai rencontrés, Madame, dans ces yeux,
Et leurs traits à jamais me seront précieux;
D'un regard pitoyable ils ont séché mes larmes,
Et n'ont pas dédaigné le rebut de vos charmes;
De si rares bontés m'ont si bien su toucher,
Qu'il n'est rien qui me puisse à mes fers arracher;
Et j'ose maintenant vous conjurer, Madame,
De ne vouloir tenter nul effort sur ma flamme,
De ne point essayer à rappeler un cœur
Résolu de mourir dans cette douce ardeur.
ARMANDE
Eh qui vous dit, Monsieur, que l'on ait cette envie,
Et que de vous enfin si fort on se soucie?
Je vous trouve plaisant, de vous le figurer;
Et bien impertinent, de me le déclarer.
HENRIETTE
Eh doucement, ma sœur. Où donc est la morale
Qui sait si bien régir la partie animale,
Et retenir la bride aux efforts du courroux?
ARMANDE
Mais vous qui m'en parlez, où la pratiquez-vous,
De répondre à l'amour que l'on vous fait paraître,
Sans le congé de ceux qui vous ont donné l'être?
Sachez que le devoir vous soumet à leurs lois,
Qu'il ne vous est permis d'aimer que par leur choix,
Qu'ils ont sur votre cœur l'autorité suprême,
Et qu'il est criminel d'en disposer vous-même.
HENRIETTE
Je rends grâce aux bontés que vous me faites voir,
De m'enseigner si bien les choses du devoir;
Mon cœur sur vos leçons veut régler sa conduite,
Et pour vous faire voir, ma sœur, que j'en profite,
Clitandre, prenez soin d'appuyer votre amour
De l'agrément de ceux dont j'ai reçu le jour,
Faites-vous sur mes vœux un pouvoir légitime,
Et me donnez moyen de vous aimer sans crime.
CLITANDRE
J'y vais de tous mes soins travailler hautement,
Et j'attendais de vous ce doux consentement.
ARMANDE
Vous triomphez, ma sœur, et faites une mine
À vous imaginer que cela me chagrine.
HENRIETTE
Moi, ma sœur, point du tout; je sais que sur vos sens
Les droits de la raison sont toujours tout-puissants,
Et que par les leçons qu'on prend dans la sagesse,
Vous êtes au-dessus d'une telle faiblesse.
Loin de vous soupçonner d'aucun chagrin, je croi
Qu'ici vous daignerez vous employer pour moi,
Appuyer sa demande, et de votre suffrage
Presser l'heureux moment de notre mariage.
Je vous en sollicite, et pour y travailler…
ARMANDE
Votre petit esprit se mêle de railler,
Et d'un cœur qu'on vous jette on vous voit toute fière.
HENRIETTE
Tout jeté qu'est ce cœur, il ne vous déplaît guère;
Et si vos yeux sur moi le pouvaient ramasser,
Ils prendraient aisément le soin de se baisser.
ARMANDE
À répondre à cela je ne daigne descendre,
Et ce sont sots discours qu'il ne faut pas entendre.
HENRIETTE
C'est fort bien fait à vous, et vous nous faites voir
Des modérations qu'on ne peut concevoir.
SCÈNE III
CLITANDRE, HENRIETTE.
HENRIETTE
Votre sincère aveu ne l'a pas peu surprise.
CLITANDRE
Elle mérite assez une telle franchise,
Et toutes les hauteurs de sa folle fierté
Sont dignes tout au moins de ma sincérité:
Mais puisqu'il m'est permis, je vais à votre père,
Madame…
HENRIETTE
Le plus sûr est de gagner ma mère:
Mon père est d'une humeur à consentir à tout,
Mais il met peu de poids aux choses qu'il résout;
Il a reçu du Ciel certaine bonté d'âme,
Qui le soumet d'abord à ce que veut sa femme;
C'est elle qui gouverne, et d'un ton absolu
Elle dicte pour loi ce qu'elle a résolu.
Je voudrais bien vous voir pour elle, et pour ma tante,
Une âme, je l'avoue, un peu plus complaisante,
Un esprit qui flattant les visions du leur,
Vous pût de leur estime attirer la chaleur.
CLITANDRE
Mon cœur n'a jamais pu, tant il est né sincère,
Même dans votre sœur flatter leur caractère,
Et les femmes docteurs ne sont point de mon goût.
Je consens qu'une femme ait des clartés de tout,
Mais je ne lui veux point la passion choquante
De se rendre savante afin d'être savante;
Et j'aime que souvent aux questions qu'on fait,
Elle sache ignorer les choses qu'elle sait;
De son étude enfin je veux qu'elle se cache,
Et qu'elle ait du savoir sans vouloir qu'on le sache,
Sans citer les auteurs, sans dire de grands mots,
Et clouer de l'esprit à ses moindres propos.
Je respecte beaucoup Madame votre mère,
Mais je ne puis du tout approuver sa chimère,
Et me rendre l'écho des choses qu'elle dit
Aux encens qu'elle donne à son héros d'esprit.
Son Monsieur Trissotin me chagrine, m'assomme,
Et j'enrage de voir qu'elle estime un tel homme,
Qu'elle nous mette au rang des grands et beaux esprits
Un benêt dont partout on siffle les écrits,
Un pédant dont on voit la plume libérale
D'officieux papiers fournir toute la halle.
HENRIETTE
Ses écrits, ses discours, tout m'en semble ennuyeux,
Et je me trouve assez votre goût et vos yeux
Mais comme sur ma mère il a grande puissance,
Vous devez vous forcer à quelque complaisance.
Un amant fait sa cour où s'attache son cœur,
Il veut de tout le monde y gagner la faveur;
Et pour n'avoir personne à sa flamme contraire,
Jusqu'au chien du logis il s'efforce de plaire.
CLITANDRE
Oui, vous avez raison; mais Monsieur Trissotin
M'inspire au fond de l'âme un dominant chagrin.
Je ne puis consentir, pour gagner ses suffrages,
À me déshonorer, en prisant ses ouvrages;
C'est par eux qu'à mes yeux il a d'abord paru,
Et je le connaissais avant que l'avoir vu.
Je vis dans le fatras des écrits qu'il nous donne,
Ce qu'étale en tous lieux sa pédante personne,
La constante hauteur de sa présomption;
Cette intrépidité de bonne opinion;
Cet indolent état de confiance extrême,
Qui le rend en tout temps si content de soi-même,
Qui fait qu'à son mérite incessamment il rit;
Qu'il se sait si bon gré de tout ce qu'il écrit;
Et qu'il ne voudrait pas changer sa renommée
Contre tous les honneurs d'un général d'armée.
HENRIETTE
C'est avoir de bons yeux que de voir tout cela.
CLITANDRE
Jusques à sa figure encor la chose alla,
Et je vis par les vers qu'à la tête il nous jette,
De quel air il fallait que fût fait le poète;
Et j'en avais si bien deviné tous les traits,
Que rencontrant un homme un jour dans le Palais,
Je gageai que c'était Trissotin en personne,
Et je vis qu'en effet la gageure était bonne.
HENRIETTE
Quel conte!
CLITANDRE Non, je dis la chose comme elle est:
Mais je vois votre tante. Agréez, s'il vous plaît,
Que mon cœur lui déclare ici notre mystère,
Et gagne sa faveur auprès de votre mère.

SCÈNE IV
CLITANDRE, BÉLISE.
CLITANDRE
Souffrez, pour vous parler, Madame, qu'un amant
Prenne l'occasion de cet heureux moment,
Et se découvre à vous de la sincère flamme…
BÉLISE
Ah tout beau, gardez-vous de m'ouvrir trop votre âme:
Si je vous ai su mettre au rang de mes amants,
Contentez-vous des yeux pour vos seuls truchements,
Et ne m'expliquez point par un autre langage
Des désirs qui chez moi passent pour un outrage;
Aimez-moi, soupirez, brûlez pour mes appas,
Mais qu'il me soit permis de ne le savoir pas:
Je puis fermer les yeux sur vos flammes secrètes,
Tant que vous vous tiendrez aux muets interprètes;
Mais si la bouche vient à s'en vouloir mêler,
Pour jamais de ma vue il vous faut exiler.
CLITANDRE
Des projets de mon cœur ne prenez point d'alarme;
Henriette, Madame, est l'objet qui me charme,
Et je viens ardemment conjurer vos bontés
De seconder l'amour que j'ai pour ses beautés.
BÉLISE
Ah certes le détour est d'esprit, je l'avoue,
Ce subtil faux-fuyant mérite qu'on le loue;
Et dans tous les romans où j'ai jeté les yeux,
Je n'ai rien rencontré de plus ingénieux.
CLITANDRE
Ceci n'est point du tout un trait d'esprit, Madame,
Et c'est un pur aveu de ce que j'ai dans l'âme.
Les cieux, par les liens d'une immuable ardeur,
Aux beautés d'Henriette ont attaché mon cœur;
Henriette me tient sous son aimable empire,
Et l'hymen d'Henriette est le bien où j'aspire;
Vous y pouvez beaucoup, et tout ce que je veux,
C'est que vous y daigniez favoriser mes vœux.
BÉLISE
Je vois où doucement veut aller la demande,
Et je sais sous ce nom ce qu'il faut que j'entende;
La figure est adroite, et pour n'en point sortir,
Aux choses que mon cœur m'offre à vous repartir,
Je dirai qu'Henriette à l'hymen est rebelle,
Et que sans rien prétendre, il faut brûler pour elle.
CLITANDRE
Eh, Madame, à quoi bon un pareil embarras,
Et pourquoi voulez-vous penser ce qui n'est pas?
BÉLISE
Mon Dieu, point de façons; cessez de vous défendre
De ce que vos regards m'ont souvent fait entendre;
Il suffit que l'on est contente du détour
Dont s'est adroitement avisé votre amour,
Et que sous la figure où le respect l'engage,
On veut bien se résoudre à souffrir son hommage,
Pourvu que ses transports par l'honneur éclairés
N'offrent à mes autels que des vœux épurés.
CLITANDRE
Mais…
BÉLISE
Adieu, pour ce coup ceci doit vous suffire,
Et je vous ai plus dit que je ne voulais dire.
CLITANDRE
Mais votre erreur…
BÉLISE
Laissez, je rougis maintenant,
Et ma pudeur s'est fait un effort surprenant.
CLITANDRE
Je veux être pendu, si je vous aime, et sage…
BÉLISE
Non, non, je ne veux rien entendre davantage.
CLITANDRE Diantre soit de la folle avec ses visions.
A-t-on rien vu d'égal à ces préventions?
Allons commettre un autre au soin que l'on me donne,
Et prenons le secours d'une sage personne.

ACTE II, SCÈNE PREMIÈRE
ARISTE, quittant Clitandre,
Oui, je vous porterai la réponse au plus tôt;
J'appuierai, presserai, ferai tout ce qu'il faut.
Qu'un amant, pour un mot, a de choses à dire!
Et qu'impatiemment il veut ce qu'il désire!
Jamais…
SCÈNE II
CHRYSALE, ARISTE.
ARISTE
Ah, Dieu vous gard', mon frère.
CHRYSALE
Et vous aussi, mon frère.
ARISTE
Savez-vous ce qui m'amène ici?
CHRYSALE
Non; mais, si vous voulez, je suis prêt à l'apprendre.
ARISTE
Depuis assez longtemps vous connaissez Clitandre?
CHRYSALE
Sans doute, et je le vois qui fréquente chez nous.
ARISTE
En quelle estime est-il, mon frère, auprès de vous?
CHRYSALE
D'homme d'honneur, d'esprit, de cœur, et de conduite,
Et je vois peu de gens qui soient de son mérite.
ARISTE
Certain désir qu'il a, conduit ici mes pas,
Et je me réjouis que vous en fassiez cas.
CHRYSALE
Je connus feu son père en mon voyage à Rome.
ARISTE
Fort bien.
CHRYSALE
C'était, mon frère, un fort bon gentilhomme.
ARISTE
On le dit.
CHRYSALE
Nous n'avions alors que vingt-huit ans,
Et nous étions, ma foi, tous deux de verts galants.
ARISTE
Je le crois.
CHRYSALE
Nous donnions chez les dames romaines,
Et tout le monde là parlait de nos fredaines;
Nous faisions des jaloux.
ARISTE
Voilà qui va des mieux:
Mais venons au sujet qui m'amène en ces lieux.
SCÈNE III
BÉLISE, CHRYSALE, ARISTE.
ARISTE
Clitandre auprès de vous me fait son interprète,
Et son cœur est épris des grâces d'Henriette.
CHRYSALE
Quoi, de ma fille?
ARISTE
Oui, Clitandre en est charmé,
Et je ne vis jamais amant plus enflammé.
BÉLISE
Non, non, je vous entends, vous ignorez l'histoire,
Et l'affaire n'est pas ce que vous pouvez croire.
ARISTE
Comment, ma sœur?
BÉLISE
Clitandre abuse vos esprits,
Et c'est d'un autre objet que son cœur est épris.
ARISTE
Vous raillez. Ce n'est pas Henriette qu'il aime?
BÉLISE
Non, j'en suis assurée.
ARISTE
Il me l'a dit lui-même.
BÉLISE
Eh oui.
ARISTE
Vous me voyez, ma sœur, chargé par lui
D'en faire la demande à son père aujourd'hui.
BÉLISE
Fort bien.
ARISTE
Et son amour même m'a fait instance
De presser les moments d'une telle alliance.
BÉLISE
Encor mieux. On ne peut tromper plus galamment.
Henriette, entre nous, est un amusement,
Un voile ingénieux, un prétexte, mon frère,
À couvrir d'autres feux dont je sais le mystère,
Et je veux bien tous deux vous mettre hors d'erreur.
ARISTE
Mais puisque vous savez tant de choses, ma sœur,
Dites-nous, s'il vous plaît, cet autre objet qu'il aime.
BÉLISE
Vous le voulez savoir?
ARISTE
Oui. Quoi?
BÉLISE
Moi.
ARISTE
Vous ?
BÉLISE
Moi-même.
ARISTE
Hay, ma sœur!
BÉLISE
Qu'est-ce donc que veut dire ce «hay»,
Et qu'a de surprenant le discours que je fai?
On est faite d'un air je pense à pouvoir dire
Qu'on n'a pas pour un cœur soumis à son empire;
Et Dorante, Damis, Cléonte, et Lycidas,
Peuvent bien faire voir qu'on a quelques appas.
ARISTE
Ces gens vous aiment?
BÉLISE
Oui, de toute leur puissance.
ARISTE
Ils vous l'ont dit?
BÉLISE
Aucun n'a pris cette licence;
Ils m'ont su révérer si fort jusqu'à ce jour,
Qu'ils ne m'ont jamais dit un mot de leur amour:
Mais pour m'offrir leur cœur, et vouer leur service,
Les muets truchements ont tous fait leur office.
ARISTE
On ne voit presque point céans venir Damis.
BÉLISE
C'est pour me faire voir un respect plus soumis.
ARISTE
De mots piquants partout Dorante vous outrage.
BÉLISE
Ce sont emportements d'une jalouse rage.
ARISTE
Cléonte et Lycidas ont pris femme tous deux.
BÉLISE
C'est par un désespoir où j'ai réduit leurs feux.
ARISTE
Ma foi! ma chère sœur, vision toute claire.
CHRYSALE
De ces chimères-là vous devez vous défaire.
BÉLISE
Ah chimères! Ce sont des chimères, dit-on!
Chimères, moi! Vraiment chimères est fort bon!
Je me réjouis fort de chimères, mes frères,
Et je ne savais pas que j'eusse des chimères.

SCÈNE IV
CHRYSALE, ARISTE.
CHRYSALE
Notre sœur est folle, oui.
ARISTE
Cela croît tous les jours.
Mais, encore une fois, reprenons le discours.
Clitandre vous demande Henriette pour femme,
Voyez quelle réponse on doit faire à sa flamme?
CHRYSALE
Faut-il le demander? J'y consens de bon cœur,
Et tiens son alliance à singulier honneur.
ARISTE
Vous savez que de bien il n'a pas l'abondance,
Que…
CHRYSALE
C'est un intérêt qui n'est pas d'importance;
Il est riche en vertu, cela vaut des trésors,
Et puis son père et moi n'étions qu'un en deux corps.
ARISTE
Parlons à votre femme, et voyons à la rendre
Favorable…
CHRYSALE
Il suffit, je l'accepte pour gendre.
ARISTE
Oui; mais pour appuyer votre consentement,
Mon frère, il n'est pas mal d'avoir son agrément,
Allons…
CHRYSALE
Vous moquez-vous? Il n'est pas nécessaire,
Je réponds de ma femme, et prends sur moi l'affaire.
ARISTE
Mais…
CHRYSALE
Laissez faire, dis-je, et n'appréhendez pas.
Je la vais disposer aux choses de ce pas.
ARISTE
Soit. Je vais là-dessus sonder votre Henriette,
Et reviendrai savoir…
CHRYSALE
C'est une affaire faite.
Et je vais à ma femme en parler sans délai.
SCÈNE V
MARTINE, CHRYSALE.
MARTINE
Me voilà bien chanceuse! Hélas l'an dit bien vrai:
Qui veut noyer son chien, l'accuse de la rage,
Et service d'autrui n'est pas un héritage.
CHRYSALE
Qu'est-ce donc? Qu'avez-vous, Martine?
MARTINE
Ce que j'ai?
CHRYSALE
Oui?
MARTINE
J'ai que l'an me donne aujourd'hui mon congé,
Monsieur.
CHRYSALE
Votre congé!
MARTINE
Oui, Madame me chasse.
CHRYSALE
Je n'entends pas cela. Comment?
MARTINE
On me menace,
Si je ne sors d'ici, de me bailler cent coups.
CHRYSALE
Non, vous demeurerez, je suis content de vous;
Ma femme bien souvent a la tête un peu chaude,
Et je ne veux pas moi…
SCÈNE VI
PHILAMINTE, BÉLISE, CHRYSALE, MARTINE.
PHILAMINTE
Quoi, je vous vois, maraude?
Vite, sortez, friponne; allons, quittez ces lieux,
Et ne vous présentez jamais devant mes yeux.
CHRYSALE
Tout doux.
PHILAMINTE
Non, c'en est fait.
CHRYSALE
Eh.
PHILAMINTE
Je veux qu'elle sorte.
CHRYSALE
Mais qu'a-t-elle commis, pour vouloir de la sorte…
PHILAMINTE Quoi, vous la soutenez?
CHRYSALE
En aucune façon.
PHILAMINTE
Prenez-vous son parti contre moi?
CHRYSALE
Mon Dieu non;
Je ne fais seulement que demander son crime.
PHILAMINTE
Suis-je pour la chasser sans cause légitime?
CHRYSALE
Je ne dis pas cela, mais il faut de nos gens…
PHILAMINTE
Non, elle sortira, vous dis-je, de céans.
CHRYSALE
Hé bien oui. Vous dit-on quelque chose là contre?
PHILAMINTE
Je ne veux point d'obstacle aux désirs que je montre.
CHRYSALE
D'accord.
PHILAMINTE
Et vous devez en raisonnable époux,
Être pour moi contre elle et prendre mon courroux.
CHRYSALE
Aussi fais-je. Oui, ma femme avec raison vous chasse,
Coquine, et votre crime est indigne de grâce.
MARTINE
Qu'est-ce donc que j'ai fait?
CHRYSALE
Ma foi! Je ne sais pas.
PHILAMINTE
Elle est d'humeur encore à n'en faire aucun cas.
CHRYSALE
A-t-elle, pour donner matière à votre haine,
Cassé quelque miroir, ou quelque porcelaine?
PHILAMINTE
Voudrais-je la chasser, et vous figurez-vous
Que pour si peu de chose on se mette en courroux?
CHRYSALE
Qu'est-ce à dire? L'affaire est donc considérable?
PHILAMINTE
Sans doute. Me voit-on femme déraisonnable?
CHRYSALE
Est-ce qu'elle a laissé, d'un esprit négligent,
Dérober quelque aiguière, ou quelque plat d'argent?
PHILAMINTE
Cela ne serait rien.
CHRYSALE
Oh, oh! peste, la belle!
Quoi? l'avez-vous surprise à n'être pas fidèle?
PHILAMINTE
C'est pis que tout cela.
CHRYSALE
Pis que tout cela?
PHILAMINTE
Pis.
CHRYSALE
Comment diantre, friponne! Euh? a-t-elle commis…
PHILAMINTE
Elle a, d'une insolence à nulle autre pareille,
Après trente leçons, insulté mon oreille,
Par l'impropriété d'un mot sauvage et bas,
Qu'en termes décisifs condamne Vaugelas.
CHRYSALE
Est-ce là…
PHILAMINTE
Quoi, toujours malgré nos remontrances,
Heurter le fondement de toutes les sciences;
La grammaire qui sait régenter jusqu'aux rois,
Et les fait la main haute obéir à ses lois?
CHRYSALE
Du plus grand des forfaits je la croyais coupable.
PHILAMINTE
Quoi, vous ne trouvez pas ce crime impardonnable?
CHRYSALE
Si fait.
PHILAMINTE
Je voudrais bien que vous l'excusassiez.
CHRYSALE
Je n'ai garde.
BÉLISE
Il est vrai que ce sont des pitiés,
Toute construction est par elle détruite,
Et des lois du langage on l'a cent fois instruite.
MARTINE
Tout ce que vous prêchez est je crois bel et bon;
Mais je ne saurais, moi, parler votre jargon.
PHILAMINTE
L'impudente! appeler un jargon le langage
Fondé sur la raison et sur le bel usage!
MARTINE
Quand on se fait entendre, on parle toujours bien,
Et tous vos biaux dictons ne servent pas de rien.
PHILAMINTE
Hé bien, ne voilà pas encore de son style,
Ne servent-pas de rien!
BÉLISE
Ô cervelle indocile!
Faut-il qu'avec les soins qu'on prend incessamment,
On ne te puisse apprendre à parler congrûment?
De pas, mis avec rien, tu fais la récidive,
Et c'est, comme on t'a dit, trop d'une négative.
MARTINE
Mon Dieu, je n'avons pas étugué comme vous,
Et je parlons tout droit comme on parle cheux nous.
PHILAMINTE
Ah peut-on y tenir!
BÉLISE
Quel solécisme horrible!
PHILAMINTE
En voilà pour tuer une oreille sensible.
BÉLISE
Ton esprit, je l'avoue, est bien matériel.
Je, n'est qu'un singulier; avons, est pluriel.
Veux-tu toute ta vie offenser la grammaire?
MARTINE
Qui parle d'offenser grand'mère ni grand-père?
PHILAMINTE
Ô Ciel!
BÉLISE
Grammaire est prise à contre-sens par toi,
Et je t'ai dit déjà d'où vient ce mot.
MARTINE
Ma foi,
Qu'il vienne de Chaillot, d'Auteuil, ou de Pontoise,
Cela ne me fait rien.
BÉLISE
Quelle âme villageoise!
La grammaire, du verbe et du nominatif,
Comme de l'adjectif avec le substantif,
Nous enseigne les lois.
MARTINE
J'ai, Madame, à vous dire
Que je ne connais point ces gens-là.
PHILAMINTE
Quel martyre!
BÉLISE
Ce sont les noms des mots, et l'on doit regarder
En quoi c'est qu'il les faut faire ensemble accorder.
MARTINE
Qu'ils s'accordent entr'eux, ou se gourment, qu'importe?
PHILAMINTE, à sa sœur.
Eh, mon Dieu, finissez un discours de la sorte. (À son mari.)
Vous ne voulez pas, vous, me la faire sortir?
CHRYSALE
Si fait. À son caprice il me faut consentir.
Va, ne l'irrite point; retire-toi, Martine.
PHILAMINTE
Comment? vous avez peur d'offenser la coquine?
Vous lui parlez d'un ton tout à fait obligeant?
CHRYSALE, bas.
Moi? Point. Allons, sortez. Va-t'en, ma pauvre enfant.

SCÈNE VII
PHILAMINTE, CHRYSALE, BÉLISE.
CHRYSALE
Vous êtes satisfaite, et la voilà partie.
Mais je n'approuve point une telle sortie;
C'est une fille propre aux choses qu'elle fait,
Et vous me la chassez pour un maigre sujet.
PHILAMINTE
Vous voulez que toujours je l'aie à mon service,
Pour mettre incessamment mon oreille au supplice?
Pour rompre toute loi d'usage et de raison,
Par un barbare amas de vices d'oraison,
De mots estropiés, cousus par intervalles,
De proverbes traînés dans les ruisseaux des Halles?
BÉLISE
Il est vrai que l'on sue à souffrir ses discours.
Elle y met Vaugelas en pièces tous les jours;
Et les moindres défauts de ce grossier génie,
Sont ou le pléonasme, ou la cacophonie.
CHRYSALE
Qu'importe qu'elle manque aux lois de Vaugelas,
Pourvu qu'à la cuisine elle ne manque pas?
J'aime bien mieux, pour moi, qu'en épluchant ses herbes,
Elle accommode mal les noms avec les verbes,
Et redise cent fois un bas ou méchant mot,
Que de brûler ma viande, ou saler trop mon pot.
Je vis de bonne soupe, et non de beau langage.
Vaugelas n'apprend point à bien faire un potage,
Et Malherbe et Balzac, si savants en beaux mots,
En cuisine peut-être auraient été des sots.
PHILAMINTE
Que ce discours grossier terriblement assomme!
Et quelle indignité pour ce qui s'appelle homme,
D'être baissé sans cesse aux soins matériels,
Au lieu de se hausser vers les spirituels!
Le corps, cette guenille, est-il d'une importance,
D'un prix à mériter seulement qu'on y pense,
Et ne devons-nous pas laisser cela bien loin?
CHRYSALE
Oui, mon corps est moi-même, et j'en veux prendre soin,
Guenille si l'on veut, ma guenille m'est chère.
BÉLISE
Le corps avec l'esprit, fait figure, mon frère;
Mais si vous en croyez tout le monde savant,
L'esprit doit sur le corps prendre le pas devant;
Et notre plus grand soin, notre première instance,
Doit être à le nourrir du suc de la science.
CHRYSALE
Ma foi si vous songez à nourrir votre esprit,
C'est de viande bien creuse, à ce que chacun dit,
Et vous n'avez nul soin, nulle sollicitude
Pour…
PHILAMINTE
Ah sollicitude à mon oreille est rude,
Il pue étrangement son ancienneté.
BÉLISE
Il est vrai que le mot est bien collet monté.
CHRYSALE
Voulez-vous que je dise? Il faut qu'enfin j'éclate,
Que je lève le masque, et décharge ma rate.
De folles on vous traite, et j'ai fort sur le cœur…
PHILAMINTE
Comment donc?
CHRYSALE.
C'est à vous que je parle, ma sœur.
Le moindre solécisme en parlant vous irrite:
Mais vous en faites, vous, d'étranges en conduite.
Vos livres éternels ne me contentent pas,
Et hors un gros Plutarque à mettre mes rabats,
Vous devriez brûler tout ce meuble inutile,
Et laisser la science aux docteurs de la ville;
M'ôter, pour faire bien, du grenier de céans,
Cette longue lunette à faire peur aux gens,
Et cent brimborions dont l'aspect importune:
Ne point aller chercher ce qu'on fait dans la lune,
Et vous mêler un peu de ce qu'on fait chez vous,
Où nous voyons aller tout sens dessus dessous.
Il n'est pas bien honnête, et pour beaucoup de causes,
Qu'une femme étudie, et sache tant de choses.
Former aux bonnes mœurs l'esprit de ses enfants,
Faire aller son ménage, avoir l'œil sur ses gens,
Et régler la dépense avec économie,
Doit être son étude et sa philosophie.
Nos pères sur ce point étaient gens bien sensés,
Qui disaient qu'une femme en sait toujours assez,
Quand la capacité de son esprit se hausse
À connaître un pourpoint d'avec un haut de chausse.
Les leurs ne lisaient point, mais elles vivaient bien;
Leurs ménages étaient tout leur docte entretien,
Et leurs livres un dé, du fil, et des aiguilles,
Dont elles travaillaient au trousseau de leurs filles.
Les femmes d'à présent sont bien loin de ces mœurs,
Elles veulent écrire, et devenir auteurs.
Nulle science n'est pour elles trop profonde,
Et céans beaucoup plus qu'en aucun lieu du monde.
Les secrets les plus hauts s'y laissent concevoir,
Et l'on sait tout chez moi, hors ce qu'il faut savoir.
On y sait comme vont lune, étoile polaire,
Vénus, Saturne, et Mars, dont je n'ai point affaire;
Et dans ce vain savoir, qu'on va chercher si loin,
On ne sait comme va mon pot dont j'ai besoin.
Mes gens à la science aspirent pour vous plaire,
Et tous ne font rien moins que ce qu'ils ont à faire;
Raisonner est l'emploi de toute ma maison,
Et le raisonnement en bannit la raison;
L'un me brûle mon rôt en lisant quelque histoire,
L'autre rêve à des vers quand je demande à boire;
Enfin je vois par eux votre exemple suivi,
Et j'ai des serviteurs, et ne suis point servi.
Une pauvre servante au moins m'était restée,
Qui de ce mauvais air n'était point infectée,
Et voilà qu'on la chasse avec un grand fracas,
À cause qu'elle manque à parler Vaugelas.
Je vous le dis, ma sœur, tout ce train-là me blesse,
(Car c'est, comme j'ai dit, à vous que je m'adresse);
Je n'aime point céans tous vos gens à latin,
Et principalement ce Monsieur Trissotin.
C'est lui qui dans des vers vous a tympanisées,
Tous les propos qu'il tient sont des billevesées,
On cherche ce qu'il dit après qu'il a parlé,
Et je lui crois, pour moi, le timbre un peu fêlé.
PHILAMINTE
Quelle bassesse, ô Ciel, et d'âme, et de langage!
BÉLISE
Est-il de petits corps un plus lourd assemblage!
Un esprit composé d'atomes plus bourgeois!
Et de ce même sang se peut-il que je sois!
Je me veux mal de mort d'être de votre race,
Et de confusion j'abandonne la place.
SCÈNE VIII
PHILAMINTE, CHRYSALE.
PHILAMINTE
Avez-vous à lâcher encore quelque trait?
CHRYSALE
Moi? Non. Ne parlons plus de querelle, c'est fait;
Discourons d'autre affaire. À votre fille aînée
On voit quelque dégoût pour les nœuds d'hyménée;
C'est une philosophe enfin, je n'en dis rien,
Elle est bien gouvernée, et vous faites fort bien.
Mais de toute autre humeur se trouve sa cadette,
Et je crois qu'il est bon de pourvoir Henriette,
De choisir un mari…
PHILAMINTE
C'est à quoi j'ai songé, Et je veux vous ouvrir l'intention que j'ai.
Ce Monsieur Trissotin dont on nous fait un crime,
Et qui n'a pas l'honneur d'être dans votre estime,
Est celui que je prends pour l'époux qu'il lui faut,
Et je sais mieux que vous juger de ce qu'il vaut;
La contestation est ici superflue,
Et de tout point chez moi l'affaire est résolue.
Au moins ne dites mot du choix de cet époux,
Je veux à votre fille en parler avant vous.
J'ai des raisons à faire approuver ma conduite,
Et je connaîtrai bien si vous l'aurez instruite.
SCÈNE IX
ARISTE, CHRYSALE.
ARISTE
Hé bien? la femme sort, mon frère, et je vois bien
Que vous venez d'avoir ensemble un entretien.
CHRYSALE
Oui.
ARISTE
Quel est le succès? Aurons-nous Henriette?
A-t-elle consenti? l'affaire est-elle faite?
CHRYSALE
Pas tout à fait encor.
ARISTE
Refuse-t-elle?
CHRYSALE
Non.
ARISTE
Est-ce qu'elle balance?
CHRYSALE
En aucune façon.
ARISTE
Quoi donc?
CHRYSALE
C'est que pour gendre elle m'offre un autre homme.
ARISTE
Un autre homme pour gendre!
CHRYSALE
Un autre.
ARISTE
Qui se nomme ?
CHRYSALE
Monsieur Trissotin.
ARISTE
Quoi? ce Monsieur Trissotin…
CHRYSALE
Oui, qui parle toujours de vers et de latin.
ARISTE
Vous l'avez accepté?
CHRYSALE
Moi, point, à Dieu ne plaise.
ARISTE
Qu'avez-vous répondu?
CHRYSALE
Rien; et je suis bien aise
De n'avoir point parlé, pour ne m'engager pas!
ARISTE
La raison est fort belle, et c'est faire un grand pas.
Avez-vous su du moins lui proposer Clitandre?
CHRYSALE
Non: car comme j'ai vu qu'on parlait d'autre gendre,
J'ai cru qu'il était mieux de ne m'avancer point.
ARISTE
Certes votre prudence est rare au dernier point!
N'avez-vous point de honte avec votre mollesse?
Et se peut-il qu'un homme ait assez de faiblesse
Pour laisser à sa femme un pouvoir absolu,
Et n'oser attaquer ce qu'elle a résolu?
CHRYSALE
Mon Dieu, vous en parlez, mon frère, bien à l'aise,
Et vous ne savez pas comme le bruit me pèse.
J'aime fort le repos, la paix, et la douceur,
Et ma femme est terrible avecque son humeur.
Du nom de philosophe elle fait grand mystère,
Mais elle n'en est pas pour cela moins colère;
Et sa morale faite à mépriser le bien,
Sur l'aigreur de sa bile opère comme rien.
Pour peu que l'on s'oppose à ce que veut sa tête,
On en a pour huit jours d'effroyable tempête.
Elle me fait trembler dès qu'elle prend son ton.
Je ne sais où me mettre, et c'est un vrai dragon;
Et cependant avec toute sa diablerie,
Il faut que je l'appelle, et «mon cœur», et «ma mie».
ARISTE
Allez, c'est se moquer. Votre femme, entre nous,
Est par vos lâchetés souveraine sur vous.
Son pouvoir n'est fondé que sur votre faiblesse.
C'est de vous qu'elle prend le titre de maîtresse.
Vous-même à ses hauteurs vous vous abandonnez,
Et vous faites mener en bête par le nez.
Quoi, vous ne pouvez pas, voyant comme on vous nomme,
Vous résoudre une fois à vouloir être un homme?
À faire condescendre une femme à vos vœux,
Et prendre assez de cœur pour dire un: «Je le veux»?
Vous laisserez sans honte immoler votre fille
Aux folles visions qui tiennent la famille,
Et de tout votre bien revêtir un nigaud,
Pour six mots de latin qu'il leur fait sonner haut?
Un pédant qu'à tous coups votre femme apostrophe
Du nom de bel esprit, et de grand philosophe,
D'homme qu'en vers galants jamais on n'égala,
Et qui n'est, comme on sait, rien moins que tout cela?
Allez, encore un coup, c'est une moquerie,
Et votre lâcheté mérite qu'on en rie.
CHRYSALE
Oui, vous avez raison, et je vois que j'ai tort.
Allons, il faut enfin montrer un cœur plus fort,
Mon frère.
ARISTE
C'est bien dit.
CHRYSALE
C'est une chose infâme,
Que d'être si soumis au pouvoir d'une femme.
ARISTE
Fort bien.
CHRYSALE
De ma douceur elle a trop profité.
ARISTE
Il est vrai.
CHRYSALE
Trop joui de ma facilité.
ARISTE
Sans doute.
CHRYSALE
Et je lui veux faire aujourd'hui connaître
Que ma fille est ma fille, et que j'en suis le maître,
Pour lui prendre un mari qui soit selon mes vœux.
ARISTE
Vous voilà raisonnable, et comme je vous veux.
CHRYSALE
Vous êtes pour Clitandre, et savez sa demeure;
Faites-le-moi venir, mon frère, tout à l'heure.
ARISTE
J'y cours tout de ce pas.
CHRYSALE
C'est souffrir trop longtemps,
Et je m'en vais être homme à la barbe des gens.
ACTE III, SCÈNE PREMIÈRE
PHILAMINTE, ARMANDE, BÉLISE, TRISSOTIN, L'ÉPINE.
PHILAMINTE
Ah mettons-nous ici pour écouter à l'aise
Ces vers que mot à mot il est besoin qu'on pèse.
ARMANDE
Je brûle de les voir.
BÉLISE
Et l'on s'en meurt chez nous.
PHILAMINTE
Ce sont charmes pour moi, que ce qui part de vous.
ARMANDE
Ce m'est une douceur à nulle autre pareille.
BÉLISE
Ce sont repas friands qu'on donne à mon oreille.
PHILAMINTE
Ne faites point languir de si pressants désirs.
ARMANDE
Dépêchez.
BÉLISE
Faites tôt, et hâtez nos plaisirs.
PHILAMINTE
À notre impatience offrez votre épigramme.
TRISSOTIN
Hélas, c'est un enfant tout nouveau-né, Madame.
Son sort assurément a lieu de vous toucher,
Et c'est dans votre cour que j'en viens d'accoucher.
PHILAMINTE
Pour me le rendre cher, il suffit de son père.
TRISSOTIN
Votre approbation lui peut servir de mère.
BÉLISE
Qu'il a d'esprit!

SCÈNE II
HENRIETTE, PHILAMINTE, ARMANDE, BÉLISE, TRISSOTIN, L'ÉPINE.
PHILAMINTE
Holà, pourquoi donc fuyez-vous?
HENRIETTE
C'est de peur de troubler un entretien si doux.
PHILAMINTE
Approchez, et venez de toutes vos oreilles
Prendre part au plaisir d'entendre des merveilles.
HENRIETTE
Je sais peu les beautés de tout ce qu'on écrit,
Et ce n'est pas mon fait que les choses d'esprit.
PHILAMINTE
Il n'importe; aussi bien ai-je à vous dire ensuite
Un secret dont il faut que vous soyez instruite.
TRISSOTIN
Les sciences n'ont rien qui vous puisse enflammer,
Et vous ne vous piquez que de savoir charmer.
HENRIETTE
Aussi peu l'un que l'autre, et je n'ai nulle envie…
BÉLISE
Ah songeons à l'enfant nouveau-né, je vous prie.
PHILAMINTE
Allons, petit garçon, vite, de quoi s'asseoir. Le laquais tombe avec la chaise.
Voyez l'impertinent! Est-ce que l'on doit choir,
Après avoir appris l'équilibre des choses?
BÉLISE
De ta chute, ignorant, ne vois-tu pas les causes,
Et qu'elle vient d'avoir du point fixe écarté,
Ce que nous appelons centre de gravité?
L'ÉPINE
Je m'en suis aperçu, Madame, étant par terre.
PHILAMINTE
Le lourdaud!
TRISSOTIN
Bien lui prend de n'être pas de verre.
ARMANDE
Ah de l'esprit partout!
BÉLISE
Cela ne tarit pas.
PHILAMINTE
Servez-nous promptement votre aimable repas.
TRISSOTIN
Pour cette grande faim qu'à mes yeux on expose,
Un plat seul de huit vers me semble peu de chose,
Et je pense qu'ici je ne ferai pas mal,
De joindre à l'épigramme, ou bien au madrigal,
Le ragoût d'un sonnet, qui chez une princesse
A passé pour avoir quelque délicatesse.
Il est de sel attique assaisonné partout,
Et vous le trouverez, je crois, d'assez bon goût.
ARMANDE
Ah Je n'en doute point.
PHILAMINTE
Donnons vite audience.
BÉLISE À chaque fois qu'il veut lire, elle l'interrompt.
Je sens d'aise mon cœur tressaillir par avance.
J'aime la poésie avec entêtement.
Et surtout quand les vers sont tournés galamment.
PHILAMINTE
Si nous parlons toujours, il ne pourra rien dire.
TRISSOTIN
SO…
BÉLISE
Silence, ma nièce.
TRISSOTIN
SONNET À LA PRINCESSE URANIE
SUR SA FIÈVRE
Votre prudence est endormie,
De traiter magnifiquement,
Et de loger superbement
Votre plus cruelle ennemie.
BÉLISE
Ah le joli début!
ARMANDE
Qu'il a le tour galant!
PHILAMINTE
Lui seul des vers aisés possède le talent!
ARMANDE
À prudence endormie il faut rendre les armes.
BÉLISE
Loger son ennemie est pour moi plein de charmes.
PHILAMINTE
J'aime superbement et magnifiquement;
Ces deux adverbes joints font admirablement.
BÉLISE
Prêtons l'oreille au reste.
TRISSOTIN
Votre prudence est endormie,
De traiter magnifiquement,
Et de loger superbement
Votre plus cruelle ennemie.
ARMANDE
Prudence endormie!
BÉLISE
Loger son ennemie!
PHILAMINTE
Superbement, et magnifiquement!
TRISSOTIN
Faites-la sortir, quoi qu'on die,
De votre riche appartement,
Où cette ingrate insolemment
Attaque votre belle vie.
BÉLISE
Ah tout doux, laissez-moi, de grâce, respirer.
ARMANDE
Donnez-nous, s'il vous plaît, le loisir d'admirer.
PHILAMINTE
On se sent à ces vers, jusques au fond de l'âme,
Couler je ne sais quoi qui fait que l'on se pâme.
ARMANDE
Faites-la sortir, quoi qu'on die,
De votre riche appartement.
Que riche appartement est là joliment dit!
Et que la métaphore est mise avec esprit!
PHILAMINTE
Faites-la sortir, quoi qu'on die.
Ah! que ce quoi qu'on die est d'un goût admirable!
C'est, à mon sentiment, un endroit impayable.
ARMANDE
De quoi qu'on die aussi mon cœur est amoureux.
BÉLISE
Je suis de votre avis, quoi qu'on die est heureux.
ARMANDE
Je voudrais l'avoir fait.
BÉLISE
Il vaut toute une pièce.
PHILAMINTE
Mais en comprend-on bien comme moi la finesse?
ARMANDE et BÉLISE
Oh, oh.
PHILAMINTE
Faites-la sortir, quoi qu'on die.
Que de la fièvre on prenne ici les intérêts,
N'ayez aucun égard, moquez-vous des caquets.
Faites-la sortir, quoi qu'on die.
Quoi qu'on die, quoi qu'on die.
Ce quoi qu'on die en dit beaucoup plus qu'il ne semble.
Je ne sais pas, pour moi, si chacun me ressemble;
Mais j'entends là-dessous un million de mots.
BÉLISE
Il est vrai qu'il dit plus de choses qu'il n'est gros.
PHILAMINTE
Mais quand vous avez fait ce charmant quoi qu'on die,
Avez-vous compris, vous, toute son énergie?
Songiez-vous bien vous-même à tout ce qu'il nous dit,
Et pensiez-vous alors y mettre tant d'esprit?
TRISSOTIN
Hay, hay.
ARMANDE
J'ai fort aussi l'ingrate dans la tête,
Cette ingrate de fièvre, injuste, malhonnête,
Qui traite mal les gens, qui la logent chez eux.
PHILAMINTE
Enfin les quatrains sont admirables tous deux.
Venons-en promptement aux tiercets, je vous prie.
ARMANDE
Ah, s'il vous plaît, encore une fois quoi qu'on die.
TRISSOTIN
Faites-la sortir, quoi qu'on die,
PHILAMINTE, ARMANDE et BÉLISE
Quoi qu'on die!
TRISSOTIN
De votre riche appartement,
PHILAMINTE, ARMANDE et BÉLISE
Riche appartement!
TRISSOTIN
Où cette ingrate insolemment
PHILAMINTE, ARMANDE et BÉLISE
Cette ingrate de fièvre?
TRISSOTIN
Attaque votre belle vie.
PHILAMINTE
Votre belle vie!
ARMANDE et BÉLISE
Ah!
TRISSOTIN
Quoi, sans respecter votre rang,
Elle se prend à votre sang,
PHILAMINTE, ARMANDE et BÉLISE
Ah!
TRISSOTIN
Et nuit et jour vous fait outrage
Si vous la conduisez aux bains,
Sans la marchander davantage,
Noyez-la de vos propres mains.
PHILAMINTE
On n'en peut plus !
BÉLISE
On pâme.
ARMANDE
On se meurt de plaisir.
PHILAMINTE
De mille doux frissons vous vous sentez saisir.
ARMANDE
Si vous la conduisez aux bains,
BÉLISE
Sans la marchander davantage,
PHILAMINTE
Noyez-la de vos propres mains.
De vos propres mains, là, noyez-la dans les bains.
ARMANDE
Chaque pas dans vos vers rencontre un trait charmant.
BÉLISE
Partout on s'y promène avec ravissement.
PHILAMINTE
On n'y saurait marcher que sur de belles choses.
ARMANDE
Ce sont petits chemins tout parsemés de roses.
TRISSOTIN
Le sonnet donc vous semble…
PHILAMINTE
Admirable, nouveau,
Et personne jamais n'a rien fait de si beau.
BÉLISE
Quoi, sans émotion pendant cette lecture?
Vous faites là, ma nièce, une étrange figure!
HENRIETTE
Chacun fait ici-bas la figure qu'il peut,
Ma tante; et bel esprit, il ne l'est pas qui veut.
TRISSOTIN
Peut-être que mes vers importunent Madame.
HENRIETTE
Point, je n'écoute pas.
PHILAMINTE
Ah? voyons l'épigramme.
TRISSOTIN
SUR UN CARROSSE DE COULEUR AMARANTE
DONNÉ À UNE DAME DE SES AMIES.
PHILAMINTE
Ces titres ont toujours quelque chose de rare.
ARMANDE
À cent beaux traits d'esprit leur nouveauté prépare.
TRISSOTIN
L'amour si chèrement m'a vendu son lien,
BÉLISE, ARMANDE et PHILAMINTE
Ah!
TRISSOTIN
Qu'il m'en coûte déjà la moitié de mon bien.
Et quand tu vois ce beau carrosse
Où tant d'or se relève en bosse,
Qu'il étonne tout le pays,
Et fait pompeusement triompher ma Laïs,
PHILAMINTE
Ah ma Laïs! voilà de l'érudition.
BÉLISE
L'enveloppe est jolie, et vaut un million.
TRISSOTIN
Et quand tu vois ce beau carrosse,
Où tant d'or se relève en bosse,
Qu'il étonne tout le pays,
Et fait pompeusement triompher ma Laïs,
Ne dis plus qu'il est amarante:
Dis plutôt qu'il est de ma rente.
ARMANDE
Oh, oh, oh! celui-là ne s'attend point du tout.
PHILAMINTE
On n'a que lui qui puisse écrire de ce goût.
BÉLISE
Ne dis plus qu'il est amarante:
Dis plutôt qu'il est de ma rente.
Voilà qui se décline: ma rente, de ma rente, à ma rente.
PHILAMINTE
Je ne sais du moment que je vous ai connu,
Si sur votre sujet j'ai l'esprit prévenu,
Mais j'admire partout vos vers et votre prose.
TRISSOTIN
Si vous vouliez de vous nous montrer quelque chose,
À notre tour aussi nous pourrions admirer.
PHILAMINTE
Je n'ai rien fait en vers, mais j'ai lieu d'espérer
Que je pourrai bientôt vous montrer en amie,
Huit chapitres du plan de notre Académie.
Platon s'est au projet simplement arrêté,
Quand de sa République il a fait le traité;
Mais à l'effet entier je veux pousser l'idée
Que j'ai sur le papier en prose accommodée,
Car enfin je me sens un étrange dépit
Du tort que l'on nous fait du côté de l'esprit,
Et je veux nous venger toutes tant que nous sommes
De cette indigne classe où nous rangent les hommes;
De borner nos talents à des futilités,
Et nous fermer la porte aux sublimes clartés.
ARMANDE
C'est faire à notre sexe une trop grande offense,
De n'étendre l'effort de notre intelligence,
Qu'à juger d'une jupe, et de l'air d'un manteau,
Ou des beautés d'un point, ou d'un brocart nouveau.
BÉLISE
Il faut se relever de ce honteux partage,
Et mettre hautement notre esprit hors de page.
TRISSOTIN
Pour les dames on sait mon respect en tous lieux,
Et si je rends hommage aux brillants de leurs yeux,
De leur esprit aussi j'honore les lumières.
PHILAMINTE
Le sexe aussi vous rend justice en ces matières;
Mais nous voulons montrer à de certains esprits,
Dont l'orgueilleux savoir nous traite avec mépris,
Que de science aussi les femmes sont meublées,
Qu'on peut faire comme eux de doctes assemblées,
Conduites en cela par des ordres meilleurs,
Qu'on y veut réunir ce qu'on sépare ailleurs;
Mêler le beau langage, et les hautes sciences;
Découvrir la nature en mille expériences;
Et sur les questions qu'on pourra proposer
Faire entrer chaque secte, et n'en point épouser.
TRISSOTIN
Je m'attache pour l'ordre au péripatétisme.
PHILAMINTE
Pour les abstractions j'aime le platonisme.
ARMANDE
Épicure me plaît, et ses dogmes sont forts.
BÉLISE
Je m'accommode assez pour moi des petits corps;
Mais le vide à souffrir me semble difficile,
Et je goûte bien mieux la matière subtile.
TRISSOTIN
Descartes pour l'aimant donne fort dans mon sens.
ARMANDE
J'aime ses tourbillons.
PHILAMINTE
Moi ses mondes tombants.
ARMANDE
Il me tarde de voir notre assemblée ouverte,
Et de nous signaler par quelque découverte.
TRISSOTIN
On en attend beaucoup de vos vives clartés,
Et pour vous la nature a peu d'obscurités.
PHILAMINTE
Pour moi, sans me flatter, j'en ai déjà fait une,
Et j'ai vu clairement des hommes dans la lune.
BÉLISE
Je n'ai point encor vu d'hommes, comme je croi,
Mais j'ai vu des clochers tout comme je vous voi.
ARMANDE
Nous approfondirons, ainsi que la physique,
Grammaire, histoire, vers, morale, et politique.
PHILAMINTE
La morale a des traits dont mon cœur est épris,
Et c'était autrefois l'amour des grands esprits;
Mais aux stoïciens je donne l'avantage,
Et je ne trouve rien de si beau que leur sage.
ARMANDE
Pour la langue, on verra dans peu nos règlements,
Et nous y prétendons faire des remuements.
Par une antipathie ou juste, ou naturelle,
Nous avons pris chacune une haine mortelle
Pour un nombre de mots, soit ou verbes, ou noms,
Que mutuellement nous nous abandonnons;
Contre eux nous préparons de mortelles sentences,
Et nous devons ouvrir nos doctes conférences
Par les proscriptions de tous ces mots divers,
Dont nous voulons purger et la prose et les vers.
PHILAMINTE
Mais le plus beau projet de notre académie,
Une entreprise noble et dont je suis ravie;
Un dessein plein de gloire, et qui sera vanté
Chez tous les beaux esprits de la postérité,
C'est le retranchement de ces syllabes sales,
Qui dans les plus beaux mots produisent des scandales;
Ces jouets éternels des sots de tous les temps;
Ces fades lieux communs de nos méchants plaisants;
Ces sources d'un amas d'équivoques infâmes,
Dont on vient faire insulte à la pudeur des femmes.
TRISSOTIN
Voilà certainement d'admirables projets!
BÉLISE
Vous verrez nos statuts quand ils seront tous faits.
TRISSOTIN
Ils ne sauraient manquer d'être tous beaux et sages.
ARMANDE
Nous serons par nos lois les juges des ouvrages.
Par nos lois, prose et vers, tout nous sera soumis.
Nul n'aura de l'esprit, hors nous et nos amis.
Nous chercherons partout à trouver à redire,
Et ne verrons que nous qui sache bien écrire.
SCÈNE III
L'ÉPINE, TRISSOTIN, PHILAMINTE, BÉLISE, ARMANDE, HENRIETTE, VADIUS.
L'ÉPINE
Monsieur, un homme est là qui veut parler à vous,
Il est vêtu de noir, et parle d'un ton doux.
TRISSOTIN
C'est cet ami savant qui m'a fait tant d'instance
De lui donner l'honneur de votre connaissance.
PHILAMINTE
Pour le faire venir, vous avez tout crédit.
Faisons bien les honneurs au moins de notre esprit.
Holà. Je vous ai dit en paroles bien claires,
Que j'ai besoin de vous.
HENRIETTE
Mais pour quelles affaires?
PHILAMINTE
Venez, on va dans peu vous les faire savoir.
TRISSOTIN
Voici l'homme qui meurt du désir de vous voir.
En vous le produisant, je ne crains point le blâme
D'avoir admis chez vous un profane, Madame,
Il peut tenir son coin parmi de beaux esprits.
PHILAMINTE
La main qui le présente, en dit assez le prix.
TRISSOTIN
Il a des vieux auteurs la pleine intelligence,
Et sait du grec, Madame, autant qu'homme de France.
PHILAMINTE
Du grec, ô Ciel! du grec! Il sait du grec, ma sœur!
BÉLISE
Ah, ma nièce, du grec!
ARMANDE
Du grec! quelle douceur!
PHILAMINTE
Quoi, Monsieur sait du grec? Ah permettez, de grâce
Que pour l'amour du grec, Monsieur, on vous embrasse.
Il les baise toutes, jusques à Henriette qui le refuse.
HENRIETTE
Excusez-moi, Monsieur, je n'entends pas le grec.
PHILAMINTE
J'ai pour les livres grecs un merveilleux respect.
VADIUS
Je crains d'être fâcheux, par l'ardeur qui m'engage
À vous rendre aujourd'hui, Madame, mon hommage,
Et j'aurais pu troubler quelque docte entretien.
PHILAMINTE
Monsieur, avec du grec on ne peut gâter rien.
TRISSOTIN
Au reste il fait merveille en vers ainsi qu'en prose,
Et pourrait, s'il voulait, vous montrer quelque chose.
VADIUS
Le défaut des auteurs, dans leurs productions,
C'est d'en tyranniser les conversations;
D'être au Palais, au Cours, aux ruelles, aux tables,
De leurs vers fatigants lecteurs infatigables.
Pour moi je ne vois rien de plus sot à mon sens,
Qu'un auteur qui partout va gueuser des encens,
Qui des premiers venus saisissant les oreilles,
En fait le plus souvent les martyrs de ses veilles.
On ne m'a jamais vu ce fol entêtement,
Et d'un Grec là-dessus je suis le sentiment,
Qui par un dogme exprès défend à tous ses sages
L'indigne empressement de lire leurs ouvrages.
Voici de petits vers pour de jeunes amants,
Sur quoi je voudrais bien avoir vos sentiments.
TRISSOTIN
Vos vers ont des beautés que n'ont point tous les autres.
VADIUS
Les grâces et Vénus règnent dans tous les vôtres.
TRISSOTIN
Vous avez le tour libre, et le beau choix des mots.
VADIUS
On voit partout chez vous l'ithos et le pathos.
TRISSOTIN
Nous avons vu de vous des églogues d'un style,
Qui passe en doux attraits Théocrite et Virgile.
VADIUS
Vos odes ont un air noble, galant et doux,
Qui laisse de bien loin votre Horace après vous.
TRISSOTIN
Est-il rien d'amoureux comme vos chansonnettes?
VADIUS
Peut-on voir rien d'égal aux sonnets que vous faites?
TRISSOTIN
Rien qui soit plus charmant que vos petits rondeaux?
VADIUS
Rien de si plein d'esprit que tous vos madrigaux?
TRISSOTIN
VADIUS
Aux ballades surtout vous êtes admirable.
Et dans les bouts-rimés je vous trouve adorable.
TRISSOTIN
Si la France pouvait connaître votre prix,
VADIUS
Si le siècle rendait justice aux beaux esprits,
TRISSOTIN
En carrosse doré vous iriez par les rues.
VADIUS
On verrait le public vous dresser des statues.
Hom. C'est une ballade, et je veux que tout net
Vous m'en…
TRISSOTIN
Avez-vous vu certain petit sonnet
Sur la fièvre qui tient la princesse Uranie?
VADIUS
Oui, hier il me fut lu dans une compagnie.
TRISSOTIN
Vous en savez l'auteur?
VADIUS
Non; mais je sais fort bien,
Qu'à ne le point flatter, son sonnet ne vaut rien.
TRISSOTIN
Beaucoup de gens pourtant le trouvent admirable.
VADIUS
Cela n'empêche pas qu'il ne soit misérable;
Et si vous l'avez vu, vous serez de mon goût.
TRISSOTIN
Je sais que là-dessus je n'en suis point du tout,
Et que d'un tel sonnet peu de gens sont capables.
VADIUS
Me préserve le Ciel d'en faire de semblables!
TRISSOTIN
Je soutiens qu'on ne peut en faire de meilleur;
Et ma grande raison, c'est que j'en suis l'auteur.
VADIUS
Vous?
TRISSOTIN
Moi.
VADIUS
Je ne sais donc comment se fit l'affaire.
TRISSOTIN
C'est qu'on fut malheureux, de ne pouvoir vous plaire.
VADIUS
Il faut qu'en écoutant j'aie eu l'esprit distrait,
Ou bien que le lecteur m'ait gâté le sonnet.
Mais laissons ce discours, et voyons ma ballade.
TRISSOTIN
La ballade, à mon goût, est une chose fade.
Ce n'en est plus la mode; elle sent son vieux temps.
VADIUS
La ballade pourtant charme beaucoup de gens.
TRISSOTIN
Cela n'empêche pas qu'elle ne me déplaise.
VADIUS
Elle n'en reste pas pour cela plus mauvaise.
TRISSOTIN
Elle a pour les pédants de merveilleux appas.
VADIUS
Cependant nous voyons qu'elle ne vous plaît pas.
TRISSOTIN
Vous donnez sottement vos qualités aux autres.
VADIUS
Fort impertinemment vous me jetez les vôtres.
TRISSOTIN
Allez, petit grimaud, barbouilleur de papier.
VADIUS
Allez, rimeur de balle, opprobre du métier.
TRISSOTIN
Allez, fripier d'écrits, impudent plagiaire.
VADIUS
Allez, cuistre…
PHILAMINTE
Eh, Messieurs, que prétendez-vous faire?
TRISSOTIN
Va, va restituer tous les honteux larcins
Que réclament sur toi les Grecs et les Latins.
VADIUS
Va, va-t'en faire amende honorable au Parnasse,
D'avoir fait à tes vers estropier Horace.
TRISSOTIN
Souviens-toi de ton livre, et de son peu de bruit.
VADIUS
Et toi, de ton libraire à l'hôpital réduit.
TRISSOTIN
Ma gloire est établie, en vain tu la déchires.
VADIUS
Oui, oui, je te renvoie à l'auteur des Satires.
TRISSOTIN
Je t'y renvoie aussi.
VADIUS
J'ai le contentement,
Qu'on voit qu'il m'a traité plus honorablement.
Il me donne en passant une atteinte légère
Parmi plusieurs auteurs qu'au Palais on révère;
Mais jamais dans ses vers il ne te laisse en paix,
Et l'on t'y voit partout être en butte à ses traits.
TRISSOTIN
C'est par là que j'y tiens un rang plus honorable.
Il te met dans la foule ainsi qu'un misérable,
Il croit que c'est assez d'un coup pour t'accabler,
Et ne t'a jamais fait l'honneur de redoubler:
Mais il m'attaque à part comme un noble adversaire
Sur qui tout son effort lui semble nécessaire;
Et ses coups contre moi redoublés en tous lieux,
Montrent qu'il ne se croit jamais victorieux.
VADIUS
Ma plume t'apprendra quel homme je puis être.
TRISSOTIN
Et la mienne saura te faire voir ton maître.
VADIUS
Je te défie en vers, prose, grec, et latin.
TRISSOTIN
Hé bien, nous nous verrons seul à seul chez Barbin74.

SCÈNE IV
TRISSOTIN, PHILAMINTE, ARMANDE, BÉLISE, HENRIETTE.
TRISSOTIN
À mon emportement ne donnez aucun blâme;
C'est votre jugement que je défends, Madame,
Dans le sonnet qu'il a l'audace d'attaquer.
PHILAMINTE
À vous remettre bien, je me veux appliquer.
Mais parlons d'autre affaire. Approchez, Henriette.
Depuis assez longtemps mon âme s'inquiète,
De ce qu'aucun esprit en vous ne se fait voir,
Mais je trouve un moyen de vous en faire avoir.
HENRIETTE
C'est prendre un soin pour moi qui n'est pas nécessaire,
Les doctes entretiens ne sont point mon affaire.
J'aime à vivre aisément , et dans tout ce qu'on dit
Il faut se trop peiner, pour avoir de l'esprit.
C'est une ambition que je n'ai point en tête,
Je me trouve fort bien, ma mère, d'être bête,
Et j'aime mieux n'avoir que de communs propos,
Que de me tourmenter pour dire de beaux mots.
PHILAMINTE
Oui, mais j'y suis blessée, et ce n'est pas mon compte
De souffrir dans mon sang une pareille honte.
La beauté du visage est un frêle ornement,
Une fleur passagère, un éclat d'un moment,
Et qui n'est attaché qu'à la simple épiderme;
Mais celle de l'esprit est inhérente et ferme.
J'ai donc cherché longtemps un biais de vous donner
La beauté que les ans ne peuvent moissonner,
De faire entrer chez vous le désir des sciences,
De vous insinuer les belles connaissances;
Et la pensée enfin où mes vœux ont souscrit,
C'est d'attacher à vous un homme plein d'esprit,
Et cet homme est Monsieur que je vous détermine
À voir comme l'époux que mon choix vous destine.
HENRIETTE
Moi, ma mère?
PHILAMINTE
Oui, vous. Faites la sotte un peu.
BÉLISE
Je vous entends. Vos yeux demandent mon aveu,
Pour engager ailleurs un cœur que je possède.
Allez, je le veux bien. À ce nœud je vous cède,
C'est un hymen qui fait votre établissement.
TRISSOTIN
Je ne sais que vous dire, en mon ravissement,
Madame, et cet hymen dont je vois qu'on m'honore
Me met…
HENRIETTE
Tout beau, Monsieur, il n'est pas fait encore
Ne vous pressez pas tant.
PHILAMINTE
Comme vous répondez!
Savez-vous bien que si… Suffit, vous m'entendez.
Elle se rendra sage; allons, laissons-la faire.
SCÈNE V
HENRIETTE, ARMANDE.
ARMANDE
On voit briller pour vous les soins de notre mère;
Et son choix ne pouvait d'un plus illustre époux…
HENRIETTE
Si le choix est si beau, que ne le prenez-vous?
ARMANDE
C'est à vous, non à moi, que sa main est donnée.
HENRIETTE
Je vous le cède tout, comme à ma sœur aînée.
ARMANDE
Si l'hymen comme à vous me paraissait charmant,
J'accepterais votre offre avec ravissement.
HENRIETTE
Si j'avais comme vous les pédants dans la tête,
Je pourrais le trouver un parti fort honnête.
ARMANDE
Cependant bien qu'ici nos goûts soient différents,
Nous devons obéir, ma sœur, à nos parents;
Une mère a sur nous une entière puissance,
Et vous croyez en vain par votre résistance…
SCÈNE VI
CHRYSALE, ARISTE, CLITANDRE, HENRIETTE, ARMANDE.
CHRYSALE
Allons, ma fille, il faut approuver mon dessein,
Ôtez ce gant. Touchez à Monsieur dans la main,
Et le considérez désormais dans votre âme
En homme dont je veux que vous soyez la femme.
ARMANDE
De ce côté, ma sœur, vos penchants sont fort grands.
HENRIETTE
Il nous faut obéir, ma sœur, à nos parents;
Un père a sur nos vœux une entière puissance.
ARMANDE
Une mère a sa part à notre obéissance.
CHRYSALE
Qu'est-ce à dire?
ARMANDE
Je dis que j'appréhende fort
Qu'ici ma mère et vous ne soyez pas d'accord,
Et c'est un autre époux…
CHRYSALE
Taisez-vous, péronnelle!
Allez philosopher tout le soûl avec elle,
Et de mes actions ne vous mêlez en rien.
Dites-lui ma pensée, et l'avertissez bien
Qu'elle ne vienne pas m'échauffer les oreilles;
Allons vite.
ARISTE
Fort bien; vous faites des merveilles.
CLITANDRE
Quel transport! quelle joie! ah! que mon sort est doux!
CHRYSALE
Allons, prenez sa main, et passez devant nous,
Menez-la dans sa chambre. Ah les douces caresses!
Tenez, mon cœur s'émeut à toutes ces tendresses,
Cela ragaillardit tout à fait mes vieux jours,
Et je me ressouviens de mes jeunes amours.
ACTE IV, SCÈNE PREMIÈRE
ARMANDE, PHILAMINTE.
ARMANDE
Oui, rien n'a retenu son esprit en balance.
Elle a fait vanité de son obéissance.
Son cœur, pour se livrer, à peine devant moi
S'est-il donné le temps d'en recevoir la loi,
Et semblait suivre moins les volontés d'un père,
Qu'affecter de braver les ordres d'une mère.
PHILAMINTE
Je lui montrerai bien aux lois de qui des deux
Les droits de la raison soumettent tous ses vœux;
Et qui doit gouverner ou sa mère, ou son père,
Ou l'esprit, ou le corps; la forme, ou la matière.
ARMANDE
On vous en devait bien au moins un compliment,
Et ce petit Monsieur en use étrangement,
De vouloir malgré vous devenir votre gendre.
PHILAMINTE
Il n'en est pas encore où son cœur peut prétendre.
Je le trouvais bien fait, et j'aimais vos amours;
Mais dans ses procédés il m'a déplu toujours.
Il sait que Dieu merci je me mêle d'écrire,
Et jamais il ne m'a prié de lui rien lire.
SCÈNE II
CLITANDRE, ARMANDE, PHILAMINTE.
ARMANDE
Je ne souffrirais point, si j'étais que de vous,
Que jamais d'Henriette il pût être l'époux.
On me ferait grand tort d'avoir quelque pensée,
Que là-dessus je parle en fille intéressée,
Et que le lâche tour que l'on voit qu'il me fait,
Jette au fond de mon cœur quelque dépit secret.
Contre de pareils coups, l'âme se fortifie
Du solide secours de la philosophie,
Et par elle on se peut mettre au-dessus de tout:
Mais vous traiter ainsi, c'est vous pousser à bout.
Il est de votre honneur d'être à ses vœux contraire,
Et c'est un homme enfin qui ne doit point vous plaire.
Jamais je n'ai connu, discourant entre nous,
Qu'il eût au fond du cœur de l'estime pour vous.
PHILAMINTE
Petit sot!
ARMANDE
Quelque bruit que votre gloire fasse,
Toujours à vous louer il a paru de glace.
PHILAMINTE
Le brutal!
ARMANDE
Et vingt fois, comme ouvrages nouveaux,
J'ai lu des vers de vous qu'il n'a point trouvés beaux.
PHILAMINTE
L'impertinent!
ARMANDE
Souvent nous en étions aux prises;
Et vous ne croiriez point de combien de sottises…
CLITANDRE
Eh doucement de grâce. Un peu de charité,
Madame, ou tout au moins un peu d'honnêteté.
Quel mal vous ai-je fait? et quelle est mon offense,
Pour armer contre moi toute votre éloquence?
Pour vouloir me détruire, et prendre tant de soin
De me rendre odieux aux gens dont j'ai besoin?
Parlez. Dites, d'où vient ce courroux effroyable?
Je veux bien que Madame en soit juge équitable.
ARMANDE
Si j'avais le courroux dont on veut m'accuser,
Je trouverais assez de quoi l'autoriser;
Vous en seriez trop digne, et les premières flammes
S'établissent des droits si sacrés sur les âmes
Qu'il faut perdre fortune, et renoncer au jour,
Plutôt que de brûler des feux d'un autre amour;
Au changement de vœux nulle horreur ne s'égale,
Et tout cœur infidèle est un monstre en morale.
CLITANDRE
Appelez-vous, Madame, une infidélité,
Ce que m'a de votre âme ordonné la fierté?
Je ne fais qu'obéir aux lois qu'elle m'impose;
Et si je vous offense, elle seule en est cause.
Vos charmes ont d'abord possédé tout mon cœur.
Il a brûlé deux ans d'une constante ardeur;
Il n'est soins empressés, devoirs, respects, services,
Dont il ne vous ait fait d'amoureux sacrifices.
Tous mes feux, tous mes soins ne peuvent rien sur vous,
Je vous trouve contraire à mes vœux les plus doux;
Ce que vous refusez, je l'offre au choix d'une autre.
Voyez. Est-ce, Madame, ou ma faute, ou la vôtre?
Mon cœur court-il au change, ou si vous l'y poussez?
Est-ce moi qui vous quitte, ou vous qui me chassez?
ARMANDE
Appelez-vous, Monsieur, être à vos vœux contraire,
Que de leur arracher ce qu'ils ont de vulgaire,
Et vouloir les réduire à cette pureté
Où du parfait amour consiste la beauté?
Vous ne sauriez pour moi tenir votre pensée
Du commerce des sens nette et débarrassée?
Et vous ne goûtez point dans ses plus doux appas,
Cette union des cœurs, où les corps n'entrent pas.
Vous ne pouvez aimer que d'une amour grossière?
Qu'avec tout l'attirail des nœuds de la matière?
Et pour nourrir les feux que chez vous on produit,
Il faut un mariage, et tout ce qui s'ensuit.
Ah quel étrange amour! et que les belles âmes
Sont bien loin de brûler de ces terrestres flammes!
Les sens n'ont point de part à toutes leurs ardeurs,
Et ce beau feu ne veut marier que les cœurs.
Comme une chose indigne, il laisse là le reste.
C'est un feu pur et net comme le feu céleste,
On ne pousse avec lui que d'honnêtes soupirs,
Et l'on ne penche point vers les sales désirs.
Rien d'impur ne se mêle au but qu'on se propose.
On aime pour aimer, et non pour autre chose.
Ce n'est qu'à l'esprit seul que vont tous les transports
Et l'on ne s'aperçoit jamais qu'on ait un corps.
CLITANDRE
Pour moi par un malheur, je m'aperçois, Madame,
Que j'ai, ne vous déplaise, un corps tout comme une âme:
Je sens qu'il y tient trop, pour le laisser à part;
De ces détachements je ne connais point l'art;
Le Ciel m'a dénié cette philosophie,
Et mon âme et mon corps marchent de compagnie.
Il n'est rien de plus beau, comme vous avez dit,
Que ces vœux épurés qui ne vont qu'à l'esprit,
Ces unions de cœurs, et ces tendres pensées,
Du commerce des sens si bien débarrassées:
Mais ces amours pour moi sont trop subtilisés,
Je suis un peu grossier, comme vous m'accusez;
J'aime avec tout moi-même, et l'amour qu'on me donne,
En veut, je le confesse, à toute la personne.
Ce n'est pas là matière à de grands châtiments;
Et sans faire de tort à vos beaux sentiments,
Je vois que dans le monde on suit fort ma méthode,
Et que le mariage est assez à la mode,
Passe pour un lien assez honnête et doux,
Pour avoir désiré de me voir votre époux,
Sans que la liberté d'une telle pensée
Ait dû vous donner lieu d'en paraître offensée.
ARMANDE
Hé bien, Monsieur, hé bien, puisque sans m'écouter
Vos sentiments brutaux veulent se contenter;
Puisque pour vous réduire à des ardeurs fidèles,
Il faut des nœuds de chair, des chaînes corporelles;
Si ma mère le veut, je résous mon esprit
À consentir pour vous à ce dont il s'agit.
CLITANDRE
Il n'est plus temps, Madame, une autre a pris la place;
Et par un tel retour j'aurais mauvaise grâce
De maltraiter l'asile, et blesser les bontés,
Où je me suis sauvé de toutes vos fiertés.
PHILAMINTE
Mais enfin comptez-vous, Monsieur, sur mon suffrage,
Quand vous vous promettez cet autre mariage?
Et dans vos visions savez-vous, s'il vous plaît,
Que j'ai pour Henriette un autre époux tout prêt?
CLITANDRE
Eh, Madame, voyez votre choix, je vous prie;
Exposez-moi, de grâce, à moins d'ignominie,
Et ne me rangez pas à l'indigne destin
De me voir le rival de Monsieur Trissotin.
L'amour des beaux esprits qui chez vous m'est contraire
Ne pouvait m'opposer un moins noble adversaire.
Il en est, et plusieurs, que pour le bel esprit
Le mauvais goût du siècle a su mettre en crédit:
Mais Monsieur Trissotin n'a pu duper personne,
Et chacun rend justice aux écrits qu'il nous donne.
Hors céans, on le prise en tous lieux ce qu'il vaut;
Et ce qui m'a vingt fois fait tomber de mon haut,
C'est de vous voir au ciel élever des sornettes,
Que vous désavoueriez, si vous les aviez faites.
PHILAMINTE
Si vous jugez de lui tout autrement que nous,
C'est que nous le voyons par d'autres yeux que vous.
SCÈNE III
TRISSOTIN, ARMANDE, PHILAMINTE, CLITANDRE.
TRISSOTIN
Je viens vous annoncer une grande nouvelle.
Nous l'avons en dormant, Madame, échappé belle:
Un monde près de nous a passé tout du long,
Est chu tout au travers de notre tourbillon;
Et s'il eût en chemin rencontré notre terre,
Elle eût été brisée en morceaux comme verre.
PHILAMINTE
Remettons ce discours pour une autre saison,
Monsieur n'y trouverait ni rime, ni raison;
Il fait profession de chérir l'ignorance,
Et de haïr surtout l'esprit et la science.
CLITANDRE
Cette vérité veut quelque adoucissement.
Je m'explique, Madame, et je hais seulement
La science et l'esprit qui gâtent les personnes.
Ce sont choses de soi qui sont belles et bonnes;
Mais j'aimerais mieux être au rang des ignorants,
Que de me voir savant comme certaines gens.
TRISSOTIN
Pour moi je ne tiens pas, quelque effet qu'on suppose,
Que la science soit pour gâter quelque chose.
CLITANDRE
Et c'est mon sentiment, qu'en faits, comme en propos,
La science est sujette à faire de grands sots.
TRISSOTIN
Le paradoxe est fort.
CLITANDRE
Sans être fort habile,
La preuve m'en serait je pense assez facile.
Si les raisons manquaient, je suis sûr qu'en tout cas
Les exemples fameux ne me manqueraient pas.
TRISSOTIN
Vous en pourriez citer qui ne concluraient guère.
CLITANDRE
Je n'irais pas bien loin pour trouver mon affaire.
TRISSOTIN
Pour moi je ne vois pas ces exemples fameux.
CLITANDRE
Moi, je les vois si bien, qu'ils me crèvent les yeux.
TRISSOTIN
J'ai cru jusques ici que c'était l'ignorance
Qui faisait les grands sots, et non pas la science.
CLITANDRE
Vous avez cru fort mal, et je vous suis garant,
Qu'un sot savant est sot plus qu'un sot ignorant.
TRISSOTIN
Le sentiment commun est contre vos maximes,
Puisque ignorant et sot sont termes synonymes.
CLITANDRE
Si vous le voulez prendre aux usages du mot,
L'alliance est plus grande entre pédant et sot.
TRISSOTIN
La sottise dans l'un se fait voir toute pure.
CLITANDRE
Et l'étude dans l'autre ajoute à la nature.
TRISSOTIN
Le savoir garde en soi son mérite éminent.
CLITANDRE
Le savoir dans un fat devient impertinent.
TRISSOTIN
Il faut que l'ignorance ait pour vous de grands charmes,
Puisque pour elle ainsi vous prenez tant les armes.
CLITANDRE
Si pour moi l'ignorance a des charmes bien grands,
C'est depuis qu'à mes yeux s'offrent certains savants.
TRISSOTIN
Ces certains savants-là, peuvent à les connaître
Valoir certaines gens que nous voyons paraître.
CLITANDRE
Oui, si l'on s'en rapporte à ces certains savants;
Mais on n'en convient pas chez ces certaines gens.
PHILAMINTE
Il me semble, Monsieur…
CLITANDRE
Eh, Madame, de grâce,
Monsieur est assez fort, sans qu'à son aide on passe:
Je n'ai déjà que trop d'un si rude assaillant;
Et si je me défends, ce n'est qu'en reculant.
ARMANDE
Mais l'offensante aigreur de chaque repartie
Dont vous…
CLITANDRE
Autre second, je quitte la partie.
PHILAMINTE
On souffre aux entretiens ces sortes de combats,
Pourvu qu'à la personne on ne s'attaque pas.
CLITANDRE
Eh, mon Dieu, tout cela n'a rien dont il s'offense;
Il entend raillerie autant qu'homme de France;
Et de bien d'autres traits il s'est senti piquer,
Sans que jamais sa gloire ait fait que s'en moquer.
TRISSOTIN
Je ne m'étonne pas au combat que j'essuie,
De voir prendre à Monsieur la thèse qu'il appuie.
Il est fort enfoncé dans la cour, c'est tout dit:
La cour, comme l'on sait, ne tient pas pour l'esprit;
Elle a quelque intérêt d'appuyer l'ignorance,
Et c'est en courtisan qu'il en prend la défense.
CLITANDRE
Vous en voulez beaucoup à cette pauvre cour,
Et son malheur est grand, de voir que chaque jour
Vous autres beaux esprits, vous déclamiez contre elle;
Que de tous vos chagrins vous lui fassiez querelle;
Et sur son méchant goût lui faisant son procès,
N'accusiez que lui seul de vos méchants succès.
Permettez-moi, Monsieur Trissotin, de vous dire,
Avec tout le respect que votre nom m'inspire,
Que vous feriez fort bien, vos confrères, et vous,
De parler de la cour d'un ton un peu plus doux;
Qu'à le bien prendre au fond, elle n'est pas si bête
Que vous autres Messieurs vous vous mettez en tête;
Qu'elle a du sens commun pour se connaître à tout;
Que chez elle on se peut former quelque bon goût;
Et que l'esprit du monde y vaut, sans flatterie,
Tout le savoir obscur de la pédanterie.
TRISSOTIN
De son bon goût, Monsieur, nous voyons des effets.
CLITANDRE
Où voyez-vous, Monsieur, qu'elle l'ait si mauvais?
TRISSOTIN
Ce que je vois, Monsieur, c'est que pour la science
Rasius et Baldus font honneur à la France,
Et que tout leur mérite exposé fort au jour,
N'attire point les yeux et les dons de la Cour.
CLITANDRE
Je vois votre chagrin, et que par modestie
Vous ne vous mettez point, Monsieur, de la partie:
Et pour ne vous point mettre aussi dans le propos,
Que font-ils pour l'Etat vos habiles héros?
Qu'est-ce que leurs écrits lui rendent de service,
Pour accuser la cour d'une horrible injustice,
Et se plaindre en tous lieux que sur leurs doctes noms
Elle manque à verser la faveur de ses dons?
Leur savoir à la France est beaucoup nécessaire,
Et des livres qu'ils font la cour a bien affaire.
Il semble à trois gredins, dans leur petit cerveau,
Que pour être imprimés, et reliés en veau,
Les voilà dans l'État d'importantes personnes;
Qu'avec leur plume ils font les destins des couronnes;
Qu'au moindre petit bruit de leurs productions,
Ils doivent voir chez eux voler les pensions;
Que sur eux l'univers a la vue attachée;
Que partout de leur nom la gloire est épanchée,
Et qu'en science ils sont des prodiges fameux,
Pour savoir ce qu'ont dit les autres avant eux,
Pour avoir eu trente ans des yeux et des oreilles,
Pour avoir employé neuf ou dix mille veilles
À se bien barbouiller de grec et de latin,
Et se charger l'esprit d'un ténébreux butin
De tous les vieux fatras qui traînent dans les livres;
Gens qui de leur savoir paraissent toujours ivres;
Riches pour tout mérite, en babil importun,
Inhabiles à tout, vides de sens commun,
Et pleins d'un ridicule, et d'une impertinence
À décrier partout l'esprit et la science.
PHILAMINTE
Votre chaleur est grande, et cet emportement
De la nature en vous marque le mouvement.
C'est le nom de rival qui dans votre âme excite…
SCÈNE IV
JULIEN, TRISSOTIN, PHILAMINTE, CLITANDRE, ARMANDE.
JULIEN
Le savant qui tantôt vous a rendu visite,
Et de qui j'ai l'honneur de me voir le valet,
Madame, vous exhorte à lire ce billet.
PHILAMINTE
Quelque important que soit ce qu'on veut que je lise,
Apprenez, mon ami, que c'est une sottise
De se venir jeter au travers d'un discours,
Et qu'aux gens d'un logis il faut avoir recours,
Afin de s'introduire en valet qui sait vivre.
JULIEN
Je noterai cela, Madame, dans mon livre.
PHILAMINTE lit:
Trissotin s'est vanté, Madame, qu'il épouserait
votre fille. Je vous donne avis que sa philosophie n'en
veut qu'à vos richesses, et que vous ferez bien de ne
point conclure ce mariage, que vous n'ayez vu le
poème que je compose contre lui. En attendant cette
peinture, où je prétends vous le dépeindre de toutes
ses couleurs, je vous envoie Horace, Virgile, Térence
et Catulle, où vous verrez notés en marge tous les
endroits qu'il a pillés.
PHILAMINTE poursuit.
Voilà sur cet hymen que je me suis promis
Un mérite attaqué de beaucoup d'ennemis;
Et ce déchaînement aujourd'hui me convie,
À faire une action qui confonde l'envie;
Qui lui fasse sentir que l'effort qu'elle fait,
De ce qu'elle veut rompre, aura pressé l'effet.
Reportez tout cela sur l'heure à votre maître;
Et lui dites, qu'afin de lui faire connaître
Quel grand état je fais de ses nobles avis,
Et comme je les crois dignes d'être suivis,
Dès ce soir à Monsieur je marierai ma fille;
Vous, Monsieur, comme ami de toute la famille,
À signer leur contrat vous pourrez assister,
Et je vous y veux bien de ma part inviter.
Armande, prenez soin d'envoyer au notaire,
Et d'aller avertir votre sœur de l'affaire.
ARMANDE
Pour avertir ma sœur, il n'en est pas besoin,
Et Monsieur que voilà, saura prendre le soin
De courir lui porter bientôt cette nouvelle,
Et disposer son cœur à vous être rebelle.
PHILAMINTE
Nous verrons qui sur elle aura plus de pouvoir,
Et si je la saurai réduire à son devoir.
Elle s'en va.
ARMANDE
J'ai grand regret, Monsieur, de voir qu'à vos visées,
Les choses ne soient pas tout à fait disposées.
CLITANDRE
Je m'en vais travailler, Madame, avec ardeur,
À ne vous point laisser ce grand regret au cœur.
ARMANDE
J'ai peur que votre effort n'ait pas trop bonne issue.
CLITANDRE
Peut-être verrez-vous votre crainte déçue.
ARMANDE
Je le souhaite ainsi.
CLITANDRE
J'en suis persuadé,
Et que de votre appui je serai secondé.
ARMANDE
Oui, je vais vous servir de toute ma puissance.
CLITANDRE
Et ce service est sûr de ma reconnaissance.
SCÈNE V
CHRYSALE, ARISTE, HENRIETTE, CLITANDRE.
CLITANDRE
Sans votre appui, Monsieur, je serai malheureux.
Madame votre femme a rejeté mes vœux,
Et son cœur prévenu, veut Trissotin pour gendre.
CHRYSALE
Mais quelle fantaisie a-t-elle donc pu prendre?
Pourquoi diantre vouloir ce Monsieur Trissotin?
ARISTE
C'est par l'honneur qu'il a de rimer à latin,
Qu'il a sur son rival emporté l'avantage.
CLITANDRE
Elle veut dès ce soir faire ce mariage.
CHRYSALE
Dès ce soir?
CLITANDRE
Dès ce soir.
CHRYSALE
Et dès ce soir je veux,
Pour la contrecarrer, vous marier vous deux.
CLITANDRE
Pour dresser le contrat, elle envoie au notaire.
CHRYSALE
Et je vais le quérir pour celui qu'il doit faire.
CLITANDRE
Et Madame doit être instruite par sa sœur,
De l'hymen où l'on veut qu'elle apprête son cœur.
CHRYSALE
Et moi, je lui commande avec pleine puissance,
De préparer sa main à cette autre alliance.
Ah je leur ferai voir, si pour donner la loi,
Il est dans ma maison d'autre maître que moi.
Nous allons revenir, songez à nous attendre;
Allons, suivez mes pas, mon frère, et vous mon gendre.
HENRIETTE
Hélas! dans cette humeur conservez-le toujours.
ARISTE
J'emploierai toute chose à servir vos amours.
CLITANDRE
Quelque secours puissant qu'on promette à ma flamme,
Mon plus solide espoir, c'est votre cœur, Madame.
HENRIETTE
Pour mon cœur vous pouvez vous assurer de lui.
CLITANDRE
Je ne puis qu'être heureux, quand j'aurai son appui.
HENRIETTE
Vous voyez à quels nœuds on prétend le contraindre.
CLITANDRE
Tant qu'il sera pour moi, je ne vois rien à craindre.
HENRIETTE
Je vais tout essayer pour nos vœux les plus doux;
Et si tous mes efforts ne me donnent à vous,
Il est une retraite où notre âme se donne,
Qui m'empêchera d'être à toute autre personne.
CLITANDRE
Veuille le juste Ciel me garder en ce jour,
De recevoir de vous cette preuve d'amour.
ACTE V, SCÈNE PREMIÈRE
HENRIETTE, TRISSOTIN.
HENRIETTE
C'est sur le mariage où ma mère s'apprête,
Que j'ai voulu, Monsieur, vous parler tête à tête;
Et j'ai cru dans le trouble où je vois la maison,
Que je pourrais vous faire écouter la raison.
Je sais qu'avec mes vœux vous me jugez capable
De vous porter en dot un bien considérable:
Mais l'argent dont on voit tant de gens faire cas,
Pour un vrai philosophe a d'indignes appas;
Et le mépris du bien et des grandeurs frivoles,
Ne doit point éclater dans vos seules paroles.
TRISSOTIN
Aussi n'est-ce point là ce qui me charme en vous;
Et vos brillants attraits, vos yeux perçants et doux,
Votre grâce et votre air sont les biens, les richesses,
Qui vous ont attiré mes vœux et mes tendresses;
C'est de ces seuls trésors que je suis amoureux.
HENRIETTE
Je suis fort redevable à vos feux généreux;
Cet obligeant amour a de quoi me confondre,
Et j'ai regret, Monsieur, de n'y pouvoir répondre.
Je vous estime autant qu'on saurait estimer,
Mais je trouve un obstacle à vous pouvoir aimer.
Un cœur, vous le savez, à deux ne saurait être,
Et je sens que du mien Clitandre s'est fait maître.
Je sais qu'il a bien moins de mérite que vous,
Que j'ai de méchants yeux pour le choix d'un époux,
Que par cent beaux talents vous devriez me plaire.
Je vois bien que j'ai tort, mais je n'y puis que faire;
Et tout ce que sur moi peut le raisonnement,
C'est de me vouloir mal d'un tel aveuglement.
TRISSOTIN
Le don de votre main où l'on me fait prétendre,
Me livrera ce cœur que possède Clitandre;
Et par mille doux soins, j'ai lieu de présumer,
Que je pourrai trouver l'art de me faire aimer.
HENRIETTE
Non, à ses premiers vœux mon âme est attachée,
Et ne peut de vos soins, Monsieur, être touchée.
Avec vous librement j'ose ici m'expliquer,
Et mon aveu n'a rien qui vous doive choquer.
Cette amoureuse ardeur qui dans les cœurs s'excite,
N'est point, comme l'on sait, un effet du mérite;
Le caprice y prend part, et quand quelqu'un nous plaît,
Souvent nous avons peine à dire pourquoi c'est.
Si l'on aimait, Monsieur, par choix et par sagesse,
Vous auriez tout mon cœur et toute ma tendresse;
Mais on voit que l'amour se gouverne autrement.
Laissez-moi, je vous prie, à mon aveuglement,
Et ne vous servez point de cette violence
Que pour vous on veut faire à mon obéissance.
Quand on est honnête homme, on ne veut rien devoir
À ce que des parents ont sur nous de pouvoir.
On répugne à se faire immoler ce qu'on aime,
Et l'on veut n'obtenir un cœur que de lui-même.
Ne poussez point ma mère à vouloir par son choix,
Exercer sur mes vœux la rigueur de ses droits.
Ôtez-moi votre amour, et portez à quelque autre
Les hommages d'un cœur aussi cher que le vôtre.
TRISSOTIN
Le moyen que ce cœur puisse vous contenter?
Imposez-lui des lois qu'il puisse exécuter.
De ne vous point aimer peut-il être capable,
À moins que vous cessiez, Madame, d'être aimable,
Et d'étaler aux yeux les célestes appas…
HENRIETTE
Eh Monsieur, laissons là ce galimatias.
Vous avez tant d'Iris, de Philis, d'Amarantes,
Que partout dans vos vers vous peignez si charmantes,
Et pour qui vous jurez tant d'amoureuse ardeur…
TRISSOTIN
C'est mon esprit qui parle, et ce n'est pas mon cœur.
D'elles on ne me voit amoureux qu'en poète;
Mais j'aime tout de bon l'adorable Henriette.
HENRIETTE
Eh de grâce, Monsieur…
TRISSOTIN
Si c'est vous offenser,
Mon offense envers vous n'est pas prête à cesser.
Cette ardeur jusqu'ici de vos yeux ignorée,
Vous consacre des vœux d'éternelle durée.
Rien n'en peut arrêter les aimables transports;
Et bien que vos beautés condamnent mes efforts,
Je ne puis refuser le secours d'une mère
Qui prétend couronner une flamme si chère;
Et pourvu que j'obtienne un bonheur si charmant,
Pourvu que je vous aie, il n'importe comment.
HENRIETTE
Mais savez-vous qu'on risque un peu plus qu'on ne pense,
À vouloir sur un cœur user de violence?
Qu'il ne fait pas bien sûr, à vous le trancher net,
D'épouser une fille en dépit qu'elle en ait;
Et qu'elle peut aller en se voyant contraindre,
À des ressentiments que le mari doit craindre?
TRISSOTIN
Un tel discours n'a rien dont je sois altéré.
À tous événements le sage est préparé.
Guéri par la raison des faiblesses vulgaires,
Il se met au-dessus de ces sortes d'affaires,
Et n'a garde de prendre aucune ombre d'ennui,
De tout ce qui n'est pas pour dépendre de lui.
HENRIETTE
En vérité, Monsieur, je suis de vous ravie;
Et je ne pensais pas que la philosophie
Fût si belle qu'elle est, d'instruire ainsi les gens
À porter constamment de pareils accidents.
Cette fermeté d'âme à vous si singulière,
Mérite qu'on lui donne une illustre matière;
Est digne de trouver qui prenne avec amour,
Les soins continuels de la mettre en son jour;
Et comme à dire vrai, je n'oserais me croire
Bien propre à lui donner tout l'éclat de sa gloire,
Je le laisse à quelque autre, et vous jure entre nous,
Que je renonce au bien de vous voir mon époux.
TRISSOTIN
Nous allons voir bientôt comment ira l'affaire;
Et l'on a là-dedans fait venir le notaire.
SCÈNE II
CHRYSALE, CLITANDRE, MARTINE, HENRIETTE.
CHRYSALE
Ah, ma fille, je suis bien aise de vous voir.
Allons, venez-vous-en faire votre devoir,
Et soumettre vos vœux aux volontés d'un père.
Je veux, je veux apprendre à vivre à votre mère;
Et pour la mieux braver, voilà, malgré ses dents,
Martine que j'amène, et rétablis céans.
HENRIETTE
Vos résolutions sont dignes de louange.
Gardez que cette humeur, mon père, ne vous change.
Soyez ferme à vouloir ce que vous souhaitez,
Et ne vous laissez point séduire à vos bontés.
Ne vous relâchez pas, et faites bien en sorte
D'empêcher que sur vous ma mère ne l'emporte.
CHRYSALE
Comment? Me prenez-vous ici pour un benêt?
HENRIETTE
M'en préserve le Ciel.
CHRYSALE
Suis-je un fat, s'il vous plaît?
HENRIETTE
Je ne dis pas cela.
CHRYSALE
Me croit-on incapable
Des fermes sentiments d'un homme raisonnable?
HENRIETTE
Non, mon père.
CHRYSALE
Est-ce donc qu'à l'âge où je me voi,
Je n'aurais pas l'esprit d'être maître chez moi?
HENRIETTE
Si fait.
CHRYSALE
Et que j'aurais cette faiblesse d'âme,
De me laisser mener par le nez à ma femme?
HENRIETTE
Eh non, mon père.
CHRYSALE
Ouais. Qu'est-ce donc que ceci?
Je vous trouve plaisante à me parler ainsi.
HENRIETTE
Si je vous ai choqué, ce n'est pas mon envie.
CHRYSALE
Ma volonté céans doit être en tout suivie.
HENRIETTE
Fort bien, mon père.
CHRYSALE
Aucun, hors moi, dans la maison,
N'a droit de commander.
HENRIETTE
Oui, vous avez raison.
CHRYSALE
C'est moi qui tiens le rang de chef de la famille.
HENRIETTE
D'accord.
CHRYSALE
C'est moi qui dois disposer de ma fille.
HENRIETTE
Eh oui.
CHRYSALE
Le Ciel me donne un plein pouvoir sur vous.
HENRIETTE
Qui vous dit le contraire?
CHRYSALE
Et pour prendre un époux,
Je vous ferai bien voir que c'est à votre père
Qu'il vous faut obéir, non pas à votre mère.
HENRIETTE
Hélas! vous flattez là les plus doux de mes vœux;
Veuillez être obéi, c'est tout ce que je veux.
CHRYSALE
Nous verrons si ma femme à mes désirs rebelle…
CLITANDRE
La voici qui conduit le notaire avec elle.
CHRYSALE
Secondez-moi bien tous.
MARTINE
Laissez-moi, j'aurai soin
De vous encourager, s'il en est de besoin.
SCÈNE III
PHILAMINTE, BÉLISE, ARMANDE, TRISSOTIN, LE NOTAIRE, CHRYSALE, CLITANDRE, HENRIETTE, MARTINE.
PHILAMINTE
Vous ne sauriez changer votre style sauvage,
Et nous faire un contrat qui soit en beau langage?
LE NOTAIRE
Notre style est très bon, et je serais un sot,
Madame, de vouloir y changer un seul mot.
BÉLISE
Ah! quelle barbarie au milieu de la France!
Mais au moins en faveur, Monsieur, de la science,
Veuillez au lieu d'écus, de livres et de francs,
Nous exprimer la dot en mines et talents,
Et dater par les mots d'ides et de calendes.
LE NOTAIRE
Moi? Si j'allais, Madame, accorder vos demandes,
Je me ferais siffler de tous mes compagnons.
PHILAMINTE
De cette barbarie en vain nous nous plaignons.
Allons, Monsieur, prenez la table pour écrire.
Ah, ah! cette impudente ose encor se produire?
Pourquoi donc, s'il vous plaît, la ramener chez moi?
CHRYSALE
Tantôt avec loisir on vous dira pourquoi.
Nous avons maintenant autre chose à conclure.
LE NOTAIRE
Procédons au contrat. Où donc est la future?
PHILAMINTE
Celle que je marie est la cadette.
LE NOTAIRE
Bon.
CHRYSALE
Oui. La voilà, Monsieur, Henriette est son nom.
LE NOTAIRE
Fort bien. Et le futur?
PHILAMINTE
L'époux que je lui donne
Est Monsieur.
CHRYSALE, montrant Clitandre.
Et celui, moi, qu'en propre personne,
Je prétends qu'elle épouse, est Monsieur.
LE NOTAIRE
Deux époux!
C'est trop pour la coutume.
PHILAMINTE
Où vous arrêtez-vous?
Mettez, mettez, Monsieur, Trissotin pour mon gendre.
CHRYSALE
Pour mon gendre mettez, mettez, Monsieur, Clitandre.
LE NOTAIRE
Mettez-vous donc d'accord et d'un jugement mûr
Voyez à convenir entre vous du futur.
PHILAMINTE
Suivez, suivez, Monsieur, le choix où je m'arrête.
CHRYSALE
Faites, faites, Monsieur, les choses à ma tête.
LE NOTAIRE
Dites-moi donc à qui j'obéirai des deux?
PHILAMINTE
Quoi donc, vous combattez les choses que je veux?
CHRYSALE
Je ne saurais souffrir qu'on ne cherche ma fille,
Que pour l'amour du bien qu'on voit dans ma famille.
PHILAMINTE
Vraiment à votre bien on songe bien ici,
Et c'est là pour un sage, un fort digne souci!
CHRYSALE
Enfin pour son époux, j'ai fait choix de Clitandre.
PHILAMINTE
Et moi, pour son époux, voici qui je veux prendre:
Mon choix sera suivi, c'est un point résolu.
CHRYSALE
Ouais. Vous le prenez là d'un ton bien absolu?
MARTINE
Ce n'est point à la femme à prescrire, et je sommes
Pour céder le dessus en toute chose aux hommes.
CHRYSALE
C'est bien dit.
MARTINE
Mon congé cent fois me fût-il hoc,
La poule ne doit point chanter devant le coq.
CHRYSALE
Sans doute.
MARTINE
Et nous voyons que d'un homme on se gausse,
Quand sa femme chez lui porte le haut-de-chausse.
CHRYSALE
Il est vrai.
MARTINE
Si j'avais un mari, je le dis,
Je voudrais qu'il se fît le maître du logis.
Je ne l'aimerais point, s'il faisait le jocrisse.
Et si je contestais contre lui par caprice;
Si je parlais trop haut, je trouverais fort bon,
Qu'avec quelques soufflets il rabaissât mon ton.
CHRYSALE
C'est parler comme il faut.
MARTINE
Monsieur est raisonnable,
De vouloir pour sa fille un mari convenable.
CHRYSALE
Oui.
MARTINE
Par quelle raison, jeune, et bien fait qu'il est,
Lui refuser Clitandre? Et pourquoi, s'il vous plaît,
Lui bailler un savant, qui sans cesse épilogue?
Il lui faut un mari, non pas un pédagogue:
Et ne voulant savoir le grais, ni le latin,
Elle n'a pas besoin de Monsieur Trissotin.
CHRYSALE
Fort bien.
PHILAMINTE
Il faut souffrir qu'elle jase à son aise.
MARTINE
Les savants ne sont bons que pour prêcher en chaise;
Et pour mon mari, moi, mille fois je l'ai dit,
Je ne voudrais jamais prendre un homme d'esprit.
L'esprit n'est point du tout ce qu'il faut en ménage;
Les livres cadrent mal avec le mariage;
Et je veux, si jamais on engage ma foi,
Un mari qui n'ait point d'autre livre que moi;
Qui ne sache A, ne B, n'en déplaise à Madame,
Et ne soit en un mot docteur que pour sa femme.
PHILAMINTE
Est-ce fait? et sans trouble ai-je assez écouté
Votre digne interprète?
CHRYSALE
Elle a dit vérité.
PHILAMINTE
Et moi, pour trancher court toute cette dispute,
Il faut qu'absolument mon désir s'exécute.
Henriette, et Monsieur seront joints de ce pas;
Je l'ai dit, je le veux, ne me répliquez pas:
Et si votre parole à Clitandre est donnée,
Offrez-lui le parti d'épouser son aînée.
CHRYSALE
Voilà dans cette affaire un accommodement.
Voyez? y donnez-vous votre consentement?
HENRIETTE
Eh mon père!
CLITANDRE
Eh Monsieur!
BÉLISE
On pourrait bien lui faire
Des propositions qui pourraient mieux lui plaire:
Mais nous établissons une espèce d'amour
Qui doit être épuré comme l'astre du jour;
La substance qui pense, y peut être reçue,
Mais nous en bannissons la substance étendue.
SCÈNE DERNIÈRE
ARISTE, CHRYSALE, PHILAMINTE, BÉLISE, HENRIETTE, ARMANDE, TRISSOTIN, LE NOTAIRE, CLITANDRE, MARTINE.
ARISTE
J'ai regret de troubler un mystère joyeux,
Par le chagrin qu'il faut que j'apporte en ces lieux.
Ces deux lettres me font porteur de deux nouvelles,
Dont j'ai senti pour vous les atteintes cruelles:
L'une pour vous, me vient de votre procureur;
L'autre pour vous, me vient de Lyon.
PHILAMINTE
Quel malheur,
Digne de nous troubler, pourrait-on nous écrire?
ARISTE
Cette lettre en contient un que vous pouvez lire.
PHILAMINTE
Madame, j'ai prié Monsieur votre frère de vous
rendre cette lettre, qui vous dira ce que je n'ai osé
vous aller dire. La grande négligence que vous avez
pour vos affaires, a été cause que le clerc de votre
rapporteur ne m'a point averti, et vous avez perdu
absolument votre procès que vous deviez gagner.
CHRYSALE
Votre procès perdu!
PHILAMINTE
Vous vous troublez beaucoup!
Mon cœur n'est point du tout ébranlé de ce coup.
Faites, faites paraître une âme moins commune
À braver comme moi les traits de la fortune.
Le peu de soin que vous avez vous coûte quarante
mille écus, et c'est à payer cette somme, avec les dépens,
que vous êtes condamnée par arrêt de la cour.
Condamnée! Ah ce mot est choquant, et n'est fait
Que pour les criminels.
ARISTE
Il a tort en effet,
Et vous vous êtes là justement récriée.
Il devait avoir mis que vous êtes priée,
Par arrêt de la cour, de payer au plus tôt
Quarante mille écus, et les dépens qu'il faut.
PHILAMINTE
Voyons l'autre.
CHRYSALE lit.
Monsieur, l'amitié qui me lie à Monsieur votre
frère, me fait prendre intérêt à tout ce qui vous touche.
Je sais que vous avez mis votre bien entre les mains
d'Argante et de Damon, et je vous donne avis qu'en
même jour ils ont fait tous deux banqueroute.
Ô Ciel! tout à la fois perdre ainsi tout mon bien!
PHILAMINTE
Ah quel honteux transport! Fi! tout cela n'est rien.
Il n'est pour le vrai sage aucun revers funeste,
Et perdant toute chose, à soi-même il se reste.
Achevons notre affaire, et quittez votre ennui;
Son bien nous peut suffire et pour nous, et pour lui.
TRISSOTIN
Non, Madame, cessez de presser cette affaire.
Je vois qu'à cet hymen tout le monde est contraire,
Et mon dessein n'est point de contraindre les gens.
PHILAMINTE
Cette réflexion vous vient en peu de temps!
Elle suit de bien près, Monsieur, notre disgrâce.
TRISSOTIN
De tant de résistance à la fin je me lasse.
J'aime mieux renoncer à tout cet embarras,
Et ne veux point d'un cœur qui ne se donne pas.
PHILAMINTE
Je vois, je vois de vous, non pas pour votre gloire,
Ce que jusques ici j'ai refusé de croire.
TRISSOTIN
Vous pouvez voir de moi tout ce que vous voudrez,
Et je regarde peu comment vous le prendrez:
Mais je ne suis point homme à souffrir l'infamie
Des refus offensants qu'il faut qu'ici j'essuie;
Je vaux bien que de moi l'on fasse plus de cas,
Et je baise les mains à qui ne me veut pas.
PHILAMINTE
Qu'il a bien découvert son âme mercenaire!
Et que peu philosophe est ce qu'il vient de faire!
CLITANDRE
Je ne me vante point de l'être, mais enfin
Je m'attache, Madame, à tout votre destin;
Et j'ose vous offrir, avecque ma personne,
Ce qu'on sait que de bien la fortune me donne.
PHILAMINTE
Vous me charmez, Monsieur, par ce trait généreux,
Et je veux couronner vos désirs amoureux.
Oui, j'accorde Henriette à l'ardeur empressée…
HENRIETTE
Non, ma mère, je change à présent de pensée.
Souffrez que je résiste à votre volonté.
CLITANDRE
Quoi, vous vous opposez à ma félicité?
Et lorsqu'à mon amour je vois chacun se rendre…
HENRIETTE
Je sais le peu de bien que vous avez, Clitandre,
Et je vous ai toujours souhaité pour époux,
Lorsqu'en satisfaisant à mes vœux les plus doux,
J'ai vu que mon hymen ajustait vos affaires:
Mais lorsque nous avons les destins si contraires,
Je vous chéris assez dans cette extrémité,
Pour ne vous charger point de notre adversité.
CLITANDRE
Tout destin avec vous me peut être agréable;
Tout destin me serait sans vous insupportable.
HENRIETTE
L'amour dans son transport parle toujours ainsi.
Des retours importuns évitons le souci,
Rien n'use tant l'ardeur de ce nœud qui nous lie,
Que les fâcheux besoins des choses de la vie;
Et l'on en vient souvent à s'accuser tous deux,
De tous les noirs chagrins qui suivent de tels feux.
ARISTE
N'est-ce que le motif que nous venons d'entendre,
Qui vous fait résister à l'hymen de Clitandre?
HENRIETTE
Sans cela, vous verriez tout mon cœur y courir;
Et je ne fuis sa main, que pour le trop chérir.
ARISTE
Laissez-vous donc lier par des chaînes si belles.
Je ne vous ai porté que de fausses nouvelles;
Et c'est un stratagème, un surprenant secours,
Que j'ai voulu tenter pour servir vos amours;
Pour détromper ma sœur, et lui faire connaître
Ce que son philosophe à l'essai pouvait être.
CHRYSALE
Le Ciel en soit loué.
PHILAMINTE
J'en ai la joie au cœur,
Par le chagrin qu'aura ce lâche déserteur.
Voilà le châtiment de sa basse avarice,
De voir qu'avec éclat cet hymen s'accomplisse.
CHRYSALE
Je le savais bien, moi, que vous l'épouseriez.
ARMANDE
Ainsi donc à leurs vœux vous me sacrifiez?
PHILAMINTE
Ce ne sera point vous que je leur sacrifie,
Et vous avez l'appui de la philosophie,
Pour voir d'un œil content couronner leur ardeur.
BÉLISE
Qu'il prenne garde au moins que je suis dans son cœur.
Par un prompt désespoir souvent on se marie,
Qu'on s'en repent après tout le temps de sa vie.
CHRYSALE
Allons, Monsieur, suivez l'ordre que j'ai prescrit,
Et faites le contrat ainsi que je l'ai dit.


RIDEAU